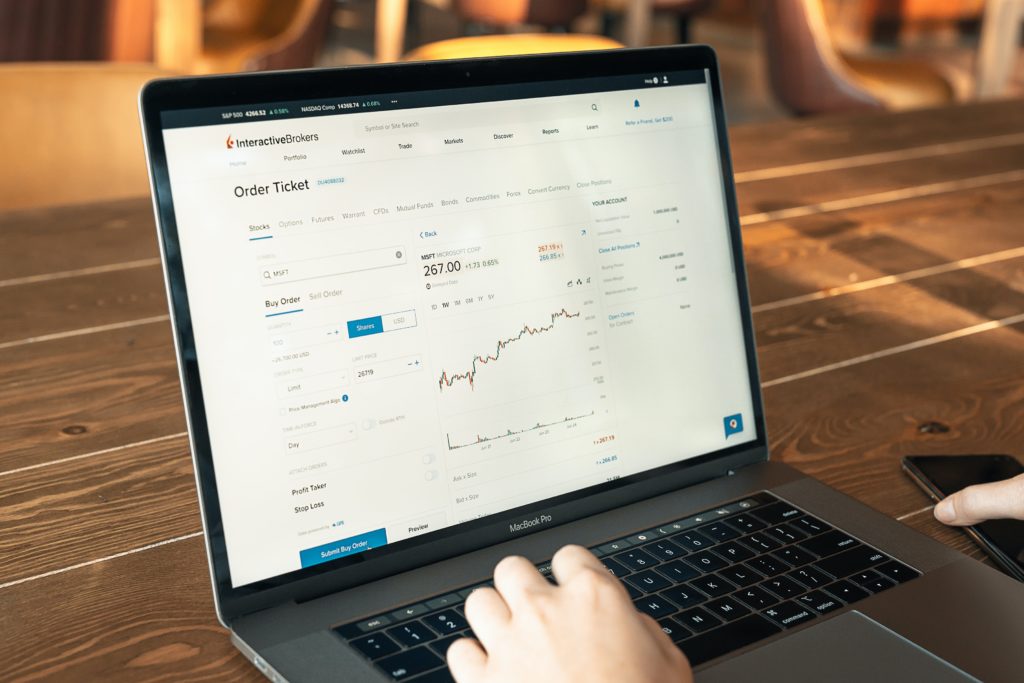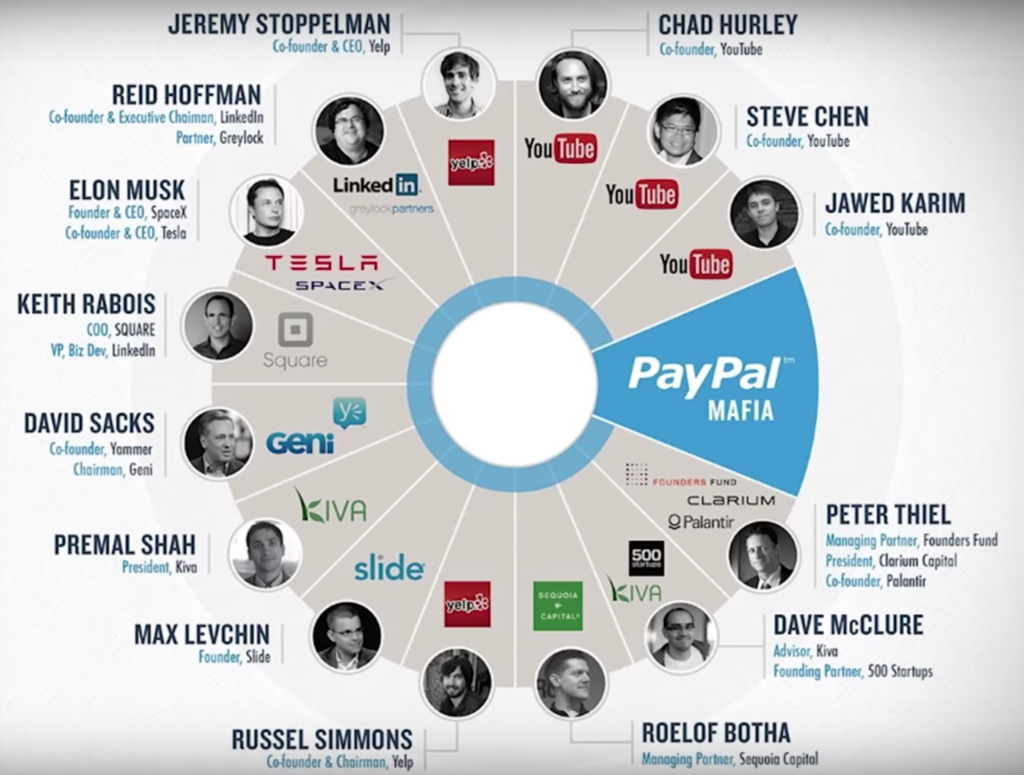L’éclosion de l’économie de plateforme à partir de 2010 a entraîné une libéralisation des services délocalisables, et le retour en force du travail à la tâche. Freelancers ou auto-entrepreneurs, les travailleurs de cette nouvelle économie ne sont plus considérés comme des salariés au sens classique du terme, même si leur statut reste encore sujet à de vifs débats dans un grand nombre de pays.

Selon la sociologue française Sophie Bernard, auteur d’un livre intitulé Le nouvel esprit du salariat (PUF, 2020), les mutations actuelles du monde du travail s’inscrivent dans une dynamique d’effacement des frontières entre le travail salarié et le travail indépendant. D’un côté, il existe des situations croissantes de dépendance chez les indépendants, certains auto-entrepreneurs n’ayant qu’un seul client, ce qui les assimile à des salariés déguisés. De l’autre, les pratiques managériales actuelles favorisent l’autonomie et la responsabilisation des salariés, tendant à rapprocher leur condition de celle des travailleurs indépendants.

De fait, depuis les années 1980, une concurrence exacerbée et la globalisation ont mené les entreprises à adopter des organisations plus flexibles. « Dorénavant, l’autonomie n’est pas accordée, mais exigée des salariés. Le contrôle ne disparaît pas, mais change de forme. Ce n’est plus tant l’exécution du travail qui est contrôlée que les résultats. Cette autonomie pour l’organisation, une autonomie mise au service de la performance de l’entreprise, participe ainsi d’une responsabilisation des salariés qui exonère l’employeur de contrôler le processus de travail en favorisant une intériorisation du contrôle et qui suscite une forte implication au travail. Dénier le lien de subordination en leur donnant le sentiment qu’ils travaillent pour eux est en effet un outil managérial pour favoriser un investissement au travail tout aussi conséquent que celui consenti par les indépendants travaillant à leur compte », souligne Sophie Bernard [1].

Pour la gauche politique, l’ubérisation du travail est souvent synonyme de sous-enchère et de concurrence déloyale. Ainsi, pour le juriste et ancien conseiller national socialiste Jean-Christophe Schwaab : « Les prestataires de ces nouveaux services sont les premières victimes, eux qui s’aperçoivent bien vite que cet auto-entrepreneuriat est surtout synonyme d’absence de protection et de revenu en cas de coup dur (maladie, accident), mais aussi d’une dépendance quasi totale envers la plate-forme qui monétise leurs services tout en leur promettant une « liberté d’entreprendre » qui se révèle bien vite être un leurre. »[2] Les organisations syndicales se battent donc pour que les plateformes numériques soient reconnues comme des « employeurs ». Et leurs pressions commencent à payer. A Genève, par exemple, Uber Eats devra sans doute verser un salaire à ses travailleurs à l’avenir. Le 4 mars 2020, la Cour de cassation française a également requalifié le contrat de partenariat entre la firme californienne et un ex-chauffeur indépendant en contrat de travail, démontrant la dépendance professionnelle d’une part des travailleurs de ces plateformes.

Jean Christophe Schwaab siège à la Chambre basse depuis six ans – Keystone
Défendre ainsi le salariat est compréhensible et louable à bien des égards. Aujourd’hui, il offre en effet aux travailleurs et travailleuses des droits et des protections à nuls autres pareils. Cependant, des enjeux plus profonds apparaissent lorsque l’on s’intéresse à l’histoire de ce statut professionnel. Par le passé, en effet, la rémunération du travail sous forme de « salaire » a été critiquée par de nombreux auteurs socialistes. Ce fut notamment le cas de Karl Marx, le père de l’anti-capitalisme, en particulier dans son essai « Travail salarié et capital » (1849). Selon Marx, le salaire est la somme d’argent que « le bourgeois » verse aux travailleurs « pour un temps de travail donné ou pour un certain travail fourni. Ainsi, le bourgeois achète leur travail avec de l’argent. Eux, c’est pour de l’argent qu’ils lui vendent leur travail. (…) Le travail est donc une marchandise, ni plus ni moins que le sucre. »[3] « La valeur d’échange d’une marchandise, chiffrée en argent, c’est précisément ce qu’on appelle son prix. Le salaire n’est donc que le nom spécifique donné au prix du travail, au prix de cette marchandise particulière dont l’unique réservoir est la chair et le sang de l’homme. »[4]

Cette description de Marx est encore tout à fait d’actualité, même si le contexte socio-économique a évolué depuis en Occident avec la désindustrialisation et « l’ubérisation » de l’économie notamment. Dans le secteur tertiaire, cette relation de subordination et d’aliénation due à la marchandisation du travail est moins visible que dans les industries du 19e siècle, mais la création tous azimuts de départements de « ressources humaines » dans les entreprises et organisations employant du personnel, témoigne néanmoins de la survivance des fondamentaux analysés par Marx. En outre, il va sans dire que cette réalité est poussée à son extrême dans les usines de production établies dans les pays asiatiques, conséquence directe de la délocalisation des industries occidentales dans la deuxième moitié du 20e siècle, et de la division du travail entre les nations qui a résulté de ce processus.

La relation salariale, c’est-à-dire la marchandisation du travail, est née en Angleterre lors de la révolution industrielle. Auparavant, d’autres formes de domination existaient, mais le travail n’était pas en lui-même incorporé à l’économie, c’est-à-dire échangeable sur le marché du travail. Seuls les produits du travail l’étaient. C’est ce que reconnaît d’ailleurs Marx : « Le travail n’a pas toujours été une marchandise. Le travail n’a pas toujours été du travail salarié (…). L’esclave ne vend pas son travail au maître, non plus que le bœuf ses services au paysan. (…) Le serf appartient à la terre et il rapporte des fruits au maître. Le travailleur libre, en revanche, se vend lui-même, et se vend au détail. Il met aux enchères 8, 10, 12 ou 15 heures de sa vie, c’est-à-dire une journée que rien ne distingue d’une autre. Il l’adjuge à un propriétaire de matières premières, d’instruments de travail et de moyens de subsistance : ce sera le plus offrant des capitalistes. Le travailleur n’appartient ni au propriétaire, ni à la glèbe, mais 8, 10, 12 ou 15 heures de sa vie quotidienne sont à qui les achète. »[5]
Marx a sans doute décrit avec pertinence le processus de marchandisation du travail. Pour lui, il s’agissait d’un fait inhérent au système capitaliste, qui finirait par s’écrouler, miné par ses contradictions internes. Perspicace à bien des égards dans la description et l’analyse, Marx s’est cependant montré trop abstrait en matière d’imagination prospective. Il a donc été incapable de penser des solutions concrètes pour remédier aux problèmes qu’il observait.
Dans sa déclaration fondatrice de Philadelphie (1947), l’Organisation internationale du travail (OIT) stipule (dans son premier article) que : « Le travail n’est pas une marchandise ». Mais là encore, aucune réponse concrète n’est avancée sur la manière de s’y prendre pour « démarchandiser » le travail. C’est une réflexion qu’il faut désormais mener.

L’émergence de l’économie de plateforme, parce qu’elle sape les fondements sur lesquels a été bâti le pacte social négocié entre la gauche et les détenteurs traditionnels du capital, offre en effet une nouvelle occasion de réfléchir en profondeur à la nature réelle du travail et à sa signification pour les êtres humains. Dans ce contexte, il est évident que l’ubérisation de l’économie crée de la précarité et que les plateformes numériques doivent être encadrées par un dispositif juridique digne de ce nom. Mais un retour pur et simple au salariat, n’est sans doute pas la solution la plus adéquate pour y parvenir, dans le sens où elle ne permet pas de véritablement abolir l’aliénation inhérente à la marchandisation du travail pointée du doigt par Marx et l’OIT.
Aujourd’hui, de nombreux salariés sont, au moins sur le principe, favorables à une plus grande autonomie dans leur profession, avec des taux de travail réduits mais aussi des rémunérations variables et individualisées. C’est l’expression d’une critique du salariat qu’il importe de ne pas occulter. Pour Sophie Bernard : « Les réflexions sur des combinaisons favorisant l’autonomie dans le travail et préservant les droits et protections associés à la condition salariale sont anciennes. C’est bien le principe des coopératives de production (…). Au moment où l’institution salariale est attaquée de toutes parts, il est certainement temps de renouer avec ces réflexions pour lui redonner une légitimité et peut-être, à terme, la dépasser. »
[1] Sophie Bernard, “Salariat et capitalisme, la nouvelle donne”, Contretemps, 23 septembre 2020. Url: https://www.contretemps.eu/salariat-uber-nouvel-esprit/
[3] Karl Marx, Œuvres complètes, éd. Maximilien Rubel, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 1965, p. 203.
[4] Ibid.
[5] Ibid., p. 205.