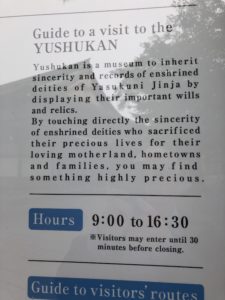Pierre Hazan
Chassé par les nouvelles technologies, le flipper est un jeu en voie de disparition. Il avait pourtant ses vertus. Le joueur devait imaginer comment les rebonds de la balle allaient provoquer de multiples effets. L’inculpation par la Cour pénale internationale (CPI) du président russe produit elle aussi ses effets comme au flipper, obligeant toutes les parties à réévaluer leur positionnement.
- Pour le gouvernement russe, l’humiliation est rude. Jusqu’ici, seuls une poignée de rebelles africains ont été condamnés par la CPI. Certes, Vladimir Poutine n’est à ce stade qu’inculpé pour déportation illégale d’enfants, mais cette inculpation– même traitée par le mépris par les autorités russes – est une gifle. Moscou a annoncé l’ouverture d’une enquête contre le procureur et les juges de la CPI pour « la décision illégale » de poursuivre le chef d’Etat russe. L’ex-président, Dmitry Medvedev, désormais coutumier des formules explosives, a proposé de larguer un missile hypersonique sur la Cour de la Haye. Moins délirant et plus inquiétant, l’annonce faite par la Russie, selon quoi elle va déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie, qui peut se lire comme un bras d’honneur du nouvel inculpé aux juges de la CPI et par-delà, à l’occident. Notons que les médias russes sont restés discrets sur l’inculpation de Vladimir Poutine à l’égard de leur propre population, signe de l’embarras dans lequel ils se trouvent.
- Pour la CPI, la guerre en Ukraine est – tragiquement – providentielle. Après vingt ans d’existence, la Cour n’avait condamné pour crimes de guerre que cinq rebelles africains, tout en coûtant des centaines de millions de dollars. Même ses plus fervents supporters pouvaient difficilement justifier une Cour, qui était perçue comme menant une politique de deux poids, deux mesures. L’inculpation de Vladimir Poutine remet la CPI au centre du jeu. Mais quel poids – autre que symbolique, même si cela compte aussi – faut-il attacher à l’inculpation du président d’un État membre permanent du Conseil de sécurité ? Cela se traduira-t-il par une dangereuse fuite en avant, ou au contraire, cela calmera-t-il les ardeurs guerrières du Kremlin ? Quid encore de la reconduction de l’accord russo-ukrainien sur l’exportation des céréales dans un mois et demi, dont dépendent les populations les plus pauvres de la planète ? Autant de questions qui restent ouvertes, de même que la question de savoir quels pays accepteront de recevoir sur leur sol Vladimir Poutine, outre la Chine.
- Pour les diplomates occidentaux, derrière la satisfaction de façade affichée, cette inculpation complique la recherche d’une bien hypothétique solution politique. Les statuts de la CPI permettent une certaine flexibilité (articles 16 et 53) pour geler, voir même abandonner les poursuites contre Vladimir Poutine au nom « de l’intérêt des victimes » ou d’un éventuel processus de paix, mais ces articles sont difficiles à mettre en œuvre. D’où l’intérêt renouvelé aujourd’hui autour de la solution dite du « 38ème parallèle », qui – sans accord de paix – sépare la Corée du Nord de celle du Sud depuis 1948, et qui pourrait préfigurer une « solution sans solution » dans le conflit en Ukraine. Celle-ci prendrait la forme d’une guerre gelée ou de basse intensité sur une ligne de front stabilisée.
- Pour l’Ukraine, l’inculpation de Vladimir Poutine est naturellement une excellente nouvelle, dans la mesure où elle contribue à délégitimer l’agression russe et à reconnaître les crimes commis. Le pouvoir et la société civile à Kyiv ne croyaient guère que la CPI allait intervenir si rapidement et, encore moins, qu’elle allait viser directement le chef d’Etat russe. C’est pourquoi le gouvernement ukrainien, appuyé par des ONG, a lancé une offensive diplomatico-juridique pour créer un tribunal spécial sur le crime d’agression. Vont-ils poursuivre cette voie-là ? Oleksandra Maviitchouk, dont l’organisation the Center for civil liberties fut lauréat du prix Nobel de la paix 2022, assure que la nécessité de poursuivre Vladimir Poutine pour le crime d’agression reste intacte. Mais on peut sérieusement s’interroger si l’appétit des gouvernements occidentaux de financer un tribunal spécial ad hoc anti-Poutine existe toujours après son inculpation par la CPI.
- La Cour pénale internationale se trouve désormais devant un choix existentiel : soit, par cette inculpation, elle reste le bras juridique de l’OTAN, et à ce titre, son ambition de représenter la communauté internationale s’effondre. Soit le procureur choisit une stratégie pénale qui frappe aussi des dignitaires d’États occidentaux ou leurs alliés, qui se seraient rendus coupables de crimes internationaux. On se souvient que l’une des premières décisions de l’actuel procureur, Karim Khan, a été de « dépriorétiser» les poursuites contre les possibles crimes de guerre commis par l’armée américaine et la CIA en Afghanistan. Charge à lui de faire la démonstration que la juste internationale s’est dotée d’un procureur libre et impartial.