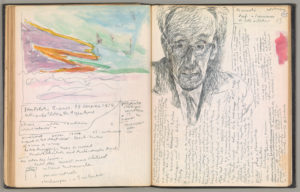Les Éditions Noir sur Blanc ont publié récemment Zahhâk, le roi serpent de Vladimir Medvedev, traduit du russe par Emma Lavigne. Un roman qui peut sembler aussi exotique au lecteur russophone qu’au lecteur francophone.
L’action de Zahhâk (paru en 2017 en Russie) se passe dans les années 1990, alors que la guerre civile fait rage au Tadjikistan. Bien que les événements décrits soient parfois terribles, il est impossible de lâcher ce livre captivant. En vous le recommandant sincèrement et en espérant qu’il produira sur vous une impression tout aussi forte, je souhaite vous livrer la transcription de mon entretien avec son auteur, traduit par Ève Sorin.
Vladimir, la génération de Soviétiques ayant assisté à l’effondrement de l’URSS est particulière : leur vie se divise nettement en un « avant » et un « après ». On sait bien qu’aujourd’hui, trente ans après les faits, beaucoup accusent encore les signataires des accords de Belovej – qui, rappelons-le, ont entériné la dissolution de l’URSS le 8 décembre 1991. L’indépendance obtenue par les différentes ex-Républiques soviétiques n’a pas apporté à tous leurs habitants la liberté et la prospérité. En revanche, beaucoup ont eu à endurer des guerres civiles. Comment évoqueriez-vous le Tadjikistan, un pays producteur de minerais à l’histoire riche et ancienne ?
Lorsque nous parlons du Tadjikistan, il faut d’abord se rappeler qu’il souffre jusqu’à présent d’un syndrome post-traumatique. Il a subi la guerre civile la plus sanglante de toutes celles qui ont éclaté dans l’espace postsoviétique, sur les décombres de l’URSS.
Il est impossible de dénombrer précisément les victimes, principalement des civils pacifiques. Les estimations des analystes varient du simple à plus du double : de 60 000 à 150 000 morts. Ces chiffres pourraient être revus à la hausse si on recensait les disparus : il est probable qu’une partie d’entre eux ont été tués. Longtemps après la fin des opérations militaires, des corps d’hommes, de femmes, d’enfants ont été retrouvés, ensevelis seuls ou à plusieurs, dans des ravins pierreux, des rivières de montagne, dans la terre, sous des trappes de canalisations… D’autres ont fui. Droit devant, là où leurs pas les menaient. En Afghanistan, en Ouzbékistan, en Kirghizie, en Russie…
Je ne vais pas énumérer les conséquences évidentes de la sortie de l’Union et de la guerre civile, telles que l’effondrement général, la destruction des liens sociaux, etc., qui d’un seul coup ont plongé des gens simples dans la pauvreté et en ont contraint beaucoup à aller chercher du travail hors des frontières.
Pour la génération plus âgée, le choc qu’a provoqué la guerre civile s’est superposé au bouleversement qu’ont ressenti une majorité de Tadjiks lorsque l’URSS s’est écroulée. Essayez de vous mettre à la place de ces gens, qui avaient voté en faveur du maintien de l’Union soviétique, d’où Eltsine et ses acolytes n’ont pas tardé à retirer en douce les républiques slaves, détruisant du même coup tout le système. Les Tadjiks ont eu la sensation d’être trahis, relégués hors de la communauté, privés de leur participation à une grande puissance et abandonnés à leur sort. Imaginez leur amertume, leur humiliation, leur désarroi…
Il existe cependant un sentiment encore plus douloureux et plus profond, qu’éprouvent non seulement les plus âgés mais aussi les jeunes. La culturologue Goulrouhsor Mamourova appelle cela le « déficit de grandeur ». Cette analyse est à mes yeux d’une telle importance que je voudrais citer un extrait de l’un de ses articles. Elle écrit : « Les Tadjiks sont un peuple qui doit se redécouvrir, prendre conscience du legs de son passé, et qui souffre d’un déficit de grandeur, ce qui est légitime au vu de son histoire… Ce déficit de grandeur à l’origine d’un sentiment d’infirmité est un complexe d’infériorité, juste ou erroné, que l’on trouve ouvertement, de façon consciente, ou de façon dissimulée, inconsciente, chez les adultes et les jeunes du Tadjikistan. » (La formule « ce qui est légitime au vu de son histoire » est malheureuse. En réalité, le Tadjikistan, par son histoire ancienne, sa culture, ses penseurs et ses poètes, a droit à la grandeur.)
L’idéologie du pouvoir officiel fait du Tadjikistan contemporain l’héritier de l’Empire des Samanides. En même temps, le pays n’a pas rompu le lien symbolique avec son passé soviétique, que ses voisins d’Asie centrale, hormis la Kirghizie, appellent le « joug communiste » ou la période de la « colonisation soviétique ». Malgré tout, la grandeur du passé, de l’Antiquité ou de l’époque soviétique, ne suffit pas pour venir à bout de ce « déficit ».
Je veux espérer que le Tadjikistan se débarrassera de ce complexe, de même que de ses maux et malheurs.
Quand avez-vous quitté le Tadjikistan pour Moscou, et pourquoi ?
Ma femme et moi nous sommes installés à Moscou il y a trente ans exactement, à la suite du « février noir » de 1990 – ces troubles massifs et dramatiques qui ont secoué Douchanbé, fomentés par des autorités claniques ou criminelles. À l’époque, toute personne vivant au Tadjikistan comprenait, je crois, que ces débordements étaient de mauvais augure. Notre fille était alors adolescente, et une jeune fille n’a pas sa place là où peuvent éclater à tout moment des pogroms, des émeutes, des pillages… Ça s’est passé comme ça. Deux ans plus tard, c’était la guerre civile. Entre-temps le Tadjikistan avait perdu près de 300 000 habitants « non natifs » : des Slaves, des Tatars, des Caucasiens, des Juifs, des Allemands, des Tchouvaches, des Coréens… Impossible d’en dresser la liste. Les Ouzbeks, qui avaient où aller, sont partis. Un certain nombre de Tadjiks aussi.
Et il s’est passé quelque chose de remarquable : Douchanbé est devenu un modèle sans précédent de courage et d’auto-organisation de ses habitants. Au début des troubles, dans une allocution télévisée, le chef d’État, Qahhor Mahkamov, a déclaré à la population : « Nous ne pouvons pas vous protéger. Défendez-vous par vos propres moyens. » Il faut le reconnaître : tous les dirigeants ne sont pas capables de faire un tel aveu. S’il s’était tu, il est très probable que les gens auraient continué de croire que le pouvoir allait les défendre. Sachant qu’ils ne trouveraient pas d’aide, les habitants de Douchanbé ont pris leur destin en main. Dans tous les quartiers, dans toutes les cours d’immeubles, les hommes se sont réunis en brigades d’autodéfense pour protéger leurs familles. Avec les « non-natifs » (je suis une nouvelle fois obligé d’employer ce terme que je n’aime pas), les citadins tadjiks faisaient des tours de garde. À bien des égards, ce sont les villes et les campagnes qui se sont affrontées, dans la mesure où les instigateurs des troubles faisaient venir à Douchanbé un nombre croissant de combattants des kichlaks proches ou éloignés. Cette vague de violence a été stoppée par les tanks que le pouvoir central a transportés de Biélorussie au Tadjikistan par voie aérienne.

Les ex-Républiques soviétiques sont les États les plus « récents » issus des anciennes colonies, mais les relations entre elles et le « colonisateur » se développent de façon peu traditionnelle. Le russe a très rapidement perdu du terrain, bien que Pouchkine et Tolstoï ne soient en rien responsables. Comment l’expliquez-vous ? Par une réaction de rejet due à l’identification de la langue au régime politique ou, comme me l’a dit dans une interview le président, à l’époque, du comité des affaires internationales de la Douma, Konstantin Kossatchev, par l’imprévoyance de la politique russe ?
Je pense que Konstantin Kossatchev a raison. Il s’est juste exprimé par euphémisme. Longtemps le pouvoir russe a fait preuve d’une indifférence totale à la diffusion de la langue russe dans les pays environnants. Fut un temps où il était difficile de trouver au Tadjikistan une personne incapable de parler russe, même si c’était de façon rudimentaire. Seules les femmes des kichlaks retranchés au fin fond du pays n’en connaissaient pas un mot, bien qu’elles aussi soient allées à l’école où l’on enseignait le russe. Aujourd’hui le niveau de connaissance du russe, inscrit dans la Constitution du pays en tant que langue de communication interethnique, chute non seulement dans les régions périphériques mais aussi dans la capitale. Surtout parmi les jeunes. L’ambassadeur de Russie au Tadjikistan, Igor Liakine-Frolov, rapporte ceci : « Au marché, vous vous adressez à des jeunes gens d’une vingtaine d’années, mais ils ne parlent pas russe. Ils ne connaissent même pas les chiffres. Ils ne peuvent pas vous renseigner sur le prix de la marchandise… »
Je ne sais pas quand on finira par se ressaisir du côté russe, quand on tentera de rectifier cet état de fait. Il y a dix ans, alors que je me trouvais au Tadjikistan, on pouvait déjà observer un certain travail dans cette direction. Mais, pour autant que je sache, rattraper ce qu’on a laissé échapper demande des moyens et du temps.
Pendant soixante-dix ans et quelques, on nous a raconté que le pouvoir soviétique favorisait le développement des « provinces ». Mais, en lisant votre roman, on oublie par moments que l’action se passe dans les années 1990, et pas à l’époque de Gengis Khan : tant de descriptions paraissent d’une telle sauvagerie. L’Orient, qui, comme on le sait, est une région du monde subtile, a l’air monstrueusement fruste, d’une cruauté moyenâgeuse…
En temps de guerre, a fortiori de guerre civile, l’Orient n’est pas le seul à paraître monstrueusement fruste et cruel, n’importe quelle région du monde le devient. Nul besoin d’aller très loin pour trouver des exemples de cruauté moyenâgeuse au xxe siècle. Le Tadjikistan ne fait pas exception : il confirme la règle. Si j’avais raconté des événements en temps de paix, la couleur locale aurait été tout autre.
En tant que femme, je ne peux pas éviter la question du genre. Parmi de multiples réflexions sur la « condition des femmes », la plus significative c’est une de vos phrases disant qu’on ne demande pas un kalin considérable – le prix à payer pour une mariée – si l’épousée vient de la ville. Aussitôt tout devient clair. Est-il possible qu’au xxie siècle il y ait encore des mariages imposés, avec tout ce que cela implique ?
Au xxie siècle, il y a bien des choses encore plus effrayantes. Par exemple, le trafic d’organes, pour lequel on enlève des gens que l’on tue comme des animaux sauvages ou du bétail. Ou encore l’esclavage. D’après les estimations de Walk Free, il y aurait aujourd’hui près de 40 millions d’esclaves dans le monde. Les mariages forcés ne sont pas le pire des maux.
Il serait plus juste, me semble-t-il, de parler de mariages arrangés par les parents. Sont-ils pour autant toujours mauvais ? Cela dépend si le père et la mère sont prêts à respecter les sentiments de leurs enfants. C’est un mal si une jeune fille doit se séparer de celui qu’elle aime, ou si un jeune homme doit épouser une autre que l’élue de son cœur. Mais si les jeunes gens n’ont de vues sur personne, cela leur permet de trouver leur compagnon ou leur compagne bien plus facilement. En outre, les adultes tiennent compte de ce que les jeunes, eux, ne comprennent pas encore, du fait du bouillonnement hormonal et du manque d’expérience.
Si les parents sont motivés par l’appât du gain, c’est une tout autre histoire. Et c’est répugnant.
J’ai beaucoup apprécié les multiples narrateurs de votre récit, comme si l’action était filmée par plusieurs caméras, tour à tour. Les différences d’intonation, de style, les particularités langagières sont merveilleusement bien rendues… Avez-vous fait un travail particulier pour y parvenir ou cela vous est-il venu « naturellement » ?
Je ne me souviens plus comment et pourquoi je me suis mis à écrire en adoptant différents points de vue narratifs. Je ne saurais expliquer pourquoi c’était indispensable. Il semblerait donc que cette construction ait bien dû surgir toute seule.
On dit qu’un bloc de marbre informe renferme déjà la sculpture à venir – il faut seulement retrancher le superflu. J’ai eu maintes fois l’impression que Zahhâk existait déjà quelque part, dans le néant, sous une forme aboutie, et qu’il suffisait de l’en extraire. À mesure que le roman progressait, des images ou des épisodes isolés commençaient soudain à s’emboîter, comme si des liens, des renvois se formaient… Lors de l’écriture, je n’avais songé à rien de tel.
Par exemple, le passage où Karim la Courge attrape un serpent blessé qui s’enfuit préfigure en quelque sorte sa victoire sur Zahhâk, même si, lorsque j’ai écrit cette scène, je n’imaginais pas un seul instant que lui, ce petit gars, allait anéantir le tyran. De même, le crâne qu’Andreï exhume dans les premières lignes du roman annonce les manipulations de la tête coupée de Zouhourcho dans les derniers chapitres. Pourtant je ne savais même pas qu’il serait décapité. En quoi aurais-je eu besoin de cette trouvaille, pour quoi faire ? Pour rien. Qui plus est, si j’avais cherché un effet facile, cet épisode aurait été de mauvais goût. Mais pour une raison que j’ignore, je ne pouvais vraiment pas me passer de ce crâne. À croire que sans lui il y aurait eu un vide, certes infime, dans la structure du roman. Comme si cette structure préexistait à l’écriture.
Si je raconte tout cela, c’est pour trouver quand même une explication à la pluralité des voix. Pas une seule explication d’ailleurs, mais plusieurs. En voici une. Chacun des narrateurs présente une certaine stratégie dans ses relations avec le pouvoir. De l’obéissance résignée, aveugle, à la résistance farouche et au refus de se soumettre, même au péril de sa vie. Je me suis efforcé autant que possible de chercher ces stratégies de l’intérieur. C’est sans doute pour cette raison que je n’ai pas inclus Zouhourcho au sein des narrateurs : il est le détenteur du pouvoir, autrement dit un objet, pas un sujet. L’objet ne doit pas avoir de voix. Bien sûr, mes réflexions sont plutôt une tentative de rationalisation.
Quant aux intonations, elles sont apparues d’elles-mêmes. Je n’ai pas essayé de me glisser dans la peau d’un narrateur, de sentir les choses comme un de mes personnages. Ils parlaient de façon autonome, je ne pouvais pas les forcer à « délier leur langue ». Il fallait se brancher sur une longueur d’onde particulière pour que le discours naisse spontanément. Certains épisodes de Zahhâk n’ont pas été écrits, je les dictais sur un magnétophone en me promenant dans les bois ou les prés. Une fois, j’ai remarqué qu’inconsciemment la voix, le ton que je prenais en dictant appartenaient au personnage à qui je faisais endosser le discours. Donc, malgré tout, je me glisse dans la peau de celui qui n’existe que dans mon imagination, et il relate son histoire avec ma voix, comme le mort qui se fait entendre à travers les lèvres de la vieille chamane dans Rashōmon de Kurosawa.
Le développement tumultueux des événements dans le roman fait aussi place à des réflexions intéressantes et profondes sur des questions générales, notamment la nature du pouvoir et ses rapports avec ses administrés. Peut-on par exemple expliquer la longévité de certains dirigeants par la peur qu’ils inspirent ou, comme vous l’écrivez : « La chute de ce tyran taré entraînerait sûrement des troubles et l’homme qui prendrait le pouvoir pourrait s’avérer encore plus cruel et incontrôlable que son prédécesseur » ? Autrement dit, les gens préfèrent un « diable qu’ils connaissent déjà », et craignent par-dessus tout le changement ?
Ce n’est pas un hasard si j’ai choisi de situer l’action dans un petit défilé montagneux presque isolé du monde extérieur. Dans cette situation, le « pouvoir » et ses « sujets » sont en contact étroit. Au sein d’un grand État, ils habitent, pour ainsi dire, dans des mondes différents. Mais sous l’autorité d’un commandant de division, la vie se borne à un petit espace. Le tyran et la plèbe vivent dans des maisons voisines et se croisent tous les jours. C’est justement cette fréquentation directe, immédiate, avec les « autorités » et leur violence à découvert, sans fard, qui contraint en permanence les personnages à faire un choix – se soumettre ou résister à la contrainte… Et seule l’exiguïté de l’endroit permet au petit paysan d’évincer le « tyran taré ».
Si l’on élargit les frontières du défilé jusqu’aux dimensions d’un pays, même petit, alors je ne vois pas de quelle façon le peuple peut influer sur le règne d’un despote. Indépendamment du fait que les gens aient peur des changements ou qu’ils y aspirent. Le maintien des autocrates dépend des très riches, des très forts. Ce sont eux qui utilisent la rage et le mécontentement des masses, qu’ils attisent eux-mêmes le plus souvent. Sans eux la fureur populaire est impuissante, je suppose. En tout cas, l’histoire n’a pas fourni d’exemples du contraire.
Encore une citation : « […] le principal dans l’art de gouverner : contrôler non les actes, mais le désir des sujets, afin que leur désir contrôlât à son tour leurs actes. » On notera qu’il ne s’agit pas là de la réflexion d’un cadre du Parti, mais de l’eshan Vahhob, un représentant du pouvoir spirituel. Pensez-vous que dans l’espace postsoviétique certains leaders laïques se servent aujourd’hui de la spiritualité afin de « contrôler les désirs » des gens ?
Je crois qu’en Asie centrale c’est un peu plus complexe. Le pouvoir temporel ne peut collaborer qu’avec les autorités religieuses « officielles », prêchant un islam « traditionnel ». Mais ce n’est que la partie émergée de l’iceberg. Il existe aussi au moins deux courants que le pouvoir n’est pas en mesure d’influencer. Ce sont les wahhabites, dont l’un des objectifs est de détruire l’État laïque. Il ne peut être question de les influencer, puisque le dialogue est impossible. Ce sont aussi les cheikhs soufis, qui peuvent exercer par eux-mêmes une influence sur les représentants du pouvoir. Y compris secrète. Mahdoumi Sangi Kouloula, l’un des piliers de la tariqa naqshbandiyya, une confrérie soufie, en est un exemple célèbre. À ses funérailles, en 1968, se sont rassemblés des dizaines de milliers de disciples venus de toute l’Asie centrale. Il y avait parmi eux quantité de fonctionnaires du Parti et de l’État, ses anciens mourides. En conséquence, cinq mille d’entre eux auraient été exclus du parti communiste et limogés. Pour comprendre le niveau d’influence d’un eshan sur ses adeptes, il suffit de rappeler l’adage : « Un mouride entre les mains de son cheikh est pareil à un cadavre entre les mains du laveur de morts. »
De nos jours, l’influence des cheikhs soufis sur leurs disciples reste énorme, si tant est qu’elle ne s’accroisse pas.
Beaucoup de politologues et de sociologues observent qu’à notre époque ceux qui accèdent au pouvoir sont médiocres, et pas seulement dans l’espace postsoviétique. Vous avez appelé votre roman Zahhâk, du nom d’un tyran inique et oppresseur, dont Zouhourcho, sanguinaire et arriéré, exploite l’image pour « non seulement faire peur aux gens, mais réveiller en eux une terreur lointaine, mystique ». Dans cette région du monde, un pouvoir qui ne reposerait pas sur la peur serait-il vraiment impossible ?
Zouhourcho est justement un de ces médiocres que vous évoquiez. J’ai mis longtemps à décider qui il était. Sur quoi se fonde son pouvoir ? Dans mes brouillons, il ressemblait d’abord à un singe cannibale effrayant. Puis j’ai été attiré par l’image du cochon, finalement j’ai décidé qu’un cochon n’était pas assez terrifiant. Et si c’était un théromorphe ? Un tyrannosaure. Il m’a paru important de le représenter non comme un être humain mais comme un alien, qui parlerait comme un homme et en aurait l’apparence. Et moi seul, son auteur, saurais qu’il est inhumain.
C’était séduisant et efficace. Mais cela ne correspondait pas du tout à la façon dont je conçois l’essence du pouvoir. En dernière instance, j’ai décidé que Zouhourcho était le plus ordinaire des homoncules emportés par sa passion inextinguible pour le pouvoir. En outre, c’est un raté que ses lubies absurdes écartent de temps à autre de son objectif principal. Cependant, pour accéder au pouvoir aujourd’hui, le charisme est inutile. Le pouvoir lui-même fait la force, comme le tracteur confère de la force à celui qui le conduit. Nul besoin d’être vigoureux comme le bogatyr, le vaillant guerrier des épopées slaves d’autrefois. L’essentiel, c’est de savoir conduire un tracteur, le véhicule du pouvoir, et grimper à temps dans la cabine. Le reste fonctionne tout seul. Il faut juste veiller à ne pas se faire jeter hors de la cabine. Dans mon roman, la fonction du tracteur est remplie par les combattants menés par Davron…
Au début des années 1990, le pouvoir de l’État était en perte de vitesse, il perdait son influence et son contrôle sur ce qui était jusqu’alors dans sa sphère d’influence. L’auréole de toute-puissance qui l’environnait était en train de se dissiper. Les sociologues emploient une belle expression pour désigner ce phénomène : la « désacralisation du pouvoir ». Ainsi, en représentant Zahhâk, l’ancien apparatchik Zouhourcho cherche, consciemment ou inconsciemment, à « sacraliser » son image. Les oripeaux du brigand conviennent on ne peut mieux pour atteindre cet objectif, et le serpent est en soi un symbole puissant et polysémique, dont toutes les significations relèvent du domaine du sacré.
Ils ont désappris à aimer le pouvoir, qu’ils apprennent à présent à le craindre. Qu’ils éprouvent le frisson sacré… Mais Zouhourcho n’accède pas au sacré. Les paysans raillent en sous-main les clowneries maladroites du despote. Le rire dissimulé est l’une des formes de leur résistance passive. En même temps, bien qu’ils ne ressentent pas le frisson, ces hommes éprouvent de la peur, et pas qu’un peu.
Je suis convaincu que tout pouvoir est indissociable de la peur. Seules les formes du pouvoir diffèrent. Soit il menace directement les hommes, en exigeant l’obéissance, soit il assure leurs besoins primaires – la sécurité – tout en exigeant la même chose. Dans le premier cas, tout est clair. Dans le second, la peur s’accompagne de l’idée d’être privé de la protection du pouvoir et de se retrouver seul face à un monde de violence, de famine, de catastrophes et ainsi de suite. Donc, le pouvoir est inenvisageable sans la peur, quelle que soit la partie du monde où il s’exerce.
D’après ce que j’ai pu observer, les Russes s’intéressent peu au Tadjikistan et aux Tadjiks, à moins qu’il ne soit question de travailleurs immigrés. Je pense que l’inverse est tout aussi vrai. Peut-on faire quelque chose pour susciter un intérêt mutuel ? Et le faut-il ?
Le Tadjikistan a intéressé et intéresse exclusivement les Russes qui y ont vécu de longues années ou qui y sont nés. Aujourd’hui ils se le remémorent comme un paradis perdu. Russes et Tadjiks s’entendaient plutôt bien. Dans leur majorité, les Tadjiks sont de bons voisins, cela fait partie de leur culture. Et ce sont de bons amis. Aussi n’était-il pas rare que Russes et Tadjiks sympathisent. Entre collègues, entre voisins, entre ceux qui avaient des centres d’intérêt communs, comme les échecs ou la chasse… Cependant chaque peuple restait en quelque sorte de part et d’autre d’une cloison de verre. Le système complexe, stratifié, de la vie privée des Tadjiks restait hermétique pour un Russe. On ne laissait entrer que les siens, et pour en faire partie il fallait être né tadjik. L’amitié était possible seulement sur un terrain culturel neutre, à la frontière entre les deux cultures, et de chaque côté, les représentations les plus générales, les plus superficielles, sur les traditions, la bienséance, les particularités nationales de l’autre étaient suffisantes. Une chose est tout de même remarquable. Malgré cette fréquentation « à travers une paroi de verre », les Russes, même ceux qui ne connaissaient pas un mot de tadjik, ont assimilé beaucoup de choses des Tadjiks. L’« aura » tadjike est souvent quasi insaisissable, mais elle est toujours présente. Dans la manière de s’exprimer, la façon de considérer les autres, les règles de bienséance…
Pour l’essentiel, le public russe ne s’est jamais particulièrement intéressé à l’Asie centrale. Ni à l’Orient en général. La littérature russe a trouvé son amorce orientaliste dans le Caucase. Lorsque, au début du xixe siècle, le romantisme a eu besoin de l’Orient et d’un héros romantique, le Caucase lui a fourni l’un et l’autre.
C’est ce qui explique sans doute qu’après les guerres du Caucase, quand a commencé la conquête de l’Asie centrale, la littérature russe n’ait presque pas prêté attention aux événements et à ces contrées. Dans la seconde moitié du xixe, on a écrit des œuvres brillantes : des recherches historiques et des mémoires sur les opérations militaires en Asie centrale, des descriptions du quotidien et des mœurs des peuples centre-asiatiques, des comptes rendus ethnographiques et d’autres choses du même genre. Mais pas le moindre roman « centre-asiatique ». Je ne peux même pas citer de mémoire des récits ou des nouvelles. Peut-être parce que le flot romantique s’était tari, et que les temps du réalisme critique étaient venus. La Russie s’est tournée vers elle-même, à la recherche de son identité. Les problèmes vitaux dont la littérature s’est emparée étaient si cuisants, si urgents qu’il ne pouvait plus être question des confins de l’Empire, lointains et allogènes.
Le Tadjikistan n’a suscité d’intérêt chez les Russes instruits qu’à l’époque soviétique – temporairement, au cours des années 1930. Des brigades d’écrivains de Moscou ou de Léningrad visitaient ce territoire montagneux. Y participaient des auteurs alors très célèbres : Boris Lapine, Zakhar Khatsrevine, Sergueï Borodine, Nikolaï Tikhonov, Vladimir Lougovskoï, Leonid Soloviev, Boris Pilniak, Victor Chklovski… Deux livres sur le Tadjikistan – L’homme change de peau de Bruno Jasieński et Nisso de Pavel Louknitski – sont devenus des best-sellers. Dans le ton de l’époque, bien entendu… Aujourd’hui il est peu probable que le lecteur russe se souvienne ne serait-ce que des noms de ces auteurs. Une exception : Leonid Soloviev avec son récit sur Nasreddin Hodja. La littérature est une denrée périssable.
Il y a eu une lueur d’intérêt pour le Tadjikistan lorsque, ces années-là, le pouvoir soviétique a commencé à aménager les infrastructures de ce pays montagneux à l’aide de bâtisseurs, d’ingénieurs, de médecins, de chercheurs, d’enseignants russes… À leurs côtés œuvraient des Tatars, des Juifs, des Arméniens, des Ukrainiens, des Biélorusses et les Tadjiks eux-mêmes – encore une fois, je ne ferai pas d’inventaire, mais les Russes étaient l’épine dorsale.
Avant de construire des centrales électriques, des usines, des hôpitaux, des écoles, des canaux, il fallait vaincre la malaria qui décimait encore la population. Elle a été éradiquée grâce à l’abnégation de médecins russes. De la même façon qu’a été anéantie la lèpre dont avaient souffert quantité de gens, surtout dans le Badakhchon ou le Darvoz. La variole, la peste, le choléra ont disparu, la mortalité infantile a baissé. La population du Tadjikistan a commencé à croître en progression régulière. Puis ont été construites les usines, les fabriques, des routes ont été tracées, les canaux d’irrigation prolongés… Je m’arrête là, on pourrait poursuivre à l’infini. En lieu et place d’un petit kichlak poussiéreux s’est dressée une belle ville, une capitale, où l’on a créé des théâtres, une philharmonie, les studios de cinéma « Tadjikfilm », une Académie des sciences avec ses chercheurs tadjiks de niveau européen. Et le plus important : des cadres nationaux ont été formés dans tous les domaines, industriel et agricole, culturel, éducatif et scientifique. En quittant le Tadjikistan, les Russes pouvaient s’enorgueillir de ce qu’ils y laissaient.
Mais qui, en Russie, s’en souvient aujourd’hui ? S’en souvient-on au Tadjikistan ? Même les romans « centre-asiatiques » écrits au début de ce siècle sont publiés pour des raisons fortuites, extérieures ; leurs auteurs sont nés en Asie (à l’exception d’Evgueni Tchijov). Et pourtant ils méritent d’être cités. Bien entendu, en premier lieu, la prose ornementale de Timour Zoulfikarov, Khourramabad d’Andreï Volos, Récits de Tachkent de Soukhbat Aflatouni, Traduction littérale d’Evgueni Tchijov…
Il est peu probable que l’on s’intéresse plus au Tadjikistan dans un avenir proche, sans parler du fait que près d’un million de Tadjiks vivent et travaillent en Russie. De même qu’il est peu probable, en retour, que les Tadjiks s’intéressent à notre pays. Ces deux peuples vivent dans des conditions trop difficiles et se préparent à des épreuves plus grandes encore qui les empêchent de faire preuve de curiosité envers ce qui n’est pas directement lié à leur survie.
On peut à loisir interpréter différemment n’importe quel ouvrage. En Russie, le récent scandale autour de la série inspirée du roman Zouleikha ouvre les yeux de Gouzel Iakhina (Éd. Noir sur Blanc, 2017) illustre le fait que, même après avoir reçu de nombreux prix, on n’est pas épargné par la « colère du peuple ». Que pensez-vous des réactions qu’a suscitées votre roman et a-t-on tenté de vous reprocher d’attiser les « haines interethniques » ?
Il y a eu des lecteurs – ils sont peu nombreux, tant mieux – à qui Zahhâk a profondément déplu. C’est normal. Contrairement à un vêtement branché fabriqué en taille unique, un livre ne peut pas convenir à tout le monde : à des gens dont l’intelligence, le tempérament, le bagage culturel sont différents, qui ont des convictions opposées, etc. On a donc mentionné mon roman en des termes divers… Mais personne ne s’est aventuré à parler de haine interethnique. Dans mon livre, Russes et Tadjiks considèrent beaucoup de choses de façon différente, ils ne se comprennent pas, le plus souvent du fait de leurs différences culturelles, mais je me suis efforcé de ne pas me positionner d’un côté. J’éprouve une profonde sympathie et de la compassion pour les uns et les autres, et j’espère avoir su l’exprimer dans mon roman.
Certes, la réception de mon livre par les lecteurs tadjiks m’a préoccupé. Allaient-ils estimer que j’avais mal compris ou que j’avais dénaturé l’identité tadjike, que j’avais inventé beaucoup de choses, etc. ? J’étais certain de ne pas avoir déformé la vérité, mais quand même… Le dernier mot leur revenait.
On pourrait sans doute trouver des lecteurs indignés, qui voient mon livre comme une agression de la part d’un étranger, voire une ingérence culturelle empreinte d’impérialisme dans leur vie nationale, leur vie intérieure. Dans ce cas, la plus petite inexactitude, la moindre fausse note servirait à prouver que je n’avais pas le droit de me mêler de ce qui m’est étranger.
Je peux affirmer avec fierté que les avis que j’ai recueillis sont plus que positifs. Je reprendrai l’opinion qu’un lecteur tadjik a formulée dans sa critique sur le site « Proza.ru » : « Qu’un écrivain non tadjik ait pu parler ainsi des Tadjiks, c’est incroyable. Sentir de cette façon, dans toute leur épaisseur, les relations entre Tadjiks, les relations entre les hommes et les femmes au Tadjikistan, le rapport des Tadjiks au monde d’en bas (du quotidien) et à ce monde incompréhensible pour ceux qui n’y sont pas initiés. Pénétrer là où on ne laisse pas entrer les étrangers, et parfois même les siens. Et surtout percevoir les traits les plus fins, les nuances et les effets, qui ont l’air si peu perceptibles, mais qui sont si importants dans notre vie de tous les jours. »
Il me semble que c’est la meilleure réponse à votre question sur l’exaspération des désaccords interethniques.
Votre roman est-il traduit en tadjik, ou du moins est-il prévu qu’il le soit ?
Je crois peu probable que Zahhâk soit un jour traduit en tadjik. Ce roman ne s’accorde pas avec les mythes officiels, il ne se conforme pas au style dans lequel on attend que soient décrits les événements de cette époque. Et je ne crois pas qu’il puisse être grand public. Les Tadjiks sont un peuple romantique, la plupart d’entre eux attendent une littérature d’un tout autre genre.
Pour bien faire comprendre ce que je veux dire, je me référerai au remarquable professeur de théâtre Boris Bibikov, qui a formé une pléiade de brillants comédiens de théâtre et de cinéma. Ses élèves ont fait de grandes carrières dans le cinéma soviétique et russe : Nonna Mordioukova, Roufina Nifontova, Maïa Boulgakova, Viatcheslav Tikhonov, Nadejda Roumiantseva, Svetlana Droujinina, Leonid Kouravlev, Sofiko Tchiaoureli, Ekaterina Savinova… Au début des années 1930, Bibikov a participé à un projet culturel unique : des studios nationaux ont été créés auprès du GITIS, le grand Institut d’art dramatique russe, et plusieurs sont devenus les foyers de théâtres nationaux. Ma femme et moi avons eu la chance d’enregistrer les souvenirs de Boris à la fin de sa vie, alors qu’il avait perdu la vue. J’ai retenu une de ses formules, très éclairante sur le caractère national tadjik : « La vie et le théâtre, dans les représentations des Tadjiks, ne s’assemblaient pas. La vie leur semblait un processus très prosaïque, quand la scène était digne de sujets nobles et d’émotions profondément romantiques. » Les Tadjiks qui étudiaient au studio n’aimaient pas s’exercer à jouer des scènes du quotidien, ils voulaient interpréter des empereurs, des divas, des penseurs, des héros… J’en déduis que c’est cette même représentation qui définit, pour beaucoup d’auteurs et pour le lecteur moyen, ce que doit être la littérature.
Le fait qu’un des personnages de Zahhâk, Sangak Safarov, soit un véritable héros populaire n’est pas sans importance non plus. Aujourd’hui, il n’est plus mentionné dans les discours, la presse et les médias officiels. Comme s’il n’avait jamais existé. Que je fasse allusion à Sangak dans mon roman paraîtra tout à fait malvenu.
Il y a d’autres raisons, mais elles sont mineures.
Y a-t-il une catégorie de lecteurs à qui s’adresse plus particulièrement votre roman ?
Je n’y ai jamais réfléchi, mais peut-être. Des gens ayant de l’esprit, du cœur, un horizon vaste, et qui cherchent à apprendre davantage et à comprendre le monde qui les entoure.
Vladimir Medvedev, Zahhâk, le roi serpent, traduit du russe par Emma Lavigne, Éditions Noir sur Blanc, Lausanne, 2019.