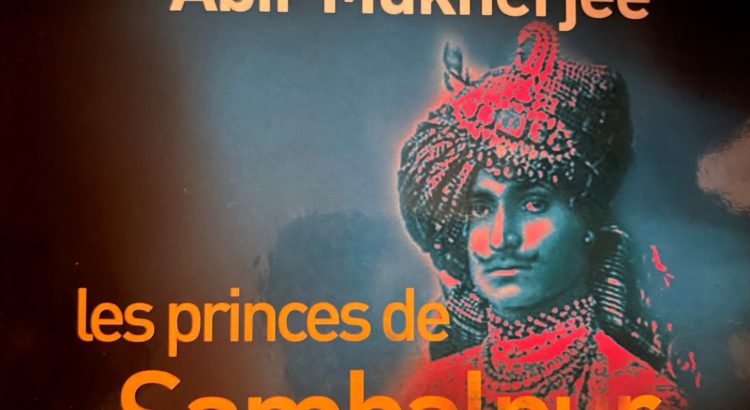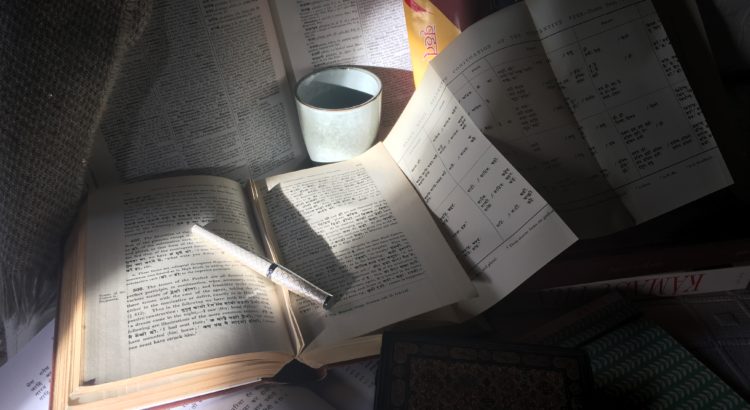Depuis sept ans maintenant, le printemps romand rime avec poésie. Cette année, le fruit et le goût sont à l’honneur dans un programme alléchant! La nature s’éveille, les mots des poètes, eux, participent à notre éveil!
La notion de goût, de saveur est au cœur même de la poésie indienne. « La poésie est une parole dont l’essence est saveur (rasa) » dit le rhétoricien et poète sanskrit du 14ème siècle, Vishvanatha.[1]
René Daumal, écrivain et poète français, explique : « On appelle Saveur la perception immédiate, par le dedans, d’un moment ou d’un état particulier de l’existence, provoquée par la mise en œuvre de moyens d’expression artistique. Elle n’est ni objet ni sentiment ni concept ; elle est une évidence immédiate, une gustation de la vie même, une pure joie de goûter à sa propre substance tout en communiant avec l’autre, l’acteur ou le poète. ». Il ajoute : « La Saveur est l’essence, le « soi » (ātman) du poème. »[2]
La métaphore culinaire est utilisée dans le premier ouvrage que nous connaissions qui définit cette notion : « Il est dit que rasa (la saveur) résulte d’une combinaison de différentes épices, légumes et autres ingrédients et les six saveurs [dont la principale est la saveur érotique] sont produites par des ingrédients comme le sucre brut ou les épices ou les légumes (…). Rasa est ainsi appelé car il est possible de le goûter. Et comment ? Il est dit que seules les personnes dont le palet est entraîné, pendant qu’ils mangent une nourriture préparée avec de nombreuses variétés d’épices sont capables de savourer leur goût et atteignent plaisir et satisfaction, de même, seules les personnes cultivées, capables qu’elles sont de percevoir les émotions qui se manifestent au travers des mots, des gestes et du style éprouvent plaisir et satisfaction en goûtant à la saveur de la poésie. »[3]
C’est ce rasa que nous recherchons lorsque nous ouvrons un recueil de poésie. C’est cette saveur que nous offre Le Printemps de la poésie.
La poésie de langue braj fait honneur à la saveur érotique, sa favorite! Dans les mots du poète Dev:
La belle du royaume de Kalinga.
De la passion du dieu de l’amour
elle est intoxiquée,
De sa bouche
des complaintes exhalées;
dans la chambre
ni apaisement, ni dissipation
des couleurs de la passion.
De son amant,
elle boit la beauté
à du nectar comparé ;
mais même ainsi,
elle reste assoiffée
si avec délectation
elle ne peut encore en goûter.
Prenant le contrôle de son bien-aimé
du rasa de l’amour abreuvé,
elle est enflammée.
Rien ne l’arrête :
ses lèvres goûter,
son corps griffer.
De tous ses membres exultant,
le dieu de l’amour créant,
la belle de Kalinga
des étreintes passionnées ne se rassasie pas. (RV 5.101)
Pour voyager dans les saveurs des mots de la Méditerrannée antique, de l’Inde prémoderne et de l’Europe médiévale, accompagné des accents de la vièle à archet et du chant médiéval, une soirée poétique, Fruits, épices et nectars, aura lieu au cœur de Lavaux.
[1] SāhityaDarpaṇa I.3.
[2] Daumal, René, Bharata. L’origine du théâtre. La poésie et la musique en Inde. Traductions de textes sacrés et profanes, Paris : Gallimard, 1970, p. 15 et 89.
[3] Nātyaśāstra VI.31, librement traduit en français à partir de la traduction anglaise de Manomohan Ghosh, 1951.
Image du bandeau: Torre Annunziata/Oplontis, villa de Poppée, triclinium (salle à manger, n°14), Adriano Spano, Dreamstime.com