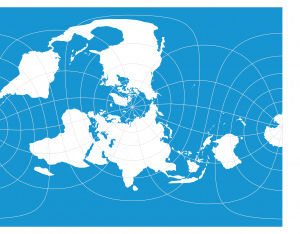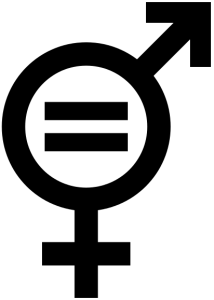Unbound, littéralement «délivré», est une entreprise éditoriale qui ne peut que fasciner. Intégrant le meilleur de la culture collective et interactive du Web, Unbound se décrit comme un éditeur permettant de donner vie à des idées, via le financement participatif.
Jusqu’à aujourd’hui, 97’521 personnes de 158 pays se sont engagées à verser 2,9 millions de livres sterling pour subventionner 169 livres, dont 5 ont gagné des prix littéraires et 4 sont devenus des best-sellers. On se réjouit de voir ici moult livres délivrés, unbound, dans un bel élan collectif.
Alors que nos auteurs tentent de rassembler de quoi payer leur ticket de train pour aller au salon du livre du coin, c’est ici le 50% des bénéfices qui vont à l’auteur. Synopsis, extrait, possibilité de discuter avec l’auteur sur un forum, tout est mis en oeuvre pour promouvoir une idée d’écriture. Mais c’est surtout la vidéo de présentation qui est en charge de faire la promotion de l’ouvrage à subventionner. Rêvez-vous de lire cette nouvelle post-apocalyptique, Tatterdemalion? C’est une vidéo qui vous en convaincra, musique et dosage émotionnel à l’appui. Et c’est là sans doute la pointe d’humour de l’entreprise: c’est le voir et l’entendre, l’image et le son, qui vendent l’écriture.
Unbound est peut-être en train de tellement bien «délivrer» le livre, que la plateforme pourrait conduire à aller plus loin qu’elle, de fait. Car, j’en suis convaincue, l’enjeu des transformations de la lecture n’est pas ce binôme tristounet «paper or not paper», qu’on nous rappelle régulièrement pour s’en réjouir ou s’en lamenter. Le digital nous met face à une autre radicalité: voir l’écriture devenir une forme d’expression parmi d’autres, provoquée sans cesse par l’image et le son, au sein d’une “littératie multimodale” pour le dire savemment, ou au sein d’une culture qui marie texte, image et son, pour le dire rapidement.
Sans flagornerie, je soulignerai ici combien ce journal qui accueille nos blogs se montre être à temps via les applications multimédia qu’il développe, les «labs». Elles me sont un excellent objet d’étude, à voir les journalistes à l’oeuvre de cette production multimodale: tantôt ils maintiennent ferme le leadership de la voix de l’auteur et conservent un goût pour la linéarité malgré tout, tantôt ils se livrent à des concurrences de points de vue, par exemple dans cette série où l’audio et l’écrit décidément ne vous brossent pas le même tableau. Je fais le pari qu’Unbound, ou son petit frère, offriront bientôt à leurs auteurs de pouvoir créer ce type d’objet culturel. Du côté artistique, certains foncent: allez donc voir/lire/entendre «où le monde double s’effondre» de l’écrivain François Bon. J’y reviendrai dans un autre blog.