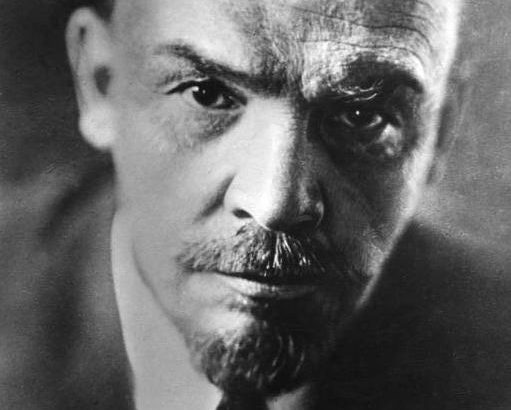Critique historique des dernières parutions en histoire
Parfait exemple d’un courant historiographique à la mode nommé avec emphase « Histoire globale », l’ouvrage dirigé par Pierre Singaravelou et Sylvain Venayre est une tour de Babel. Cette Histoire du monde au XIXe siècle fait appel, en effet, à 89 auteurs qui signent 94 contributions différentes portant sur des événements, des découvertes, des tendances, des réformes, des conquêtes, des pays et tant d’autres aspects connus ou inconnus. Ces quelques 700 pages forment un kaléidoscope génial s’ouvrant sur un XIXème siècle dont les contours et les limites s’estompent au fur et à mesure de la lecture, du voyage aimerait-on écrire. On retrouve un peu de l’esprit de Jules Vernes dans cet universalisme exotique, quand bien même les textes proposés sont le résultat de recherches érudites et académiquement fondées. L’on se perd dans ce livre avec délice, du royaume de Mataram à la cote de Malaguette, en passant par le Parlement mondial des religions de Chicago ou l’atelier de Louis Daguerre.
Dans Décadence fin de siècle, Michel Winock, honoré du prix Medicis en 1997 et du prix Goncourt trois ans plus tard, nous propose un regard plus philosophique sur les hantises d’une société française de la fin du XIXème siècle, persuadée de sa décadence. Une obsession de la fin, soutenue par de nombreux écrivains, avec en filigrane les souvenirs de la guerre de 70 et ceux de la Commune de Paris de 1871. Invoquant tour à tour Zola et Hugo, mais également les manipulateurs de l’opinion publique tels la figure de proue du nationalisme français Maurice Barrès, l’antisémite Édouard Drumont ou encore le dandy ultra-conservateur Jules Amédée Barbey d’Aurevilly, l’auteur dépeint un paysage intellectuel commun à de nombreux écrivains et peintres des années précédant le temps de la Belle Époque. « Des prophètes de malheur attendant l’apocalypse » que Michel Winock pointe du doigt pour, en fin de compte, décrypter la peur, celle du changement, celle de l’évolution d’un monde en proie à des tensions antagonistes sans doute symbolisées au mieux par l’affaire Dreyfus et dont les implications évoquent inévitablement notre époque contemporaine.
Les ouvrages de Michel De Jaeghere et Bryan Ward-Perkins, Les derniers jours. La fin de l’Empire romain d’Occident et La chute de Rome, fin d’une civilisation traitent tous deux, on l’aura compris, de la fin de la civilisation romaine. Et l’un comme l’autre abordent cette thématique sous un angle similaire, remettant en question les thèses de l’historien irlandais Peter Brown. Si pour ce dernier la désintégration de l’empire romain fut progressive et même douce à certains égards, De Jaeghere et Ward-Perkins insistent sur la portée des invasions barbares et la montée en puissance des populations germaniques ayant entraîné un recul des conditions de vie, de la culture et de l’économie. Le livre de Michel De Jaeghere – dont les afficionados se souviennent qu’il est directeur du Figaro Histoire – auquel est annexée une imposante bibliographie largement francophone, est de prime abord impressionnant de détails, embrassant un nombre incalculable d’aspects de cette ère de déclin. L’auteur fonde son approche sur l’ouvrage de l’historien archéologue Bryan Ward-Perkins qui démontre, pour sa part de manière plus concise, le repli des conditions de vie, des arts, ainsi que « de la paix et du bien-être ». Ces deux ouvrages rejettent ainsi le concept d’une « antiquité tardive » en mettant en opposition une civilisation certes décadente mais évoluée et des peuplades barbares jouissant au mieux d’une sous-culture formée selon le principe de l’ethnogenèse. Si on ne peut nier un certain nombre « d’invasions » barbares tout comme l’on se souvient des « conquêtes » romaines – deux termes communément consacrés par l’historiographie évoquant des implications également violentes mais différemment valorisées – peut-être aurait-il fallu que Michel De Jaeghere lise plus attentivement Georges Dumézil à défaut des auteurs allemands pour appréhender ces peuples venus du Nord avec plus de recul. Si l’étude de Ward-Perkins expose factuellement les mutations du crépuscule de la civilisation romaine, celle de Michel De Jaeghere comporte une dimension idéologique d’autant plus discutable que sa première édition date de 2014, année paroxysmique de la crise des migrants en Europe !
L’ouvrage de Magali Coumert et Bruno Dumézil, Les royaumes barbares en Occident, s’inscrit dans un courant de pensées opposé à celui des livres des deux auteurs précédents, rejetant la thèse des « Grandes invasions » et préférant évoquer un choc de civilisations fait d’événements violents mais également d’adaptations et de négociations. Une approche privilégiant donc un glissement culturel évolutif qui, en regard des analyses de De Jaeghere et Ward-Perkins, permet de se faire une opinion sur les causes de la disparition de l’empire romain.
Attention, le livre de Jerry Toner n’est à mettre entre les mains que des lecteurs dotés d’un sérieux second degré. Et ceux-ci développeront une addiction certaine pour son ouvrage cynique et décalé L’art de gouverner ses esclaves par l’illustre Marcus Sidonius Falx. Il faut reconnaître à l’auteur, professeur à Cambridge tout de même, un certain génie. Traitant de l’esclavage dans l’ancienne Rome, il endosse le rôle d’un riche patricien romain qu’il fait parler. Et ce dernier dresse un véritable manuel du bon maître ! Pourquoi préférer une solide Batave ou jeter son dévolu sur un éphèbe égyptien ? Comment nourrir son esclave, l’affranchir ou le punir. Comment en disposer sexuellement ou le vendre… ! Jerry Toner analyse ainsi toutes les facettes de l’esclavage sous l’angle de ce que pouvait être la normalité romaine, évidemment très éloignée de la nôtre.
Si le livre de Christophe Badel est édité pour la seconde fois cette année, c’est qu’il s’agit d’une référence. Un ouvrage qui doit beaucoup à Claire Levasseur, la cartographe qui a réalisé les nombreuses cartes donnant au texte de l’auteur le relief si particulier qui caractérise ce livre. Ce dernier a la prétention de réfléchir sur la construction impériale romaine, sur sa formation, sa gestion et ses processus d’intégration et d’acculturation. Et il y parvient avec succès ! Il faut dire, il est vrai, que Christophe Badel n’est pas le premier venu. Non seulement spécialiste de la Rome antique et auteur de nombreuses contributions, il réussit en outre à marier trois aspects que peu d’historiens parviennent à équilibrer, un discours académique fondé, une simplicité de langue appréciable pour le profane et un souffle donnant à son texte âme et profondeur. Son Atlas de l’Empire romain, Construction et apogée : 300 av. JC- 200 apr. JC en est un parfait exemple que l’éditeur a mis en forme dans une présentation didactique pouvant séduire collégiens, universitaires et amateurs de l’histoire romaine.
(paru dans Aimer lire)
Christophe Badel, Atlas de l’Empire romain, Construction et apogée : 300 av. JC- 200 apr. JC, Autrement, Paris, 2012, 2017.
Michel Winock, Décadence fin de siècle, Gallimard, Paris, 2017.
Histoire du monde au XIXe siècle, Pierre Singaravelou et Sylvain Venayre (dir), Fayard, Paris, 2017.
Jerry Toner, L’art de gouverner ses esclaves par l’illustre Marcus Sidonius Falx, Flammarion, Paris, 2017.
Michel De Jaeghere, Les derniers jours. La fin de l’Empire romain d’Occident, Perrin, Paris, 2014, 2016.
Magali Coumert, Bruno Dumézil, Les royaumes barbares en Occident, PUF/Que sais-je ? Paris, 2017.
Bryan Ward-Perkins, La chute de Rome, fin d’une civilisation, Flammarion, Oxford, Paris, 2005, 2014, 2017.