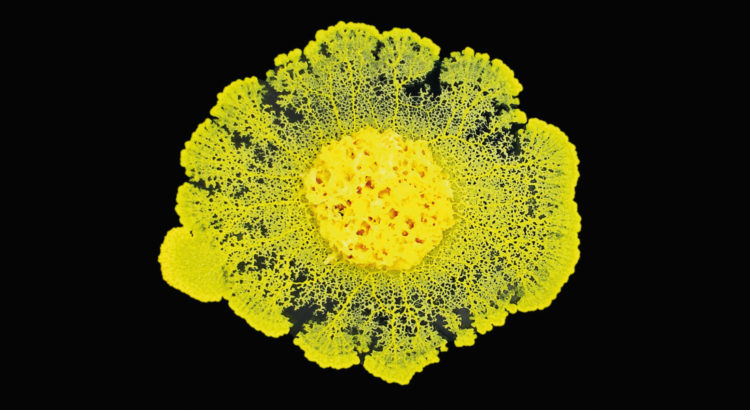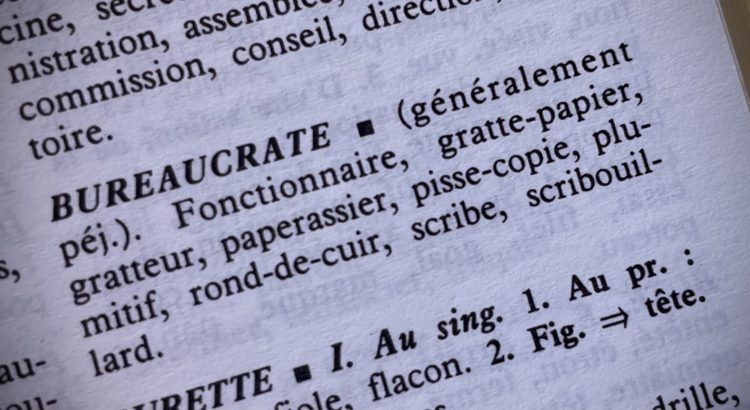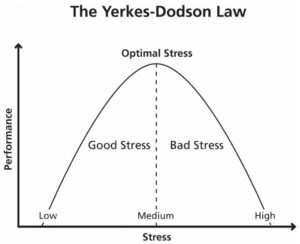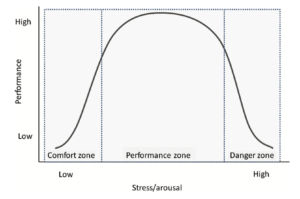A en croire la multiplication des ouvrages qui filent la métaphore du vivant, la littérature sur le management est sur le point de devenir une science naturelle. On nage en plein bullshit managérial !
“S’inspirer du vivant pour organiser l’entreprise“, “60 récits du vivant pour inspirer nos organisations“, voilà deux titres parus en l’espace de quelques mois qui dressent un parallèle entre le management et les sciences naturelles. Il faut s’y résigner : la métaphore biologique inspire nombre d’auteurs. Le problème, c’est que ce faisant, ils construisent le plus souvent un château de sable. Non seulement, la métaphore est inadéquate, mais est aussi une source de bullshit.
Au fondement de cet appel à la nature pour concevoir le fonctionnement de nos organisations repose l’idée selon laquelle, à l’image des organismes qui s’adaptent à leur environnement ou meurent, les entreprises modernes doivent être comprises comme des êtres vivants. Ceci affirmé, on peut mettre sur pied des “organisations cellulaires” (Delavallée 2021), et s’inspirer de la Nature (toujours un N majuscule !) pour “nos schémas organisationnels et alimenter nos pratiques de résilience, de leadership, de communication, pour en faire des processus à la fois agiles, vertueux, durables et performants” (Joseph-Dailly 2021 : 23).
Parfois conscients des limites du recours à la métaphore et à l’analogie pour prescrire des modèles ou des pratiques, on nous met en garde : “L’objectif des récits du vivant qui ont été ici sélectionnés n’est pas une transposition mimétique. Cela ne ferait pas de sens. C’est un élargissement du regard, un changement de paradigme, un enrichissement de nos référentiels, en vue d’une reconnexion avec des principes ancestraux et pourtant très innovants pour nos sociétés. Car ce qui est ancien pour la Nature est souvent nouveau pour l’Homme” (Joseph-Dailly 2021 : 18). Nous voilà rassurés !
Ou encore : “il ne s’agit pas ici de calquer leur organisation sur celle du corps humain. L’organisme vivant est d’abord et avant tout utilisé par analogie. Il s’agit seulement de s’inspirer d’un certain nombre de propriétés du vivant, sélectionnés parce que transposables aux entreprises, pour penser leur organisation” (Delavallée 2021 : 10). Cela n’empêche pas le même auteur de dériver de cette “inspiration” dix principes clés pour mettre sur pied une “organisation cellulaire” dont l’utilité et la robustesse sont incontestables. Jugez-en : “Parce qu’elle est la forme organisationnelle qui permet de faire face au niveau de complexité le plus important, l’organisation cellulaire est en capacité d’appréhender son environnement comme un écosystème. Elle est ainsi le seul modèle organisationnel qui peut prétendre à de véritables ambitions sociétales et écologiques” (2021 : 19). Voilà donc qu’une “inspiration” et une “analogie” permettent d’élaborer l’arme suprême pour transformer le monde ! En concevant nos organisations comme des amibes ou des blobs, le bonheur, l’efficacité et la fiabilité seront de retour en leur sein; sans compter qu’au passage, nous aurons sauvé la planète, pourquoi s’en priver.
Rhétorique de l’irrationnel
« En ce sens, on peut dire que les sciences sociales n’ont jamais avancé que parce que certains ont eu le courage d’énoncer des propositions finalement un peu ridicules – un talent plus développé chez Karl Marx, Sigmund Freud ou Claude Lévi-Strauss que chez d’autres. Simplifier le monde pour le comprendre et en découvrir de nouveaux aspects est donc une étape naturelle. C’est quand la simplification se prolonge au-delà de la découverte qu’elle n’est plus acceptable. » Graeber & Wengrow (2021 : 9)
Après tout peut-être sommes-nous un peu rapides à tomber à bras raccourcis sur ces “analogistes” qui voient dans le vivant le reflet de nos organisations ? L’analogie et la métaphore ont leurs vertus. Et nos “biologo-manageurs” ont peut-être flairé une piste interessante ?
C’est vrai que l’analogie et la métaphore sont heuristiquement parlant des outils performants, en ce qu’ils permettent (Pollack 2015 : 50):
- de recourir à ce qui nous est familier pour expliquer ce qui l’est moins;
- de mettre en évidence les similarités, en obscurcissant les différences;
- d’identifier des abstractions utiles pour le propos;
- de raconter une histoire utile
- de faire appel à nos émotions.
En gros, elles sont utiles et efficaces pour raconter une histoire et “énoncer des propositions un peu ridicules” qui peuvent s’avérer pertinentes plus tard, une fois une théorie établie et soutenue par des preuves empiriques. Malheureusement, c’est là que le bât blesse : on se contente de la superficialité et du storytelling et on ne prouve empiriquement rien.
“Analogies et métaphores, mal construites ou fausses, peuvent avoir pour conséquence de dissoudre toute connexion causale – puisque le vocabulaire tient lieu d’explication. Par l’intermédiaire de l’analogie et de la métaphore de simples associations d’idées peuvent alors se substituer aux connexions causales et favoriser l’enchainement des surinterprétations” (Terré 1998 : 195-6).
Sur la forme, si dans une phase exploratoire l’analogie et la métaphore sont fécondes pour permettre la formulation d’une idée, d’une hypothèse, voire d’une théorie, elles ne peuvent en être le seul et unique socle. Les auteurs ayant recours à l’analogie du vivant n’élaborent la plupart du temps aucune hypothèse, aucune théorie de l’action susceptible d’expliquer le comportement des organisations et des acteurs qui les composent – préalable incontournable à toute prescription axiologique. Ils n’expliquent rien, ils prescrivent sur des tables de la loi en sable, ils se contentent de sculpter des nuages à coup d’image, “d’inspiration” et de “changement de paradigme“. Cela peut se justifier sur un plan esthétique, mais c’est nul sur un plan scientifique.
Un unanimisme absent
On nous répliquera que s’ils enfilent des perles métaphoriques, cela n’empêche pas que l’analogie est quand même peut-être vraie. Ben non ! Elle est foireuse et fausse. Pour au moins deux raisons.
La première est qu’elle présuppose que comme un organisme vivant, une organisation ne poursuit qu’un seul but et que chacune de ses parties (individus ou groupes) n’a qu’un seul objectif :
“Si l’organisation cellulaire est le modèle qui permet de faire face au plus haut degré de complexité, c’est bien parce que, à l’image d’un hologramme, chacune de ses parties est porteuse du tout dans sa globalité. En conséquence, elle peut octroyer une forte autonomie à ses entités sans que son fonctionnement devienne anarchique” (Delavallée 2021 : 23).
On passera comme chat sur braise sur l’image du “tout et de ses parties” empruntée autant à un systémisme de comptoir (coucou E. Morin) qu’au New Age, pour relever qu’il faut quand même une grosse dose d’optimisme – ou de naïveté – pour penser que l’unanimisme est susceptible de régner dans les organisations et surtout pour écrire ceci :
“Chaque entité de l’organisation a introjecté (sic) la raison d’être, les métarègles et, plus largement, la culture d’entreprise. La régulation culturelle est extrêmement forte au sein de l’organisation cellulaire. Les entités qui la composent partageant les mêmes valeurs et les mêmes principes d’action, elle peut se passer de managers hiérarchiques pour rappeler à l’ordre les collaborateurs déviants (re-sic), autant que de procédures et de définitions de poste pour préciser le “qui fait quoi”” (Delavallée 2021 : 23).
Ben c’est sûr qu’une fois que la “culture d’entreprise” aura suffisamment été implanté dans le cerveau des acteurs par processus de gavage, il n’y aura plus de collaborateurs déviants et alors tout le monde ne suivra qu’un seul but, qu’une seule volonté. On est plus dans la servitude volontaire, mais dans l’aliénation.
On ne le dira jamais assez, les organisations sont l’empire de la divergence sur les buts, les moyens et les ressources. Elles voient au contraire régner en leur sein les relations de pouvoir, l’influence, le marchandage et le calcul (Crozier & Friedberg 1977 : 45). “Chaque membre de l’organisation peut s’appuyer sur la mission, y adhérer, voir l’intégrer en la reprenant à son compte, mais il serait contreproductif de porter une vision totalitariste de la mission de l’entreprise en exigeant de chacun qu’il fasse sienne cette mission” (Garreau 2022 : 50). A la différence des organismes vivants qui ont pour principal raison de préserver la vie et de lui assurer sa reproduction, les organisations n’ont pas de but unique, chaque partie en ayant des différents. Il ne saurait donc y avoir quelconque sérieuse analogie entre elles et des organismes vivants. L’analogie est sur son fondement erronée.
Evolutionnisme, Spencerisme et bullshit
La seconde est que, sans doute sans le savoir, ces “analogistes” sont évolutionnistes et surtout spenceriens. Ils re-formulent et revigorent les thèses de Herbert Spencer (1820-1903) qui a cherché, et échoué, à fonder un “évolutionnisme philosophique” reposant sur l’analogie entre le développement du vivant – par les mécanismes de l’évolution mise à jour par Darwin – et l’évolution des sociétés et des organisations. Comme Spencer, nos “métaphoriens” contemporains postulent une continuité entre le biologique et le social, entre organismes vivants et organisations (re-coucou E. Morin). Comme Spencer, ils filent l’analogie de la nécessité de l’adaptation de l’organisation à son environnement “écosystème” comme celle du vivant. Et quoi de plus adapté à son environnement sur la durée qu’un organisme vivant soumis à la loi de l’évolution ? Une “organisation cellulaire” !
Nous sommes face à rien de moins qu’à un évolutionnisme dynamique (Tort 1996 : 87). Si la “sociologie” spencierrienne a rapidement été réfutée, car “scientifiquement et logiquement fausse” (Tort 1996 : 5) (notamment parce qu’elle repose sur un syllogisme fallacieux et sur aucune preuve empirique probante), elle n’en a pas moins eu, jusqu’à nos jours, une paternité fructueuse ne serait-ce que dans le darwinisme social…
On peut rêver mieux comme fondement.
Au final, nos “analogo-métaphorien-du-vivant” ont un mérite. Celui de nous permettre de lire des choses comme celle-ci :
“La Nature, au travers de ses récits, pourrait nous aider à passer d’un modèle de l’Avoir à un modèle de l’Être, fondé sur une énergie optimisée, une aptitude retrouvée à la lenteur, au vide assumé et dégénératif. Le dilemme entre l’Être et Avoir n’est pas nouveau, mais l’importance du choix que fera l’Homme est aujourd’hui cruciale. Et le pouvoir fascinant de la Nature peut nous mener à reconsidérer notre capacité à nous réinventer, à accepter ou à renoncer, en conscience, non pas dans une optique d’abandon, mais dans une dynamique vertueuse de lâcher-prise et de sobriété joyeuse” (Joseph-Dailly 2021 : 55).
C’Est Décidé, Je Lâche Prise. Désormais, Je Mets Des Majuscules À Tous Mes Mots Et Je Sens Déjà La Sobriété Joyeuse Innerver Mes Chakras.
Références :
Bouveresse, J. (1999). Prodiges et vertiges de l’analogie. Paris : Raison d’agir Editions
Crozier, M. & Friedberg, E. (1977). L’acteur et le système. Paris : Seuil
Delavallée, E. (2021). S’inspirer du vivant pour organiser l’entreprise. 10 principes opérationnels. Louvain-la Neuve : De Boeck Supérieur
Garreau, L. (2022). “La mission de l’entreprise et son influence sur le sens du travail” in (collectif) L’Etat du management 2022. Paris : La Découverte
Graeber, D & Wengrow, D. (2021). Au commencement était… Une nouvelle histoire de l’humanité. Paris : Les Liens qui Libèrent
Joseph-Dailly, E. (2021). La Stratégie du poulpe. 60 récits du vivant pour inspirer nos organisations : collaboration, innovation, résilience. Paris : Editions Eyrolles.
Pollack, J. (2015). Shortcut. How Analogies Reveal Connections, Spark Innovation, and Sell Our Greatest Ideas. New York : Avery
Terré, D. (1998). Les dérives de l’argumentation scientifique. Paris : PUF
Tort, P. (1996). Spencer et l’évolutionnisme philosophique. Paris : PUF