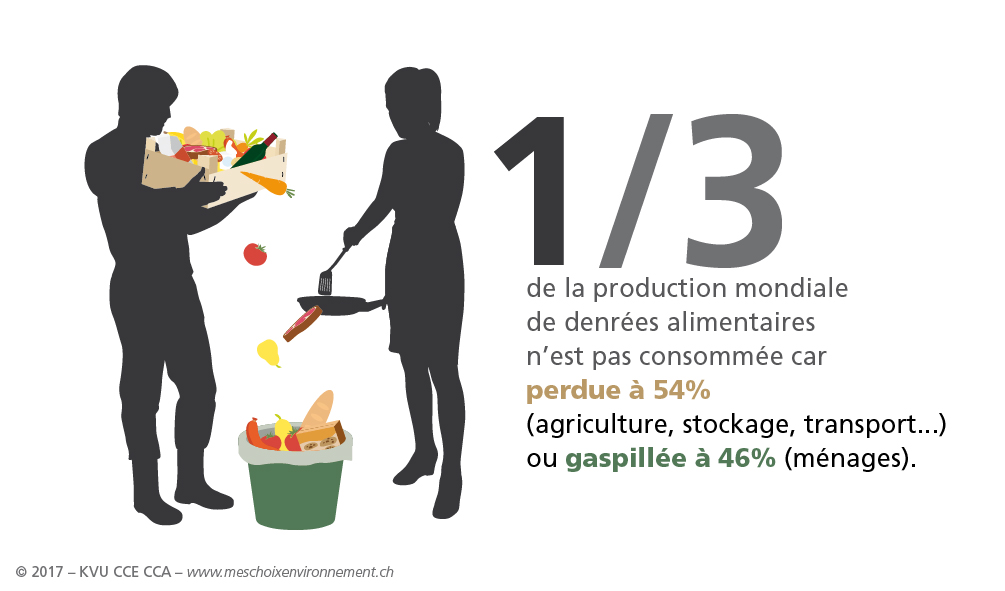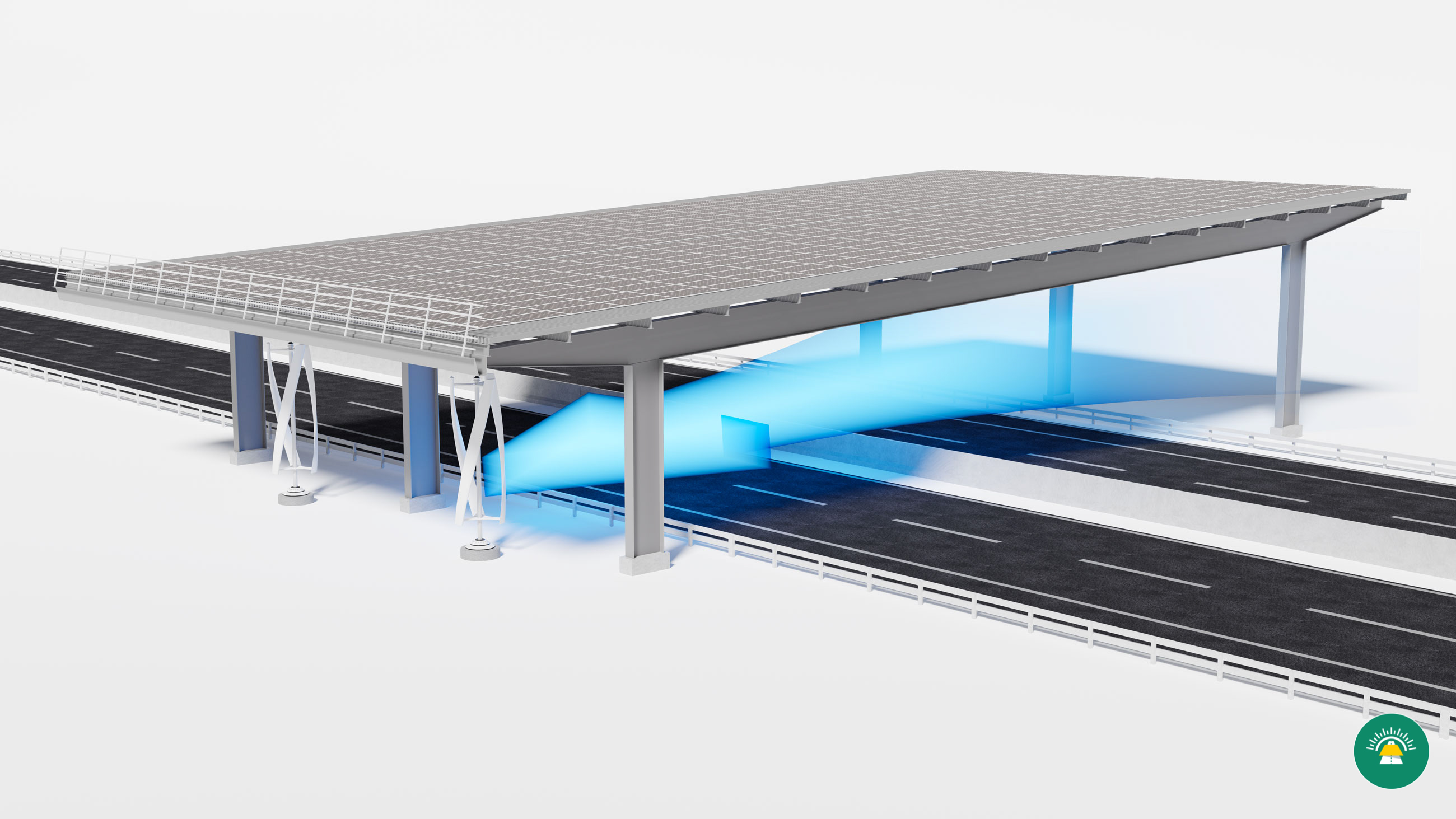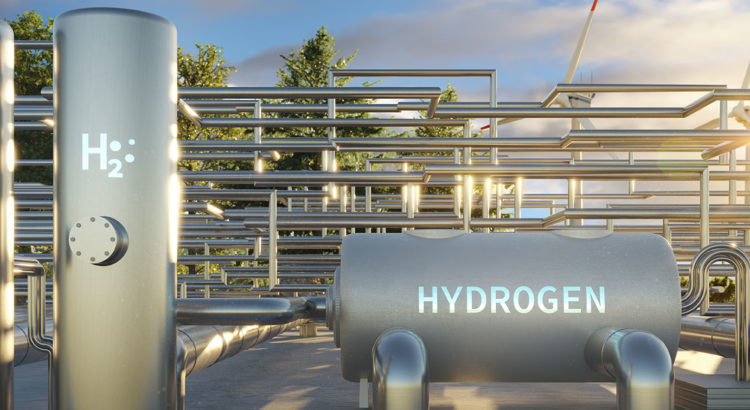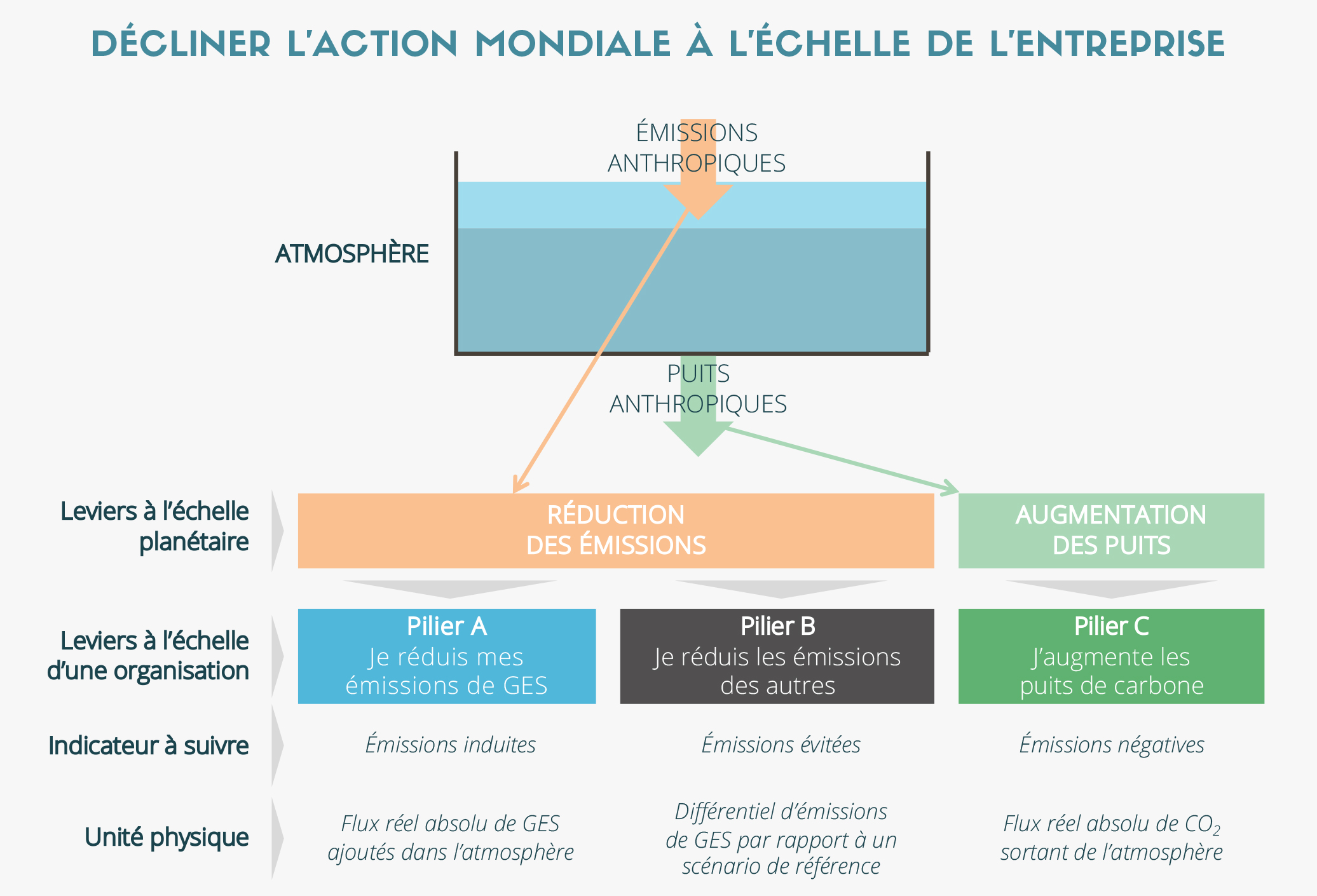Comment développer son potentiel d’énergie renouvelable et augmenter son autonomie ? Cette question, déjà centrale dans le cadre de la transition, devient désormais plus qu’essentielle dans le contexte de la guerre en Ukraine. Relevé il y a longtemps, le problème de la dépendance énergétique nécessite une refonte du système de production et d’approvisionnement. Voici comment les communes peuvent agir.
Si la transition énergétique nécessite de tendre vers l’autonomie, les récents événements en Ukraine nous rappellent à quel point la dépendance aux hydrocarbures provenant d’autres pays est inquiétante. Dans le cadre du conflit actuel, il est évidemment compliqué de continuer à s’approvisionner, même indirectement, en hydrocarbures russes, notamment pour ne pas subir les effets de levier économiques engendrés par l’éclatement du conflit. Pour rappel, plus d’un tiers du gaz naturel acheminé en Europe par gazoduc provient de Russie (Le Temps, mars 2022).
Les estimations suisses indiquent par ailleurs que près de la moitié du gaz utilisé dans notre pays proviendrait d’exploitations russes. En Suisse romande, cette part a oscillé autour de 25% l’année passée, selon Gaznat. Enfin, notons encore qu’en 2020, le gaz représentait 15,1% de la consommation finale dans le mix énergétique helvétique.
Dans ce cadre, tendre vers un paradigme d’autonomie devient particulièrement urgent. Précisons encore qu’autonomie ne signifie pas autarcie – modèle où l’on se coupe du réseau. L’idée de l’autonomie étant de produire son énergie et de pouvoir en réinjecter le surplus dans le réseau, auquel on reste bien sûr connecté, tout en pouvant aussi s’y alimenter en cas de production propre insuffisante. En Suisse, le pouvoir fédérateur dont bénéficient les communes pourrait jouer un rôle décisif. Proches des habitants et impliquées dans la concrétisation territoriale des incitations durables poussées aux échelles cantonales et fédérales, les communes constituent en quelque sorte un maillon stratégique. Pour ce faire, plusieurs scénarios sont à envisager.
Mobilisation citoyenne
Selon sa taille et son budget, une commune ne bénéficie pas forcément d’une task force à l’interne pour opérer sa transition énergétique avec succès. Dans ce cas, il reste tout à fait possible de solliciter les services et l’expertise d’acteurs énergétiques, tels que producteurs, distributeurs mais aussi gestionnaires de réseau. Autrefois cantonnés à des opérations industrielles de plus ou moins grande envergure, ces acteurs ont progressivement fait évoluer leur panel de services pour s’adresser au grand public également. Un pivot devenu essentiel, en particulier dans le cadre de la transition énergétique, alors que les consommateurs deviennent producteurs à leur tour.
Un des modèles illustrant cette approche consiste pour une commune à mandater un expert énergétique afin de proposer ses services aux habitants, à l’image du programme « Ma Commune et moi ». Il s’agit d’un coaching énergétique personnalisé qui permet à la population de comprendre quelles démarches entreprendre pour diminuer concrètement son empreinte carbone et quels types de programmes de subventions il est possible de solliciter. « L’idée consiste à favoriser une approche éducative, d’information et de sensibilisation, visant notamment à faire changer les comportements au niveau individuel pour finalement engendrer un effet collectif. », précise Philippe Corboz, responsable de produits destinés aux collectivités publiques au sein de Romande Energie.

Autre levier à activer, la sollicitation de l’engagement des citoyens. Objectif : sonder les habitants pour comprendre leurs souhaits et préférences en matière de durabilité ou encore leur proposer de faire partie intégrante d’un projet durable mené à l’échelle communale.
« Il est même intéressant de pousser la logique un cran plus loin. », lance Stéphane Genoud, professeur responsable du Management de l’énergie à HES-SO Valais-Wallis. « En observant les modèles gagnants en termes de durabilité, on remarque que le cas de figure dans lequel les démarches se concrétisent le mieux consiste à ouvrir le capital des infrastructures durables aux citoyens. En Allemagne ou encore au Danemark, les régions qui sont parvenues à devenir autonomes énergétiquement sont des endroits au sein desquels la population est allée rencontrer les autorités locales afin de demander des changements concrets. Parmi eux : le fait de devenir acteur, décisionnaire et propriétaire des infrastructures concernées. Au Danemark, sur l’île de Samsø, les habitants sont par exemple propriétaires d’un parc de plusieurs dizaines d’éoliennes depuis 1998. L’île est autonome au niveau énergétique parce que les habitants ont eu la possibilité de s’impliquer. En Suisse, tant que les décisions et projets seront poussés par les distributeurs ou les gestionnaires de réseau, il sera difficile de reproduire ce cas de figure. Surtout dans le contexte actuel de la décentralisation qui, à mon sens, ne peut pas s’effectuer de manière industrielle. ».
Quelques exemples suisses vont dans ce sens. Sans encore détenir le capital durable, certaines populations ont soutenu la mise en place d’un réseau de chauffage à distance initiée par leur commune en s’engageant à s’y raccorder. Le modèle, qui se distingue par sa vision fédératrice, a notamment fait ses preuves en Valais.
Un village d’irréductibles Conchards résiste encore et toujours au mazout
Remplacer les chaudières à mazout de toute une commune par un système de chauffage à distance (CAD) n’est pas chose aisée, encore moins en milieu alpin. À Ernen, dans la vallée de Conches, cette transition a pourtant été effectuée avec succès. La transformation durable du village, notamment initiée par l’ancienne présidente Christine Clausen, représentait un défi complexe. Car les travaux ont dû se dérouler dans de minces ruelles, au sein d’une région de montagne qui compte de nombreuses habitations de petite envergure.
« Entre 2011 et 2014, nous avons raccordé plus de 300 logements à notre CAD. Chaque année, cette infrastructure nous permet d’économiser 300’000 litres de mazout. Outre l’aspect durable, la démarche comporte une forte valeur ajoutée d’un point de vue économique. Le projet aide en effet à maintenir des emplois sur place, notamment dans l’entreprise Forst Goms chargée de la coupe de bois local qui alimente le CAD. ».
Modèle économique gagnant
L’investissement de 5 millions de francs nécessaire à la transformation, supporté par la société coopérative fondée pour le projet, devrait être amorti d’ici quelques années, permettant ainsi aux habitants de profiter d’une réduction des coûts significative par rapport à l’ancien système de chauffage à mazout.
L’union fait la force
Sans forcément se limiter à leur propre territorialité, les communes ont également intérêt à développer des synergies et des regroupements plus larges. Cela dans le but de joindre leurs forces ainsi que leur budget. Souvent proches les unes des autres, les communes d’une même région peuvent, via des groupes de travail communs, mener des travaux conjoints visant par exemple à mutualiser l’achat ou la construction d’infrastructures durables.
« Un modèle qui a d’ailleurs largement fait ses preuves. », ajoute Stéphane Genoud. « Le fait de se regrouper entre communes d’une même région permet en effet de réaliser des appels d’offres en commun, et donc de bénéficier de meilleurs prix. Ce que nous avons par exemple fait dans le cadre de GROUP-IT – un projet de recherche lancé par la HES-SO Valais-Wallis et soutenu par l’Office Fédéral de l’Energie (OFEN) – pour les communes du Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut. ».
On l’aura compris, dans l’optique de tendre vers un paradigme énergétique basé sur l’autonomie régionale, les communes peuvent activer des leviers décisifs. Et dans le contexte de la décentralisation, il devient de plus en plus intéressant et pertinent de se tourner davantage vers les premiers concernés : les habitants. Former des synergies économiques durables avec la population constitue peut-être la clé pour mener à bien la transition. Dans ce sens, si le rôle des industriels reste évidemment essentiel, leur positionnement pourrait être amené à changer. Car le marché énergétique de demain doit certainement appartenir davantage aux consomm’acteurs.

Thomas Pfefferlé
Journaliste innovation