Par l’heureux hasard d’une partie du jeu Geocaching, entraînée par la jeune génération, je me suis retrouvée en possession d’un ouvrage publié en 1998, Friedrich Dürrenmatt. Meine Schweiz. Il rassemble, huit ans après le décès du célèbre auteur, plusieurs essais, poésies, discours théâtraux ou discussions, dont certains ont été traduits en français [1]. Abandonné sans doute depuis un certain temps près de la cache indiquée par le jeu, mais sans lien à cette dernière, l’ouvrage était conséquemment imprégné d’humidité et de soleil, mais tout de même encore apte à la lecture. Il m’invitait à l’emmener, pour le délivrer de son abandon. Parcourir Meine Schweiz en cet été 2020, marqué à la fois par la pesanteur et l’incertitude de la crise du COVID-19 et les votations de fin septembre, fait mou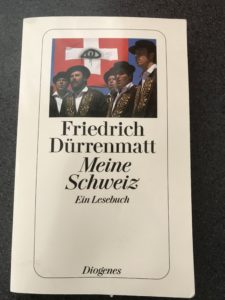 che à plus d’un titre.
che à plus d’un titre.
Tout à la fin de l’ouvrage, juste avant quelques derniers vers poétiques, se trouve un essai Vom Ende der Schweiz, De la fin de la Suisse, publié à l’origine vers 1950. Dans l’ambiance de l’après seconde guerre mondiale, Dürrenmatt affirme que « la neutralité n’a de seul sens que si elle est utile à l’Europe. […] Ce n’est que dans la justice que se trouve la possibilité d’une liberté qui ne soit pas de l’arbitraire » [2]. Qu’il est adéquat de lire ces lignes à l’instant où nous allons être appelés à revoter sur notre relation à l’Europe. Félix Brun, membre du mouvement pro-Européen suisse Nomes, commentait ainsi en 2016 ce même ouvrage: « au premier coup d’œil, la dimension européenne de la pensée de Friedrich Dürrenmatt ne va pas de soi. [Mais…] Dürrenmatt a toujours été présenté comme un penseur critique qui dressait dans ses ‘étoffes’, comme il se plaisait à appeler ses pièces de théâtre, l’image d’une Suisse internationalement intégrée et consciente de ses responsabilités. Une Suisse qui aurait pu servir de modèle à l’Europe ».
C’est exactement là que réside la force de l’essai De la fin de la Suisse : sans dire rien de plus des pays qui nous entourent, Dürrenmatt réussit en cinq pages à la fois à évoquer l’attachement qu’éprouvent la plupart d’entre nous à notre pays, et la fragilité qu’engendre, paradoxalement, cet attachement. On est sous sa plume, dans les années cinquante, à l’opposé exact de la vacuité du slogan des années 90 « la Suisse n’existe pas », arboré à l’exposition universelle de 1992, et qui avait suscité bien des réactions, comme le rappelle cette archive de la RTS. Avec les étudiants de ma génération, nous assistions quelque peu stupéfaits, dans ces années nonante, aux digressions artistiques d’une Suisse post-soixante-huitarde qui s’exposait au lieu de nous exposer. L’exposition nationale 02 me parut faite du même bois, à y casser des assiettes pour rien, sans dire un seul mot des travaux de la commission Bergier sur les fonds en déshérence, alors qu’elle avait terminé ses travaux en décembre 2001. On attend toujours un faire mémoire circonstancié et collectif de ces pages d’histoire suisse, peut-être lors de la prochaine exposition nationale 2027, espérons-le.
L’essai De la fin de la Suisse se laisse lire de lui-même, en plein été de post-pré-pandémie COVID-19, alors même que nous traversons une fragilisation économique que nous aurions difficilement imaginée possible et dont les contours sont encore bien incertains : « Pour la plupart de nos concitoyens, l’existence de la Suisse paraît être ce qui va le plus de soi au monde. Ils croient que l’état auquel ils appartiennent, rend l’avenir sécure pour tous, tel le sol sur lequel ils se tiennent, et tels les cieux sous lesquels ils marchent. […Or] nous ne savons pas ce qu’il en sera, dix ans de plus ou de moins ne jouent pas un grand rôle dans l’histoire […]. Il en est des états comme des êtres humains : ils peuvent mourir de toutes les manières, à la fois imaginables et inimaginables, de maladie, de malheureux incidents, de suicide, ou alors être tués, telles des mouches contre le mur. […] Nous savons si peu du futur » [2]. Ces propos, d’apparence sévère, le conduisent à faire appel en finale à la justice comme seul lieu possible « d’une liberté qui ne soit pas de l’arbitraire » [3].
Tout est dit : si le récent plan de relance européen réjouit nos entreprises, cet avantage doit d’autant aiguiser notre sens de la justice et de la responsabilité envers les pays qui nous entourent. Dans l’héritage de Dürrenmatt, on cultivera à profit une claire conscience du fait que la stabilité de notre état, loin d’être un sol immuable sous nos pieds, est à regagner chaque jour dans un subtil équilibre avec l’Europe.
Vor blauen Tramwagen manchmal
Bewegen sich die Vorhänge
Geisterhaft auf die gleiche Scheibe gespiegelt
Erscheint aber auch
Mein Gesicht und die fernere Theke
Schiebt sich
Der Hintergrund vor den Vordergrund.
Friedrich Dürrenmatt, Kronenhalle [4]
[1] Heinz Ludwig Arnold, Anna von Planta & Ulrich Weber (éd.), Friedrich Dürrenmatt. Meine Schweiz. Ein Lesebuch, Diogenes, Zurich, 1998.
[2] Ibid., p. 241 et 242.
[3] Ibid., p. 237-239.
[4] Ibid., p. 243.