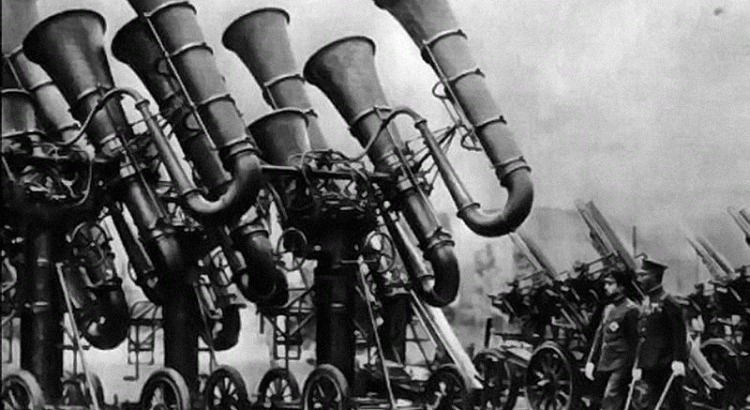Les événements récents en France n’en finissent pas de susciter prises de position, réactions et déclamations, comme autant d’échos à l’explosion soudaine d’un hurlement de haine auquel on ne s’attendait pas. L’attentat, ou plutôt les attentats, et l’ampleur du soutien que ces actions criminelles ont provoquée font se poser la question de leurs répercussions dans le temps et de leur analyse, à court, moyen et long terme.
La stimulation de l’identité n’est pas une simple résultante gratuite inspirée par une crise ponctuelle ou une commémoration agencée autour d’un événement historique, l’identité n’est pas une valeur innocente et sans conséquences. Politiquement calculée, consensuellement intégrée par le public, elle est le précipité émotionnel décliné à l’envie ou au besoin…. identité nationale, identité ethnique, identité culturelle, crise identitaire, perte d’identité, etc… Elle est l’émulsion à la surface d’un creuset autour duquel se presse une intelligentsia autorisée comme autant d’alchimistes ajoutant arguments et perspectives dans une formule que nous savons forcément subjective. Le professeur François Jequier le rappelait en 2011 lorsqu’il insistait sur l’importance du Zeitgeist d’un contexte inévitablement complexe.
L’identité, basée sur un passé au mieux restitué, au pire fantasmé, représente donc un enjeu que chacun d’entre nous peut percevoir et qui compose la base de programmes politiques de certains partis, si ce n’est de tous les partis, interprété bien sûr de multiples manières. À cette cristallisation dans la moelle épinière de notre démocratie correspond le corollaire d’une désintégration progressive de l’identité nationale dans les centres urbains, cédant sa place à d’autres formes de reconnaissances sociales.
Les raisons de cette crise sont nombreuses : absorption des valeurs traditionnelles dans la cacophonie internationale des medias, flux migratoires divers et variés, évolution des mœurs en phase avec des mutations sociales, technologiques, voire éthiques, de plus en plus rapides… Antoine Fleury écrivait en 2001, je cite : « on assiste à la recherche de nouvelles assises identitaires, à un besoin impérieux de retour aux origines, de comprendre les fondements historiques de certaines situations du passé. Ce climat peut conduire facilement à faire dire tout et n'importe quoi à l'Histoire. En d'autres termes, le recours à l'histoire ne doit pas être abandonné à des «apprentis sorciers» [1].
Il suffit de lire la liste des publications destinées à un large public pour se rendre compte que l’identité est, en Suisse, un sujet de préoccupation continuelle. Ainsi, « Telle me, La Suisse racontée autrement » de Dominique Dirlewanger [2] ; « La Suisse ou le génie de la dépendance » de Joëlle Kuntz [3] ; « Ces Romands qui ont fait l’Histoire » de Philippe Souaille et Pascal Lamy [4], ou encore « Les Anniviards barbare et civilisés » de Bernard Crettaz et Evelyne Guilhaume [5]. Georges Andrey le dira explicitement dans le Matin du 27 septembre 2008, en insistant sur le fait que l’UDC « a transformé notre histoire en champ de bataille identitaire ».
Que nous soyons egocentriques, nous le savions déjà. Mais ne faudrait-il pas se poser la question de l’utilité et de l’utilisation de l’Histoire dans ce contexte identitaire ? Ne nous faut-il pas prêter une attention toute particulière au fait que l’histoire est bien souvent appelée au chevet de notre société dont les valeurs ont été peu à peu balayées au gré du siècle dernier, et court en fin de compte le risque d’être instrumentalisée ?
À l’heure du tout sécuritaire, des malversations financières, de la montée en puissance des conflits armés dans le monde, des prisons surpeuplées, d’une délinquance devenue ordinaire, de religions sans partage, de partages sans merci et de combats sans gloire, l’histoire devient un rempart, un abri, un Alpenstelle pour plagier Hervé de Weck. Manifestation spectaculaire de ce recours à l’espoir d’un sauvetage de nos fondements, la pétition déposée en 2014 par des parlementaires genevois intitulée « Pour un enseignement de l’histoire suisse et genevoise ! Parce que notre démocratie en a besoin » !… Une attaque directe, évidemment, contre le Plan d’Enseignement Romand, cette harmonisation des différents programmes scolaires des cantons romands ressemblant à une valse à trois temps, et dont le programme d’histoire est jugé trop misérable par les pétitionnaires. Il est vrai que l’enseignement de l’histoire, en raison de la part d’arbitraire inhérente aux choix des thèmes retenus, constitue un problème. Les technocrates de la didactique et de la pédagogie ne sont ainsi pas en mesure, ce depuis plusieurs décennies, de produire un manuel d’histoire commun aux différents cantons. Lisbeth Koutchoumoff le signalait bien avant les pétitionnaires genevois, en 2007 déjà, et elle-même faisait écho à la critique de Loyse Pahud qui publiait une enquête sur la question dans les colonnes de l’Hebdo en… 1985 [6].
Mais attention ! Si l’on peut partager l’opinion de ces pétitionnaires et celle d’Antoine Prost qui nous dit que, je cite : « enseigner l’histoire, c’est la meilleure façon de faire comprendre ce qu’est une société, un État, un gouvernement… c’est l’apprentissage de la vie en société avec sa dimension politique » [7], l’histoire doit être prise au sérieuse car elle est dangereuse. Elle peut se transformer en une arme de propagande si elle est manipulée par des personnes peu scrupuleuses, pouvant se révéler de véritables tortionnaires du passé.
Le danger est grand, en effet, de voir l’histoire instrumentalisée dans une lente crispation de soi-disantes valeurs nationales, et détournée à des fins partisanes. En 2001, François Hartog et Jacques Revel réunissaient différentes contributions portant sur les usages politiques du passé [8], insistant sur la perte de maîtrise à laquelle l’historien peut être confronté lorsque son discours est repris et détourné. Le colloque international de la Croix Rouge du 3 septembre 2004 intitulé « L’histoire comme arme de guerre, L’instrumentalisation du passé en situation de crise » est également venu nous le rappeler, tout comme le livre de l’historien québécois Alain Beaulieu «Une histoire instrumentalisée. Réflexions sur l'usage du passé dans les revendications autochtones», paru en 2009, un livre qui fait remarquer la portée de l’histoire. Dans les deux Canadas, l’Anglais et le Français, la question des influences du droit sur l’écriture de l’histoire amérindienne suscite un intérêt grandissant depuis quelques années en raison des protections particulières inscrites dans la Constitution à l’égard des droits des Autochtones… Devant les tribunaux, l’histoire est devenue un instrument que l’on manipule pour faire valoir des droits particuliers ou en contester l’existence ! En France, Henri Rousso, directeur de l’Institut d’histoire du temps présent, refusera même dans les années 90 de témoigner, dans le cadre des procès de Touvier et de Papon, dénonçant en particulier l’instrumentalisation de la recherche scientifique à des fins judiciaires.
L’ouvrage de l’historien anthropologue Marko Zivkovic « Serbian Dreambook » [9], paru en 2011, analyse quant à lui la manière dont des intellectuels, et plus particulièrement des historiens serbes, ont contribué à justifier le discours nationaliste en lien avec le Kosovo de Slobodan Milosevic. Des thèses reprises par Edward Herman et David Peterson dans leur ouvrage « Génocide et propagande l’instrumentalisation politique des massacres », paru en 2012 [10]. En 2014 encore, le directeur du Bureau du gouvernement de Serbie pour le Kosovo annonçait que Belgrade allait commémorer la mémoire d’Essad Pacha, une figure controversée de la mémoire albanaise, instrumentalisant délibérément l’histoire régionale et entraînant le courroux des Albanais du Kosovo.
La Suisse, quant à elle, n’est pas exempte de démarches tendancieuses. Il serait évidemment possible d’évoquer l’article du professeur Irène Hermann de 2008, « Democratization and the instrumentalization of the past », qui revient sur l’instrumentalisation du récit historique en Suisse, ciblant son récit sur la première partie du XIXème siècle [11], mais il me semble préférable d’en rester à des exemples plus récents puisque ceux-ci alimentent les polémiques d’autant plus fortement qu’ils sont généralement en lien avec des positions politiques actuelles. Ainsi, il y a deux ans, le blogueur Frank Brunner était condamné en Suisse pour ses articles à caractères antisémites et révisionnistes. Un jugement depuis lors relayé et critiqué par plusieurs sites internet d’obédiences ultranationalistes pour ne pas dire plus simplement aryens.
Un danger d’instrumentalisation plus grand encore, selon Jacques Neirynck qui nous dit dans son livre « La Suisse, un pays qui ne connaît pas son bonheur » [12], qu’il n’y a, je cite « pas moyen de faire la différence entre un site qui renseigne sur l’histoire de la Deuxième guerre mondiale et un site révisionniste, car on trouvera dans les textes la même fréquence du mot nazi ou dans les images la même apparition de la croix gammée ». Il ajoute, je cite : « L’internet veut développer la libre circulation de l’information mais elle risque de privilégier la désinformation ».
Pourtant, nous avons fait l’expérience, comme nous l’a démontré Laurent Olivier dans son livre « Nos ancêtres les Germains, les archéologues au service du nazisme », il y a près de septante ans, des dérives que des extrémistes à la solde d’une idéologie totalitaire ont fait prendre à l’histoire, octroyant des budgets scientifiques encore jamais atteints jusqu’alors dans ce que l’on nomme les sciences auxiliaires à l’histoire que sont l’archéologie, la linguistique ou le folklorisme, cela afin de prouver les origines germaniques de la culture européenne et donner à la guerre de conquête sa légitimité [13].
Que l’on confonde le drapeau historique de la Kriegsmarine allemande avec un symbole du IIIème Reich au fonds d’un carnotzet, suscitant la controverse, c’est compréhensible bien qu’un peu naïf. Que l’on nous dise dans les colonnes de la Tribune de Genève du 12 décembre dernier qu’il faut abolir le « Cé qu’è lainô », ce chant traditionnel que les Genevois chantent à l’Escalade en rappel de la tentative d’invasion de 1602 du duc de Savoie, car jugé trop patriotique, trop guerrier et trop religieux pour les oreilles de nos voisins et amis français pourtant habitués aux étendards levés et aux sillons sanglants…, la manipulation est grossière et doit être comprise bien évidemment comme une provocation provenant des rangs d’une certaine frange politique. Mais il est d’autres dérives autrement plus sérieuses que l’on constate au cours de ces dernières années.
En France notamment, Romain Bertrand, de la revue Annales. Histoire, sciences sociales, traitait ainsi en 2006 de la guerre des mémoires, liée notamment à la loi du 23 février 2005 sur le « rôle positif » de la colonisation qui allait ouvrir une large brèche à la polémique, et faire s’interroger l’auteur sur l’oubli des débats et des combats de la période des décolonisations. Ils allèrent être 1038 professeurs et doctorants (toutes spécialités confondues) à signer la pétition « Colonisation non à l'enseignement d'une histoire officielle » proposée le 25 avril 2005 par 19 historiens reconnus, dont Élisabeth Badinter, Alain Decaux et Marc Ferro. Dans cet appel « Liberté pour l’histoire », les auteurs demandaient l'abrogation de toutes les lois « historiques », soit la loi du 23 février 2005, la loi Gayssot, et la loi Taubira, affirmant que ces lois ont, je cite : « restreint la liberté de l’historien, lui ont dit, sous peine de sanctions, ce qu’il doit chercher et ce qu’il doit trouver » alors que « l’historien n’accepte aucun dogme, ne respecte aucun interdit, ne connaît pas de tabous ».
En janvier 2013, Mme Brunschwig Graf, présidente de la Commission fédérale contre le racisme, regrettait la prise de position partielle sur une partie du passé de notre pays, de la part du président de la Confédération lors d’une allocution, signalant, je cite : « qu’un discours sur la mémoire ne doit pas être un manifeste sur la politique actuelle, et qu’il est toujours dangereux d’essayer d’édulcorer le passé pour justifier des positions présentes ». Et l’historien Alain-Jacques Tornare d’ajouter, je cite : « il s’agit d’une instrumentalisation de l’histoire à des fins politiques…. On utilise l’histoire comme moyen de division entre les Suisses, c’est inquiétant ».
L’actualité récente vient encore cruellement nous rappeler les manipulations auxquelles un nombre grandissant de personnes sont soumises. Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik évoquait le 9 janvier dernier dans le cadre de la parution de son livre « Les âmes blessées » portant sur les rafles de juifs durant la dernière guerre mondiale, la manipulation des plus faibles. Le médecin s’exprimait à propos de l’attentat contre Charlie Hebdo du 7 janvier signalant que ce sont des groupes politiques qui utilisent des individus, dotés de peu d’éducation et très pauvres, faciles à fanatiser. Il indiquait, je cite « Ce ne sont pas des fous, ni des monstres. Ce sont des gens normaux et en détresse, façonnés intentionnellement par une minorité qui veut prendre le pouvoir ». L’instrumentalisation est là, recours aisé pour les personnes déterminées à parvenir à un but, « immisçant peu à peu des slogans dans la culture commune, soumettant la population à une représentation dépourvue de jugement. Une tendance d’autant plus dangereuse qu’Internet véhicule des représentations faciles de la réalité, des pensées paresseuses à l'origine de toutes les théories totalitaires ».
À la suite du professeur Antoine Fleury, dont l’article de 2001 paru dans les « Études et sources des Archives fédérales », intitulé « L’historien face à l’instrumentalisation de l’histoire »[14], est incontournable, on ne peut que souscrire à, je cite : « Le recours abusif à des arguments historiques pour justifier des décisions, légitimer des actions ne doit pas laisser l'historien professionnel dans l'indifférence; il est interpellé quand il s'agit d'identifier et de dénoncer l'imposture ». Une honnêteté intellectuelle qui semble s’imposer non seulement pour l’historien mais également pour l’ensemble des individus lorsque ceux-ci sont confrontés à des mensonges ostensibles.
Le professeur Fleury nous posait en 2001 une question essentielle, soit : « A l'issue de la remise en cause de la mémoire collective à laquelle autorités et peuple suisses ont dû procéder dans un contexte de pressions morales intenses à la fin du XXe siècle, quelle aura été la part des historiens dans le travail de construction d'une nouvelle mémoire? ». L’auteur évoque bien évidemment « l’affaire dite des fonds en déshérence ». Plusieurs contributions sont venus tenter de répondre à cette question, notamment le purgatoire très discret de Luc van Dongen à propos de la transition helvétique d’anciens nazis [15], ou l’ouvrage sans doute plus connu de Pietro Boschetti, « La Suisse et les nazis: Le rapport Bergier pour tous» de 2004 [16], ou encore le livre de Stephen Halbrook, « La Suisse face aux nazis » de 2011 [17]. La population helvétique n’a sans doute pas terminé de réactualiser sa mémoire, mais il apparaît évident que les travaux menés dans le cadre de la commission Bergier ont permis à nos autorités de revenir sur ce passé, autorités qui ont essayé de corriger ce que d’aucuns estiment avoir été des erreurs. Ainsi, le Parlement fédéral votait le 20 juin 2003 la loi sur l’annulation des jugements pénaux prononcés contre les personnes ayant aidé des victimes des persécutions nazies à fuir. À la suite, le 28 mai 2004, la Commission de réhabilitation de l’Assemblée fédérale disculpait Marcel Fert qui avait été écroué en Suisse soixante-deux ans plus tôt avant d’être ramené en France, pour avoir aidé des personnes à fuir sur le territoire helvétique.
On se demande à présent quelle sera la part des historiens dans le travail mémoriel portant sur les événements en lien avec l’attentat contre Charlie Hebdo mais également avec les attentats commis au cours des années précédentes, qu’ils se soient déroulés en Europe, aux États Unis, dans le proche Orient ou en Afrique ! Et on peut se demander également à cet égard quelle sera la part non seulement des historiens occidentaux, mais également des historiens arabes comme Ahmed Mohamed el-Tayeb, l’imam de la mosquée al Azhar depuis 2010, ou l’auteur Imran Nazar Hosein, auteur du bestseller « Jérusalem dans le Coran », ou encore Abd karim Abidi, le doyen de la faculté des lettres de l’université de Kairouan, ou le professeur Hassan Hallak du département d’histoire de l’université arabe de Beyrouth.
En d’autres termes, comment s’articulera l’écriture de cette histoire – pour faire référence à Michel de Certeau [18] – une histoire qui, en l’occurrence, baigne dans la peur, peur de l’autre, de son hostilité, de sa perfidie ? Une perception de l’altérité vieille du temps de Saint-Bernard et qui n’a guère perdu de sa virulence au XXIème siècle. Cette remarque peut, évidemment, tout aussi bien s’appliquer à l’Ukraine en proie actuellement aux déchirements que l’on connaît ! Quel sera l’assemblage de mots susceptibles d’être plébiscités et intégrés par la population sans que la peur ne les conditionne en un discours belligérant, misérabiliste ou culpabilisateur ne résultant qu’à un exercice de désinformation supplémentaire [19] ? Comment opérer pour que l’esprit critique prenne le pas sur cette dynamique de consomption ?
C’est sans doute là, illustré au travers de cet exemple dramatique et récent, l’un des enjeux majeurs de la médiatisation de l’histoire.
[1] Antoine Fleury, « L'historien face à l'instrumentalisation de l'histoire », in: Études et sources, Berne, 27 (2001).
[2] Dominique Dirlewanger, Telle me, La Suisse racontée autrement, Lausanne, 2010.
[3] Joëlle Kuntz, La Suisse ou le génie de la dépendance, Carouge, 2013.
[4] Philippe Souaille et Pascal Lamy, Ces Romands qui ont fait l’Histoire, 2013.
[5] Bernard Crettaz et Evelyne Guilhaume, Les Anniviards barbare et civilisés, Sierre, 2009.
[6] L’Hebdo, 12 septembre 1985.
[7] Elisabeth Haas, Antoine Prost, « L’histoire c’est l’apprentissage de la vie en société », La Liberté, 9 mai 2006, p. 14. Antoine Prost, « Comment l’histoire fait-elle l’historien ? », Vingtième siècle. Revue d’histoire 65 (2000), pp. 3-12. Voir également Antoine Prost, Douze leçons sur l’histoire, Paris, 1996.
[8] François Hartog et Jacques Revel, Les usages politiques du passé, Paris, 2001.
[9] Marko Zivkovic, Serbian Dreambook: National Imaginary in the Time of Milošević, University of Alberta, 2011.
[10] Edward Herman et David Peterson, Génocide et propagande l’instrumentalisation politique des massacres, Montréal, 2012.
[11] Irène Hermann, « Democratization and the instrumentalization of the past », in: The Ashgate Research Companion to the Politics of Democratization in Europe: Concepts and Histories, Tuija Pulkkinen, José Maria Rosales (éd.), Londres, 2008.
[12] Jacques Neirynck, La Suisse, un pays qui ne connaît pas son bonheur, Lausanne, 2003.
[13] Laurent Olivier, Nos ancêtres les Germains, les archéologues au service du nazisme, Paris, 2012.
[14] Antoine Fleury, « L'historien face à l'instrumentalisation de l'histoire », in: Études et sources, Berne, 27 (2001).
[15] Luc van Dongen, Un purgatoire très discret. La transition ‘helvétique’ d’anciens nazis, fascistes et collaborateurs après 1945, Paris, 2008.
[16] Pietro Boschetti, La Suisse et les nazis: Le rapport Bergier pour tous, Carouge, 2004.
[17] Stephen Halbrook, La Suisse face aux nazis, Bière, 2011.
[18] Michel de Certeau, L’écriture de l’histoire, Paris, 1975.
[19] Voir à ce propos François Jequier, « Comment enseigner l’histoire du temps présent ? », Revue historique vaudoise 117 (2009), p. 183.