L’été va bientôt se terminer, tandis que la pandémie ne va pas disparaître, même après la diminution du nombre de personnes infectées suite à la campagne de vaccination dont l’impact a récemment baissé, notamment en ce qui concerne la population désormais sceptique à cet égard et fâchée par les restrictions à la liberté individuelle imposées par les autorités politiques – souvent de manière cacophonique et parfois aussi contradictoire dans le temps ou dans l’espace d’un petit pays comme la Suisse.
Les dégâts socio-économiques de cette pandémie sont en partie déjà clairement visibles, même si rien, en l’état, n’a été fait pour réparer ces dégâts sur le plan tant individuel que collectif. Même s’il est vrai que le coronavirus ne fait pas de distinctions entre les riches et les pauvres, la réalité des faits montre que le Covid-19 est en train d’exacerber les inégalités, nourrissant ainsi de nouveaux conflits sociaux suite aux difficultés accrues au niveau économique – aussi bien en Suisse que dans les autres pays soi-disant «avancés» sur le plan économique.
Il est clair, désormais, que la pandémie a amené un nombre croissant d’entreprises à faire des choix visant à réduire leurs coûts de production (voire aussi les risques liés à la pandémie) qui ont réduit le niveau d’emploi en Suisse. Suite à la digitalisation des activités économiques et au travail à distance, bien des catégories de personnes qui travaillent ont été déboussolées par la «plateformisation» de l’économie, entendez par le travail «sur demande» qui est effectué à travers des plateformes informatiques basées sur les technologies digitales. Par exemple, il s’agit des applications de livraison de repas (UberEats, Smood, Just Eat) ainsi que le service de courses (Uber) offrant des prix inférieurs aux taxis traditionnels, aussi parce que, souvent, ces applications évitent aux employeurs de devoir payer les cotisations sociales habituelles.
La pandémie a ainsi augmenté de manière considérable les difficultés d’un nombre important de personnes sur le marché du travail. Une étude récente du Centre de recherche conjoncturelle de l’École polytechnique fédérale de Zurich montre que les inégalités ont augmenté en Suisse suite à la pandémie. Les personnes les plus démunies, entendez celles dont le revenu mensuel est inférieur à 4000 francs, ont dû réduire passablement leurs dépenses de consommation et augmenter leur endettement suite à cette pandémie. La classe moyenne, par contre, n’a pas été aussi durement frappée par la pandémie, parce que face à la réduction de sa consommation elle a augmenté d’environ 20 pour cent son épargne – qui tôt ou tard pourrait être dépensée sur le marché des produits et qui, en tout cas, représente une réserve de valeur disponible en cas de besoin.
Il n’est pas possible de savoir quand la pandémie du Covid-19 se terminera, mais il est urgent que l’État mette en œuvre des mesures adéquates pour en réduire les dégâts sur le plan socio-économique.
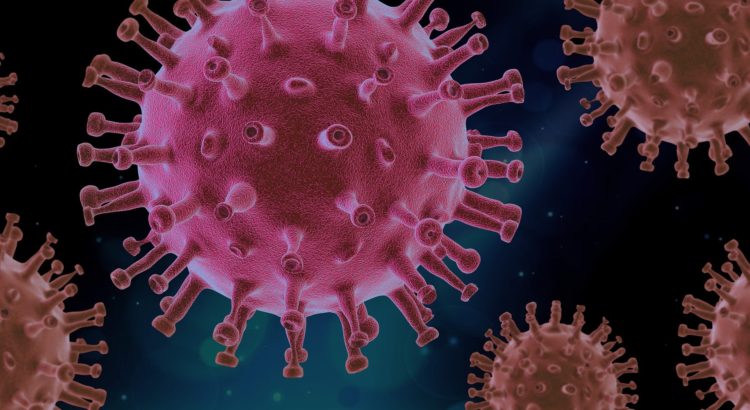
La classe moyenne n’augmente pas son épargne. Au mieux, elle économise pour les impôts à venir, au pire elle s’appauvrit sur plusieurs générations.
N’oublions pas que les personnes pauvres ne payent pas d’impôts mais la classe moyenne si, et les l’injections de liquidités, aides et autres transferts directs et indirects augmenteront leurs impôts futurs ou réduisent les investissements nécessaires.
Demain on rase gratis.
“représente une réserve de valeur disponible en cas de besoin.”
Vous voulez que l’Etat nous confisque l’argent qu’on a pas pu utiliser pour notre socialisation parce que l’Etat nous a fermé les bars et découragé à voyager ??
Bonjour THEO,
Sauf votre respect, il me semble que votre intervention est pour le moins troublante à l’égard d’un éminent professeur et docteur en économie qui nous ouvre gracieusement sa tribune, partage son savoir, et qui n’obtient comme réaction qu’une question toute faite de politique politicienne. C’est fort dommage car “la loi psychologique fondamentale” de Keynes aurait pu vous apprendre le principe même de “l’épargne de précaution” au lieu d’un raccourci simpliste reposant non sur les biais cognitifs de l’intellect mais des clivages. Voyez-vous, THEO, la détention d’encaisses monétaires correspond à un comportement d’adaptation à un environnement économique incertain et les anticipations jouent un rôle essentiel. Par ce fondement, la monnaie reste le “lien entre le présent et le futur” et sa possession “apaise notre inquiétude”. Vous pouvez aussi vous référer à des travaux bien plus récents sur l’économie comportementale (réf. Thaler) et vous saisirez ainsi comment la finance comportementale (FC) et les déviances néolibérales de l’économie comportementale (EC) ont favorisé (et favorisent plus que jamais) le transfert des richesses de la classe moyenne (le prolétariat ayant déjà eu son compte) vers le haut (“l’élite”). D’où le chemin lent mais inéluctable vers une paupérisation de la classe moyenne entamé ces vingt dernières années. Et d’où la déliquescence (sur cette même période) des moyens publics révélée à l’heure de la pandémie qui n’a rien d’un “Cygne noir” au regard de plusieurs experts mondialement reconnus, à l’instar par exemple de Nassim Nicolas Taleb.
Bien que l’économiste Thomas Piketty, auteur du “Capital du XXIème siècle” traduit en 40 langues, et auteur du récent ouvrage “Une brève histoire de l’Egalité”, ait montré que le mouvement vers l’égalité sociale, économique et politique est une tendance de long terme qui n’est pas prêt de s’arrêter, il n’empêche que “la révolution” devra profondément s’opérer au sein des dogmatiques institutions politiques désormais en mains néolibérales. Piketty nous répond à juste titre qu'”on a inventé depuis quelques décennies un droit quasi sacré à faire fortune en utilisant les infrastructures publiques d’un pays, son système sanitaire, éducatif, etc., puis à transférer ses actifs dans une autre juridiction en laissant la facture au reste de la population. Il faut mettre fin à la libre circulation des capitaux sans contrepartie fiscale ou sociale. Et l’on ne peut pas attendre l’unanimité pour cela: chaque pays doit sortir unilatéralement de ce système, tout en proposant aux autres des cibles explicites et quantifiés de justice fiscale et sociale”.
Comme je l’ai d’ailleurs écrit moi-même à de nombreuses reprises, le capital, aujourd’hui, par la vélocité des flux et de l’ingénierie financière, constitue du Capital neuf par sa simple circulation. Et il demeure donc vecteur d’inégalités. Paradoxalement, alors même que l’Empire du milieu affiche sans complexe des taux de croissance phénoménaux depuis des décennies (même en période de pandémie mondiale), “les inégalités de toutes sortes ont énormément progressé en Chine depuis 30 ans” nous rappelle Thomas Piketty. Quoi qu’en dise Xi Jinping, les choses n’ont fait que s’aggraver depuis son arrivée au pouvoir en 2013. Pour le brillant économiste, “la Chine dispose pourtant de réels atouts pour séduire les pays du Sud. Pour inverser la vapeur, les pays occidentaux vont devoir sortir de leur arrogance et proposer un modèle alternatif de socialisme démocratique, participatif, écologique et métissé”.
Toujours selon Piketty, “il est urgent de repenser la fiscalité internationale afin de partager les recettes provenant des multinationales et des milliardaires. D’une part parce que la prospérité des pays riches n’existerait pas sans les pays pauvres (la formule de Piketty peut aussi se transposer de la manière suivante: pas de riches sans pauvres et pas d’ultra-riches sans paupérisation de la classe moyenne) et d’autre part parce que chaque être humain devrait avoir un droit minimal égal à la santé, à l’éducation et au développement”. Reprenons l’exemple d’une hérésie in(égalitaire). L’âge de la retraite statutaire des femmes en Suisse a été amené à 65 ans, avec possibilité donnée d’anticiper l’âge du départ de la vie professionnelle moyennant un coût personnel non négligeable. Ceci alors même qu’entre 2014 et 2018, les inégalités salariales entre femmes et hommes ont augmenté dans le secteur privé et public, passant de 18,1% en 2014 à 19,0% en 2018, selon un rapport de l’OFS. Quelle belle ironie du “progrès”. Et toujours selon le même office fédéral de la statistique, les femmes représentaient 60% des salaires en dessous de 4000 francs en Suisse en 2018. Tandis que dans 81% des cas, les salaires de plus de 16’000 francs ont été touchés par des hommes. Et, ce, bien avant tous les effets économiques sur l’économie réelle (pour ne pas dire les phénomènes) propres à la pandémie.
On ne le répétera donc jamais assez : Aujourd’hui et plus que jamais, les questions économiques sont trop importantes pour être laissées à une seule caste dominante de “spécialistes mainstream” et de dirigeants nous répétant inlassablement les mêmes mantras. La réappropriation citoyenne de l’ensemble des savoirs est une étape essentielle pour transformer les relations de pouvoir.
Si l’économiste John Kenneth Galbraith (1908 – 2006) aurait pu nous rappeler ô combien “le processus par lequel les banques créent l’argent est tellement simple que l’esprit en est dégouté”, les médias “mainstream” auraient tout aussi bien pu nous remémorer, à l’heure de la pandémie mondiale et des relations incestueuses partagées sur l’autel de la financiarisation et du marchandising pharmaceutique, l’article du Wall Street Journal paru le 02 août 1920 lorsque celui-ci faisait référence au célèbre escroc Charles Ponzi (1882 – 1920): “Donnez un million $ à Ponzi et il vous rendra 25.000.000 $ après un an, 657.000.000 $ après deux ans et 16.885.000.000 $ après trois ans”.
Et comme “les Crédits font les Dépôts”, il n’est donc pas inintéressant de savoir que la Suisse intègre dans son économie réelle un taux d’endettement des ménages de 140% du PIB, ce qui place ces derniers parmit les plus endettés au monde; sachant que pour les ménages les moins favorisés, le crédit reste une illusion de richesses tandis que pour l'”élite”minoritaire, cette facilité demeure une manne providentielle pour leurs projets personnels de long terme et/ou leurs investissements spéculatifs à haut potentiel de rendement (et de risque). Il va sans dire que l'”élite” minoritaire paie au comptant les biens de consommation tandis que les ménages les moins privilégiés (alors que la classe moyenne inférieure tend à se paupériser) s’endettent d’abord pour consommer. Mais là aussi, nous sommes dans un secret de polichinelle où “les inégalités ont tellement prospéré dans nos sociétés ces dernières années qu’elles en sont devenues profondément néfastes et dangereuses pour la paix sociale”, comme l’a du reste très bien développé l’économiste Joseph Stiglitz (Prix Nobel d’économie, Professeur à Columbia et ex directeur de la Banque mondiale) au sein de son ouvrage: “Le Prix de l’inégalité”. Après le SRAS en Chine en 2003, Ebola en Afrique en 2014 et aujourd’hui le Covid-19 au niveau mondial, une question inévitable refait surface, à savoir si la financiarisation du modèle de santé est-il réellement viable? Si certains experts hétérodoxes ne se la posent plus contrairement aux orthodoxes, toutefois la grande majorité des grands Timoniers de la politique occidentale reste en sourdine. Et pour cause à l’instar de la France qui a choisi comme “Conseil suprême” de sa politique sanitaire, le Cabinet McKinsey, déjà éclaboussé par de nombreux scandales. Ceci dit, savons-nous seulement que l’industrie pharmaceutique a généré 1 000 milliards de profits depuis 1999 dont plus de 90% ont été reversés aux actionnaires? La rémunération de ses dirigeants bat aussi tous les records. L’ultra financiarisation du modèle des grands laboratoires les a amenés naturellement à délaisser les maladies pour lesquelles les traitements sont peu rentables. Faut-il s’en étonner encore et encore alors même que le pape du monétarisme et de l’idéologie néolibérale, l’économiste Milton Friedman, avait annoncé la couleur du nouveau dogme en prophétisant en septembre 1970, dans une publication du New York Times magazine, “que la seule responsabilité sociale de l’entreprise est d’accroître ses profits”.
Dans cette logique quasi religieuse,”l’industrie pharmaceutique a réduit ses investissements sur les enjeux de santé publique mondiaux, comme les maladies infectieuses, les résistances aux antibiotiques et sur les risques de pandémies”, un constat également conforté par Joelle Tanguy, directrice des affaires extérieures de la “Drugs for Neglected Diseases Initiative” (DNDi), une organisation de recherche à but non lucratif. La pandémie mondiale de Covid-19 illustre ainsi les conséquences du manque de recherche dans ce domaine et les risques découlant des décisions. La financiarisation a conduit à délocaliser une partie de la production pour réduire les coûts, ce qui a compromis la production massive de vaccins. Avec la bénédiction des gouvernements au moment du “crime”. Et la Suisse reste emblématique après le départ de Vasella. Dans le même temps, l’industrie a supprimé beaucoup d’emplois avec des plans sociaux à répétition – reportant la charge sur les états – la priorité étant donnée au marketing et aux actionnaires; tandis que le politique, complice, lui, s’est efforcé à réduire les moyens sanitaires publics (via l’orthodoxie budgétaire) en poussant le vice jusqu’à tenter d’expliquer de manière abracadabrantesque les sempiternelles augmentations des primes de l’assurance maladie à base sociale (LAMAL).
Entièrement d’accord avec l’idée centrale du texte du professeur Rossi: la pandémie dont la fin reste incertaine, en dépit des progrès phénoménaux accomplis dans les pays riches en matière de couverture vaccinale, a agi, à la fois, comme un facteur aggravant les inégalités avec la montée de la pauvreté dans nos sociétés réputées ou plutôt supposées riches, et comme un accélérateur des changements structurels (télétravail, délocalisation des activités tertiaires dans un souci d’optimisation des coûts, robotisation, automatisation et généralisation de l’intelligence artificielle) avec des conséquences inévitables sur nos systèmes de protection sociale et sur l’emploi.
Il va sans dire que les inégalités de revenu et de patrimoine ne sont pas une fatalité avec laquelle nous devrions nous résigner à apprendre à vivre ou bien à nous remettre aveuglement aux forces du marché pour les corriger grâce à l’initiative individuelle, à la prise du risque entrepreneurial ou au libre échange sans mécanisme de régulation ou de compensation pour les perdants qui sont légion, comme le prétendent les partisans de la mondialisation heureuse. Sachant que celle-ci a peut-être amélioré le sort de certains Chinois ou Indiens, mais elle a provoqué la désindustrialisation de certains pays européens et a mis sur la paille de nombreux individus dont le désespoir a fait le délice et la santé électorale des partis populistes et nationalistes. C’est pourquoi ces inégalités sont en vérité engendrées de manière endogène par le système économique dans lequel nous vivons. En simplifiant à outrance, elles semblent résulter de la polarisation du marché du travail, laquelle est induite par la digitalisation croissante de l’économie, et de manière inattendue par les politiques monétaires non-conventionnelles mises en place dans les pays de l’OCDE depuis la crise financière éclatée en 2008.
L’histoire de la révolution industrielle nous apprend que le progrès technique détruit massivement les emplois à court terme, mais il en crée davantage à long terme et par conséquent il compense au-delà les pertes d’emplois. Mais en vérité l’impact du progrès technique sur l’emploi dépend de deux forces antagonistes:
D’une part un effet de substitution qui est défavorable à l’emploi (les machines, les robots et les logiciels remplacent le travail humain) et qui induit une grande souffrance sociale chez les perdants durant la période de transition, tout particulièrement en l’absence des mesures publiques d’accompagnement (politiques actives d’emploi comme au Danemark ou en Suède, formation professionnelle, aides à la mobilité géographique…).
D’autre part un effet de productivité positif: le progrès technique se traduit souvent par une baisse des prix sur le marché des produits, ce qui pourrait stimuler la demande de biens et services et in fine l’emploi. L’observation du monde réel et les études empiriques ne semblent pas en tout cas corroborer ce scénario hautement optimiste. Bien au contraire, les connaissances factuelles semblent tempérer la vision optimiste associée traditionnellement à la destruction créatrice de type schumpétérien, laquelle a été présentée comme un mécanisme endogène en faveur de l’atténuation des inégalités. Autrement dit, au plan agrégé le progrès technique n’engendre pas forcément en grand nombre des emplois sophistiqués et bien rémunérés. Dans un grand nombre des pays de l’OCDE, selon l’avis de l’économiste français Patrick Artus, la digitalisation de l’économie a exacerbé la polarisation du marché du travail: peu d’emplois sophistiqués bien rétribués et beaucoup d’emplois peu ou pas qualifiés avec des salaires de misère. Ainsi, selon une étude américaine, une création d’un emploi hautement qualifié s’accompagne en parallèle de celle de cinq emplois tertiaires peu qualifiés et faiblement rémunérés (nettoyage, livraisons à domicile, services à la personne…). Sans doute cette pléthore de mauvais emplois tertiaires semblerait être à l’origine de la stagnation des salaires aux Etats-Unis observée sur une longue période par l’économiste Robert Gordon. En clair, la révolution numérique n’a pas les effets d’entrainement puissants sur l’économie comme l’automobile, l’électricité ou les chemins de fer.
La pandémie dont nous continuons à subir les conséquences néfastes a eu au moins le mérite de montrer que l’économie libérale ne peut pas se passer d’un Etat protecteur et assureur. Sans doute avons-nous traversé la vague sanitaire sans trop de dégâts, grâce notamment au soutien de la puissance publique (fonds de solidarité, chômage partiel, prêts bancaires garantis par l’Etat). Mais nous ne devrions pas exclure la vague économique avec ses faillites et ses licenciements massifs qui pourrait survenir, si l’Etat retirait prématurément son soutien à l’économie. Autrement dit, les politiques monétaires ultra-expansionnistes vont probablement perdurer afin de maintenir les taux d’intérêt durablement bas, et partant éviter l’insolvabilité des Etats et des acteurs privés en raison des montagnes de dettes existantes dont une partie est imputable à la crise sanitaire. Or des taux d’intérêt bas ne sembleraient pas avoir un impact significatif sur les investissements créateurs d’emploi, dans la mesure où le capitalisme actionnarial de rentiers semble plus exigeant en matière de rentabilité financière. C’est pourquoi il est à craindre que les injections massives de liquidité par les banques centrales alimentent les bulles spéculatives sur les marchés de l’immobilier et des actifs financiers (les actions par exemple). Ainsi la flambée des prix de l’immobilier renforcerait la richesse patrimoniale des couches aisées de la population et des héritiers fortunés, et elle priverait les ménages jeunes et/ou pauvres de la possibilité d’accéder à la propriété immobilière ou d’acquitter un loyer raisonnable. C’est pourquoi il n’est pas saugrenu d’affirmer que la politique monétaire expansionniste semble avoir un effet douteux sur les investissements. En revanche une chose est sûre, elle nourrit les inégalités patrimoniales.
Bonjour NOEL,
Toujours un réel plaisir à vous lire et sans doute vous ne serez étonné de savoir que j’abonde en votre sens, hormis sur ce point: “en dépit des progrès phénoménaux accomplis dans les pays riches en matière de couverture vaccinale”.
De mon point de vue, observer les politiques/médias reprendre la boîte à outils de Walter Lippmann (1889-1974), notamment par le biais de son ouvrage Public Opinion, paru en 1922, ou se calquer à Harold Lasswell (1902-1978) défendant “la propagande des médias utile aux démocraties car permettant aux citoyens d’adhérer à ce que les spécialistes jugent bon pour eux”, n’est point source de progrès comme je le conçois (réf. voir mon intervention du 12 janvier 2018 à 10:55 min*). Puis, de voir “les mêmes pouvoirs” parvenir à ébranler avec une telle facilité les fondations de toutes démocraties qui se respectent grâce à une batterie de “certitudes encore passablement incertaines”, en l’état des connaissances plurielles, comme si la médecine était soudainement devenue une science dure à l’instar des mathématiques, me pose un réel souci d’éthique. L’économie, comme “science économique et sociale”, doit déjà supporter les conséquences de cette mathématisation contre nature d’une discipline issue des “sciences molles”. Rappelez-vous de John Cochrane de l’université de Chicago qui déclarait “qu’en économie, il n’y a pas assez de maths”. “Un problème” pourtant comblé par les “économistes mainstream” qui pourront se réfugier durant des décennies derrière l’outil mathématique et à tirer argument de l’usage de cette “science dure” pour affirmer à la fois la scientificité de leur discours, suggérer son exactitude et donc le caractère intangible des lois qu’ils révèlent au prisme de leurs théories économiques. Des théories “mainstream” qui tombent pourtant comme des châteaux de cartes cette dernière décennie. Quant à mon autre souci éthique, il repose sur le fait que les politiques vaccinales sont rattachées directement à la face sombre du phénomène de la “science comportementale”, largement exploité à dessein par les politiques dans la “gestion” de cette pandémie. Donc une situation préoccupante à mon goût. Pour ce qui a trait des pays riches en matière de politique vaccinale, peut-être faudrait-il que nos “élites” abordent courageusement le “prix inégalitaire d’une vie humaine” puisque, comme vous le savez, une “VVS” (Valeur Statistique de la Vie) en économie n’a pas la même valeur dans les statistiques d’un pays à l’autre.
Ceci dit, alors même que ces derniers jours ont vu débuter la conférence économique internationale à Cernobbio, au bord du lac de Côme, réunissant le gratin des “sciences économiques” et de la politique, avec comme axe de réflexion les préoccupations de l’avenir économique autour de la pandémie et des inégalités, la piqûre de rappel de l’économiste Joseph Stiglitz en marge du “Forum Ambrosetti” ne manquera pas sa cible: “l’idéologie néo-libérale, qui a prévalu ces quarante dernières années, n’a pas eu d’effets bénéfiques pour nos sociétés et nous devons la repenser”, dira-t-il.
Quant à la jeune économiste franco-américaine, Esther Duflo, qui fut co-lauréate du “Prix Nobel d’économie” en 2019 pour ses travaux portant sur l’analyse de terrain de la pauvreté, en rupture sur le fond et la forme avec les théories économiques dominantes (favorables au marché et à la mondialisation) n’a-t-elle pas récemment rompu la langue de bois avec son constat? “Au cours des trente dernières années, si d’un côté les revenus de la moitié la plus pauvre de l’humanité se sont accrus avec une amélioration du bien-être, qu’il s’agisse du taux de scolarité des enfants, de la mortalité infantile, du logement, etc, de l’autre, la part de la richesse mondiale possédée par les 1 % les plus riches a explosé aussi bien aux États-Unis et en Europe qu’en Chine ou en Inde”. Ajoutant sans surprise que si “les inégalités croissantes deviennent tellement fortes qu’elles ne sont plus soutenables, comme on le voit aux États-Unis, et qu’une fraction aussi importante de la population, y compris chez les Blancs, est paupérisée au point de vouloir tout casser, les responsables politiques finissent par s’en soucier car cela menace la survie du capitalisme lui-même”. Esther Duflo reconnaîtra après le constat de l’OCDE et du FMI en 2014/2015, que la théorie du “ruissellement” – selon laquelle la fortune des plus riches apporterait des retombées positives pour tous – est un leurre. Pourtant, rien de nouveau que les hétérodoxes ne savent déjà. “On n’a jamais vu aucun signe que cette théorie fonctionne” affirmera-t-elle, avant de souligner cet élément clé: “les gens l’ont longtemps acceptée car cela alimente l’espoir… Cet optimisme a permis aux hommes politiques de continuer à appliquer des politiques inégalitaires parce qu’il y avait toujours une chance de se retrouver parmi les gagnants”.
En effet, les inégalités ne sont en rien une fatalité.
Bien à vous.
*Mon intervention du 12 janvier 2018 à 10:55
https://blogs.letemps.ch/sergio-rossi/2018/01/08/linitiative-no-billag-fait-table-rase-du-pluralisme/
Bonjour Raymond,
Merci pour votre commentaire éclairant et intéressant ainsi que le commentaire concernant la manipulation des foules par les médias et les gourous dotés d’un pouvoir d’hypnose exceptionnel. Je partage également les remarques relatives à la mathématisation de l’économie et les critiques adressées à la théorie du ruissellement qui tend, à mes yeux, à légitimer l’utilité des riches par leur capacité à dégager de l’épargne et à orienter celle-ci vers les investissements créateurs d’emplois pour les pauvres.
En clair, la richesse ruisselle du sommet de la pyramide sociale vers la vallée des larmes en conformité avec la loi de la gravitation. Le problème avec cette croyance c’est que les réformes fiscales en faveur des riches ne se sont pas traduites par des créations massives de bons emplois qualifiés. En outre cette explication, qui a fait florès sous l’Administration Reagan, ne semble avoir aucun fondement académique sérieux. En effet il est douteux que l’épargne des ménages très riches ruisselle vers le bas, dès lors qu’on tient compte de l’incertitude entourant les décisions économiques. En revanche il existe de bonnes raisons de penser qu’elle ruissellerait vers les paradis fiscaux où la taxation des capitaux est douce, comme au bon vieux temps du secret bancaire helvétique, quand, par exemple, les riches Français planquaient leur fortune dans les banques suisses pour échapper à ce qu’ils appelaient à tort ou à raison l’inquisition fiscale de leur propre pays.
Cependant, la théorie du ruissellement est efficace car elle permet aux pauvres de rêver d’une vie meilleure, de manière analogue à la promesse du paradis de la Bible, tout en acceptant le démantèlement des services publics occasionné par la baisse des recettes fiscales de l’Etat du fait des réductions d’impôts accordées aux riches.
Enfin, la théorie du ruissellement ignore un principe important de l’analyse keynésienne: la baisse des impôts des catégories à forte propension à consommer a de fortes chances de stimuler la croissance économique via la demande des biens de consommations et donc l’emploi, parce qu’il y a, semble-t-il, plus d’incertitude du côté des décisions d’investissement que du côté des décisions de consommation.
Bien à vous.
Bonjour NOEL,
Merci aussi pour votre réaction et ce partage apprécié et constructif, ce qui rend ce blog encore plus vivant. Et, au-delà des billets à très hautes valeurs ajoutées de l’éminent Professeur et Docteur en économie, Sergio Rossi, pour lequel j’éprouve un profond respect, le quotidien “LE TEMPS” nous permet encore une liberté de ton qui malheureusement se perd de nos jours. Qu’ils en soient aussi remerciés.
Voyez-vous, NOEL, alors même que le G20 souhaite un taux minimal de 15% pour la fiscalité des multinationales, restant bien inférieur au minimal de 25% recommandé par certains experts de la question, à l’instar par exemple de l’économiste Gabriel Zucman – professeur associé à l’université de Californie à Berkeley, connu pour ses nombreux travaux sur les inégalités sociales et les paradis fiscaux – le secteur bancaire tire toujours profit des pays à la fiscalité plus que complaisante (paradis fiscaux). Telle est la principale conclusion d’une étude publiée le 6 septembre 2021 par l’Observatoire européen de la fiscalité, associée à l’École d’économie de Paris. Selon ce rapport, environ un quart des profits dégagés par les 36 grandes banques européennes du panel sont logés dans des pays où le taux effectif d’imposition est inférieur à 15%. Des établissements qui, en leur temps, ont bénéficié de mesures de sauvetage via les deniers publics (faisant mécaniquement augmenter la dette publique) au plus fort de la crise en zone euro. Une “ZMO” qui reste toujours incompatible selon les critères de l’économiste Robert Mundell, récipiendaire du “prix Nobel d’économie” en 1999 pour son travail sur le sujet. Bref.
Bien évidemment que la Suisse, “par le passé”, a tiré une grande partie de sa richesse par l’intermédiaire d’un système bien rôdé en vue de syphonner les potentielles recettes de pays tiers. Pourtant, à la lecture des câbles diplomatiques, l’on voit ô combien “cette industrie” fut déjà dénoncée par le gouvernement Kennedy aux autorités helvétiques dans les années 1960. En fait, ceci pourrait s’apparenter au film de Francis Veber, “Le Diner de cons”. Mais n’oublions pas non plus, alors même que la France était au cœur du désarroi propre à l’orthodoxie budgétaire (2011-2014) suite à la crise financière de 2007/2008, puis de 2009 avec la crise des dettes souveraines (en Europe) exacerbée par la “schizophrénie politicienne” de l’ordo-libéralisme allemand (Luthérien), que la France restait “une mine d’or pour des grandes entreprises qui y bénéficiaient de crédits d’impôts et d’allègements fiscaux parfois substantiels sur des dépenses affectées à différents postes. Un contexte qui a encouragé l’installation sur l’Hexagone de grands noms comme Google ou Amazon. A l’exemple aussi de ces 171 compagnies ou usines qui ont opté en 2011 pour la France, préférée de très loin à l’Allemagne et à la Grande Bretagne, sachant que le gouvernement français persévèrait – en 2013 – dans cette voie avec des mesures emblématiques comme les allègements de 20 milliards d’euros de charges, ou encore le fameux “Crédit Impôt Recherche” donnant droit à un remboursement de 45% des dépenses de l’entreprise sur le poste de la recherche et du développement (R&D)”. Tandis qu’en parallèle la classe moyenne inférieure comme supérieure et les PME s’appauvrissaient à l’ombre de taux fiscaux prohibitifs et tout ça sous une pluie de taxes fiscales opaques totalement irrationnelles.
Ceci étant dit, nous sommes en 2021 avec une crise sanitaire majeure où les questions économiques taraudent naturellement. De même que les risques associés, tel un mouvement devenu perpétuel. Mais les Français dans leur majorité (et pas qu’eux, est-il utile à préciser?) savent-ils seulement que les entreprises les plus sensibles – les “Zombies” – notamment celles sous “Leveraged Buy-Out” (montage financier permettant le rachat d’entreprises grâce à l’utilisation de la dette afin de profiter d’un important effet de levier) ont pu profiter de procédures étatiques de sauvegarde, sans changer leur schéma intrinsèque de fonctionnement, notamment au travers de prêts garantis par l’État? En même temps, à l’heure d’un énième réveil tardif des politiques, l’État avait-il d’autres choix. Toujours est-il que l’agence de notation Moody’s eu récemment constaté que le taux de défaut à l’échelle mondiale des entreprises sous “LBO” a doublé, passant de 3,2% avant la crise sanitaire, à 6,4% actuellement. Cette même agence a tiré la sonnette d’alarme sur la situation de ces entreprises (au cœur d’un dispositif spéculatif financiarisé) qui font planer un scénario de faillite systémique sur fond de crise économique.
Pour le solde, il me semble que nous devrions bien comprendre que depuis que la “Supply-side economics” est arrivée à bout touchant – anté pandémie mondiale – que nos “élites” s’évertuent à la garder sous respirateur artificiel afin de lui réinsouffler vie avant de sortir des couloirs la version 2.0 de l’austérité, nos “élites” font une énième fausse route risquant bien – cette fois – d’être fatale au modèle démocratique tel que nous le concevions encore lors du passage au 21ème siècle.
Ne dit on pas, selon la maxime, que “les révolutions naissent des gouvernements qui échouent”?
Bien à vous
A propos du rôle des mathématiques en économie.
Il est incontestable que l’économie est l’une des sciences sociales qui use et abuse de l’outil mathématique. Elle s’évertue également à mimer la démarche inductive de la physique en vue de fournir une explication positive du monde économique et social; alors qu’en réalité l’expérimentation contrôlée en laboratoire ne semble pas praticable. Car les atomes du monde walrasien, en l’occurrence les acteurs économiques en chair et en os, ne sauraient être assimilés au Boson de Higgs ou à des rats de laboratoire. En effet les humains modifient leurs comportements lorsqu’ils savent qu’ils sont l’objet d’observation.
Bien sûr, l’économie comportementale apporte un éclairage intéressant, notamment quand elle relativise la rationalité prêtée aux acteurs économiques par la théorie néoclassique: mimétisme, biais cognitifs et émotionnels, normes sociales et culturelles. Malgré la relativisation des vertus attribuées à l’homo oeconomicus, il semble délicat d’extrapoler les comportements individuels ou de petits groupes de l’ensemble de l’économie. Car au sein d’une foule ou d’une masse l’individu tend à modifier son comportement, par exemple mimétisme exacerbé lors des bulles et krachs sur les marchés financiers.
Pour ma part, j’estime que nous ne devrions pas faire le procès des mathématiques, car celles-ci sont des techniques neutres qui peuvent cependant être utilisées à des fins qui n’ont rien à voir avec le bien-être collectif. Autrement dit, elles dépendent de l’intention de l’utilisateur à l’instar des instruments de la politique économique. De plus, force est de constater que, parfois, le recours à la modélisation des questions économiques est utilisé comme un cache-misère de la vacuité de la réflexion économique. Ainsi, on n’a pas besoin de recourir au théorème du point fixe pour prouver l’existence du chômage involontaire de type keynésien: c’est totalement stérile de traduire par une formule mathématique l’intuition selon laquelle les entreprises contraintes sur le marché des biens et services révisent à la baisse leur demande de travail et que les ménages rationnés sur le marché du travail révisent à la baisse leurs dépenses de consommation. Autrement dit, le chômage involontaire résulte des comportements non-coopératifs des acteurs économiques qui n’internalisent pas les externalités négatives de leurs décisions. Dans ce contexte il est évident que le recours à la théorie des jeux semble plus approprié pour justifier la politique économique comme mécanisme correcteur du défaut de coordination intrinsèque aux décisions décentralisées.
Dans la même veine, on peut s’interroger sur les outrances de la nouvelle macroéconomie classique, qui emploie les techniques de l’ingénieur pour prouver que la politique monétaire engendre du bruit, lequel constitue une source sérieuse de l’instabilité du système économique. Bref, un usage excessif des mathématiques de haut vol pour redécouvrir les résultats de l’école autrichienne: l’expansion monétaire perturbe le signal des prix relatifs et nuit à l’allocation des ressources. Ce n’est pas tout: les nouveaux classiques nous expliquent que le chômage révélé par les statistiques reflète un arbitrage intertemporel des individus en fonction des salaires proposés et que les politiques de stabilisation ne sont pas nécessaires, dans la mesure où les fluctuations du PIB et de l’emploi sont des réponses optimales des agents économiques à des chocs exogènes. Autrement dit, il n’y a rien à stabiliser et que les gouvernements devraient mettre un terme à l’oisiveté subventionnée (suppression des indemnités chômage).
Compte tenu de ces dérives, nous ne devrions pas nous étonner que la discipline économique soit l’objet des critiques récurrentes: trop formalisée, trop abstraite et suspecte de servir les intérêts des dominants. Pire, l’outil mathématique pourrait être mobilisé comme un vernis logique au service d’une croyance libérale quasi-religieuse. Pourtant l’introduction des mathématiques était considérée à l’origine comme un instrument censé apporter de la rigueur, de la précision et donc de faire dissiper le flou qui règne dans les œuvres des pères fondateurs comme Adam Smith ou Alfred Marshall. En effet, la modélisation utilisée à bon escient pourrait mettre en évidence des résultats certes sensibles aux hypothèses,mais susceptibles d’éclairer les décisions économiques des acteurs publics et privés. Tout particulièrement, quand un modèle est construit avec un minimum d’hypothèses, il pourra nous réveler certaines propriétés exploitables au niveau de l’action; alors qu’un raisonnement purement littéraire aussi sophistiqué soit-il serait incapable de les détecter. Par exemple, la théorie de la politique économique développée par Jan Tinbergen nous enseigne que la politique monétaire devrait être moins agressive en présence de l’incertitude que dans un contexte déterministe.
En d’autres termes, l’incertitude sur les effets de l’arme monétaire devrait inciter les banques centrales à faire preuve de conservatisme et donc à adopter le principe de prudence. Notons en passant que cet argument découlant de la modélisation de la politique monétaire pourrait fournir paradoxalement un argument aux néolibéraux qui sont très remontés contre «l’argent magique» par les temps qui courent. Par ailleurs, nous ne devrions pas prendre les résultats de la modélisation pour parole d’évangile, car un modèle est souvent une représentation ultra-simplifiée qui ignore la complexité du monde réel. Cependant, il faut préciser que la modélisation suggère aussi qu’en présence des effets incertains de la politique économique, les décideurs politiques devraient utiliser tous les instruments à leur disposition plutôt qu’un seul instrument de politique, en l’occurrence la politique monétaire. La raison en est que la diversification des instruments réduit le risque. Il est curieux de constater que la modélisation mathématique donne l’impression au profane qu’elle enfonce des portes ouvertes en redécouvrant le bon sens paysan: dans le doute je m’abstiens ou bien je ne mets pas mes oeufs dans le même panier.
Il importe de noter que la modélisation des questions économiques n’est pas toujours neutre, car elle peut produire des recommandations en faveur d’une politique libérale. Considérons, par exemple, l’introduction d’une taxe sur un bien ou un service échangé sur un marché concurrentiel. A l’aide d’un modèle de l’offre et de la demande on peut montrer que le fardeau fiscal tend à se répartir entre les producteurs et les consommateurs selon les élasticités de l’offre et la demande, et qu’en tout état de cause, le côté de marché qui ne dispose pas de solutions de rechange supporte l’essentiel du poids de la taxe. Il me semble bien que cette méthode est utilisée pour taxer lourdement le travail, sous prétexte que la capital est plus mobile que la main-d’œuvre. C’est le principe de la taxation optimale initiée (article de 1929) par le mathématicien et économiste anglais Frank Ramsey (assistant de J.M. Keynes à Cambridge) en utilisant le calcul de variations développé initialement par le mathématicien suisse Leonhard Euler (1707-1783). En clair, les résultats issus du modèle mathématique pourraient plaider en faveur de l’inégalité comme la suppression de l’impôt sur la fortune.
De toute évidence, tout modèle est une représentation simplifiée, parfois de façon outrancière du monde réel que les recherches académiques tentent d’approfondir et de le débarrasser de ses lacunes. Ainsi que le dit Robert Solow dans son célèbre article sur la croissance de 1956 «A contribution to the theory of economic growth»: «Toute théorie repose sur des hypothèses qui ne sont pas tout à fait vraies. C’est ce qui en fait de la théorie. L’art d’une bonne théorisation est de faire des hypothèses simplificatrices de telle manière que les résultats définitifs n’y soient pas très sensibles. Une hypothèse cruciale est une hypothèse sur laquelle reposent les conclusions, et il est important que les hypothèses cruciales soient raisonnablement réalistes. Lorsque les résultats d’une théorie semblent découler spécifiquement d’une hypothèse cruciale, alors si l’hypothèse est douteuse, les résultats sont suspects».
De nombreux économistes de la pensée dominante sont convaincus que nous ne pouvons pas nous passer de la modélisation, c’est le cas notamment de Jean Tirole: Le modèle guide le travail empirique et sans modèle à tester, les données ne révèlent pas grand-chose d’utilisable pour la politique économique. Mais on ne sait pas de quel modèle notre Prix Nobel parle. Si les banquiers centraux avaient suivi les recommandations des modèles fondés sur l’hypothèse des marchés financiers efficients, ils auraient fait sans doute preuve de passivité face aux crises financières engendrées de façon endogène par le système, et ils auraient à coup sûr conduit l’économie dans le mur! C’est pourquoi il n’est pas absurde d’affirmer que les travaux des économistes comme Milton Friedman, Anna Schwartz ou Ben Bernanke se sont révélés plus utiles que la formule du roi Midas, entendez l’équation de Black et Scholes. Pour en savoir plus on peut se reporter au livre du mathématicien anglais Ian Steward: «Les 17 équations qui ont changé le monde», tout particulièrement le chapitre 17: la formule du roi Midas. La recette permettant de transformer n’importe quoi en or. Sauf que le secteur de la finance avait oublié comment finit la légende.
En effet, l’équation de Black et Scholes a changé le monde en créant un secteur d’activité à l’essor billiardaire, ses généralisations, utilisées sans discernement par une petite coterie de banquiers, ont de nouveau changé le monde en contribuant à un effondrement financier multibillionnaire dont les effets d’une nocivité sans précédent, qui gagnent à présent des économies nationales entières, se font encore sentir aux quatre coins du monde. L’équation relève du royaume des mathématiques du continuum et plonge ses racines dans les équations différentielles partielles de la physique mathématique. Bon nombre d’économistes chevronnés ne l’ont jamais remise en cause, alors qu’elle manque cruellement de soutien empirique convaincant. Dans les rares expériences réalisées pour observer la façon dont les individus prennent leurs décisions financières, les scénarios classiques ne tiennent généralement pas. C’est un peu comme si les astronomes avaient passé le dernier siècle à calculer le mouvement des planètes à partir de ce qu’ils considéraient comme raisonnable sans jamais se donner la peine d’observer.
Les économistes rompus aux techniques mathématiques soucieux de faire une carrière brillante dans des universités réputées ont poussé la quête d’esthétisme trop loin au point de confondre l’instrument avec la finalité. Le recours aux mathématiques à outrance et donc à l’axiomatisation de l’économie à la manière du mathématicien David Hilbert, qui voulait fonder les mathématiques sur la logique axiomatique, mais dont les espoirs ont été torpillés par les théorèmes d’incomplétude de Gödel, ne serait pas un signal de qualité scientifique. Heureusement les article ingénieux et bourrés d’équations, mais superficiels dans leur contenu,sont vite oubliés à moins qu’ils ne constituent une avancée méthodologique qui facilitera l’émergence des contributions plus appliquées et susceptibles d’apporter des solutions concrètes à l’amélioration de notre systéme économique.
Bonjour NOEL,
Merci pour cet enrichissant développement et pour lequel je tiens toutefois à préciser ceci:
Ce n’est pas le procès des mathématiques qui pose un problème, puisqu’il n’y en a point sur l’autel de cette “science dure”; mais l’usage abusif qui en est fait par les “ayatollahs de la pensée dominante en économie” en pose un véritable, et de taille. Ces derniers, grâce à l’exercice tyrannique des mathématiques, n’ont laissé plus aucune place “aux sciences sociales”. Autrefois, Keynes, préoccupé par la tournure que prenait l’économétrie sur le plan sociétal, avançait déjà que “la vérité n’est pas obtenue comme résultat d’une sophistication formelle, elle tient pour l’essentiel à la capacité de générer une efficacité pratique des énoncés”. Et dans cette continuité, comment faire l’impasse sur l’économiste américain Robert Heilbroner (1919-2005), principalement connu pour “The Worldly Philosophers”? Dans sa première édition de 1953, l’ouvrage annonçait “un voyage à travers l’éthique” et pour cela partait à la découverte d’une poignée d’hommes qui, par leurs idées, donnèrent sens au monde économique moderne. Tous différents – “il y eut parmi eux un philosophe et un illuminé, un pasteur et un agent de change, un révolutionnaire et un gentilhomme, un esthète, un septique et un vagabond” – ils élaborèrent pour cela, intrigue, pièce, drame, scène, pour lever les doutes et les anxiétés que faisait naître un nouveau et vaste monde économique apparemment chaotique et pourtant en constante évolution ; leurs récits permettant en définitive aux communautés humaines de comprendre et d’agir en vue d’adapter et de contrôler le capitalisme. L’ambition de ces hommes ne pouvait pas être celle de simples techniciens ou experts : leurs imaginations, nourries par ce large éventail de biographies singulières, leur donnaient l’audace d’embrasser l’ensemble de ce processus dans ses dimensions économiques, mais tout autant politique, sociale, culturelle, que paraissait rythmer l’accumulation progressive de richesses. Cet économiste américain, Robert Heilbroner, au fil de son épopée, posera un énième constat: “les mathématiques avaient insufflé une rigueur à la science économique avant de la tuer”.
On ne le répétera jamais assez, NOEL, aucun procès n’est dirigé à l’encontre des mathématiques, mais mené contre les extrémistes de la pensée économique dominante qui en ont détourné les vertus. Ainsi que leurs serviteurs. À cet égard, le brûlot adressé à la caste des politiques – en 2016 – par Manuela Cadelli, présidente de l’Association syndicale des magistrats en Belgique, est également emblématique d’un profond malaise en soi: “Le libéralisme était une doctrine déduite de la philosophie des Lumières, à la fois politique et économique, qui visait à imposer à l’Etat la distance nécessaire au respect des libertés et à l’avènement des émancipations démocratiques. Il a été le moteur de l’avènement et des progrès des démocraties occidentales. Le néolibéralisme est cet économisme total qui frappe chaque sphère de nos sociétés et chaque instant de notre époque. C’est un extrémisme. Le fascisme se définit comme l’assujettissement de toutes les composantes de l’État à une idéologie totalitaire et nihiliste. Je prétends que le néolibéralisme est un fascisme car l’économie a proprement assujetti les gouvernements des pays démocratiques mais aussi chaque parcelle de notre réflexion. L’État est maintenant au service de l’économie et de la finance qui le traitent en subordonné et lui commandent jusqu’à la mise en péril du bien commun”. On voit donc bien que les motifs d’ accusations à l’encontre des méfaits d’une idéologie malveillante et destructrice impactent toutes les sphères sociales et sociétales.
Parmi d’autres, en son temps – avant l’intervention de l’économiste Jean Tirole qui usera par la suite du poids de son Nobel pour tenter de dissoudre le “pluralisme en sciences économiques”(*) – le”collectif Peps-Économie” ne demandait-il pas un enseignement pluraliste dans le supérieur en économie? Au motif que “la dimension exagérément technique – les outils quantitatifs principalement – des enseignements dispensés sont trop présents”. L’absence d’ancrage dans la réalité économique et sociale fut aussi un motif d’insatisfaction, sans oublier le côté monodisciplinaire et la faible présence des matières fondatrices de l’économie comme l’histoire de la pensée économique ou encore l’épistémologie. Ces doléances ne sont pas sans faire écho à Heilbroner exposé précédemment.
Cette croyance dans une science “socialement désincarnée” qui ne mobiliserait que des techniques quantitatives peut rapidement conduire au développement et à la reproduction d’”une scolastique suspendue dans le vide” (Heilbroner, Milberg, 1998) , fermée sur elle-même, faiblement pluraliste, et pourtant sûre de ses droits et de ses forces (Colander, Klamer, 1987 ; Fourcade, Ollion, Algan, 2015).
Eh bien nous y sommes à présent!
Bien à vous
(*) https://blogs.letemps.ch/sergio-rossi/2015/05/18/a-quoi-servent-les-economistes/
Bonjour Raymond,
Merci pour votre contribution au débat qui enrichit le blog du professeur Rossi. Il va sans dire que je partage votre critique adressée au système économique dans lequel nous vivons et qui est dominé par la cupidité et les inégalités. A ce propos la dernière tribune du professeur Rossi met le doigt sur l’urgence de mettre les instruments de la politique économique au service du bien commun, afin de contrecarrer la montée de la pauvreté et des inégalités. Je me souviens d’avoir lu le modèle de Goodwin, qui est bâti sur une intuition marxienne: toute croissance économique porte potentiellement les germes de sa propre destruction et les salaires et les profits peuvent être modélisés comme un équilibre-prédateurs-proies. Avec la pandémie qui continue avec ses variants, les pharmas, les entreprises du numérique comme Amazon et consorts se sont considérablement enrichies aux dépens des travailleurs ou plutôt des premiers de la corvée (personnel soignant, employés des transports communs, de la grande distribution, etc). Sans doute ne serions-nous surpris d’apprendre que le partage de la valeur ajoutée s’est infléchi en faveur des profits. Dans cette hypothèse, il serait hautement souhaitable que les entreprises modèrent la distribution des dividendes aux actionnaires et qu’elles fassent un effort exceptionnel en faveur des salaires, sachant que l’équilibrage endogène qui est censé se produire dans le modèle de Goodwin n’a aucune chance de jouer spontanément. La raison en est que la courbe de Phillips a disparu depuis belle lurette. Enfin, je suis également d’accord avec vous sur la nécessité d’un pluralisme d’idées et d’approches en économie qui reste, comme vous le savez, une science fondamentalement humaine et sociale.