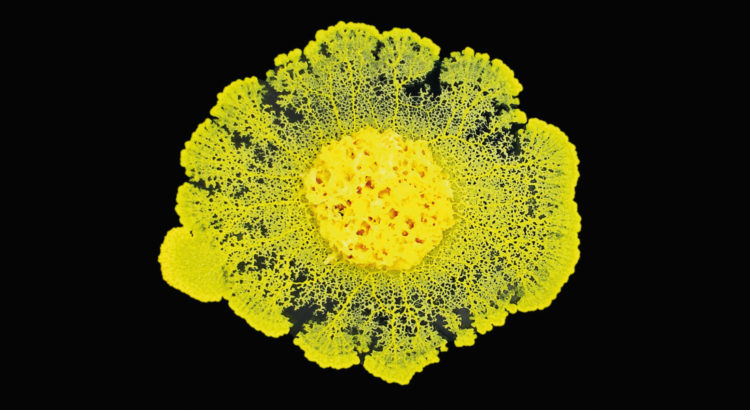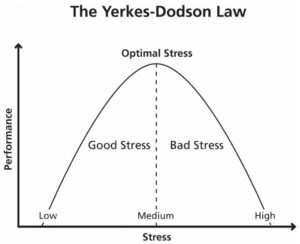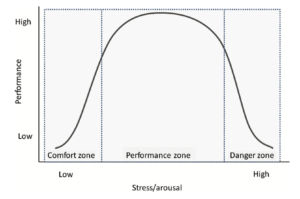Et si les “gourous” du management étaient précisément cela : des figures promotrices d’un new age neuneu et de l’ésotérisme le plus obscurantiste. Illustration avec l’un des plus influents : Otto Scharmer et sa “Theory U”.
Dans une précédente chronique, nous nous étonnions de l’apparition du “leadership spirituel” dans le champ du management, un puit sans fonds de propos neuneus et non-scientifiques. On commence vraiment à s’inquiéter quand un des ouvrages en question est “labellisé” par la Fédération Nationale pour l’Enseignement et la Gestion des Entreprises (FNEGE), une fondation française qui comprend dans son conseil d’administration des représentants ministériels, et des professeurs d’université ou du Collège de France… Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Les sciences de gestion et le management seraient-il devenus des promoteurs de l’irrationalité et du n’importe quoi ? C’est malheureusement le cas. Le terme de “gourou” du management n’a jamais aussi pertinent qu’aujourd’hui. Penchons-nous sur le cas Otto Scharmer. C’est édifiant.
Gallilée vs Jean-Claude Van Damme
Lorsque je me suis à nouveau mis à lire de la littérature managériale après une interruption d’une quinzaine d’année, on m’a conseillé, pour me mettre à jour, deux ouvrages : “Reinventing Organization” de F. Laloux et “Theory U” d’Otto Scharmer. J’ai déjà eu l’occasion de dire quelques mots du premier dans une précédente chronique et j’aurai l’occasion de développer dans un ouvrage en cours d’écriture. L’ouvrage de Scharmer (2016, 2018) est devenu un classique du coaching, du développement personnel et de la transformation des organisations. Quel est son propos ?
Scharmer nous propose d’adopter sa méthode en U qui est une “technologie sociale” qui nous fera passer d’une “conscience égo-systémique” à une “conscience éco-systémique” (2018:36). Elle consiste à procéder à un voyage intérieur individuel et collectif en s’appuyant sur un “esprit ouvert”, “un coeur ouvert”, “une volonté ouverte” en passant par trois étapes (observer, rentrer en soi, prototyper) tout en suivant un processus en cinq mouvements (co-initier, co-sentir, co-présencer (sic), co-créer, co-développer). En quelques mots, il s’agit de se transformer pour transformer nos organisations et sauver le monde, victime d’une triple crise : écologique (division du soi et de la nature), sociale (division du soi et de l’autre) et spirituelle (division du soi d’avec le soi) (2016 :2).
Pour établir une certaine crédibilité à sa “théorie”, Scharmer annonce la couleur (2018: 10): son processus en U puise dans différents courant de la conduite du changement: la recherche-action et l’organisation apprenante de P. Senge et cie, le design thinking de T. Brown, le travail de développement de la conscience, les sciences cognitives et la phénoménologie de F. Varela et cie et le mouvement des droits civiques de Luther King, Mandela et Gandhi (manque le Dalai Lama, mais il est pas loin)… Comme on peut le constater Scharmer embrasse large et de façon oecuménique… Il faut dire qu’il ne vise rien de moins qu’une transformation de la science pas moins révolutionnaire que celle de Gallilée (2016 : 15) reposant sur une “awareness based action” probablement inspirée par Jean-Claude Van Damme.
Une révolution régressive
Scharmer est Maître de conférence au prestigieux Massachusetts Intitute of Technology (MIT), il se doit donc de donner quelques cautions scientifiques à son approche surtout s’il nous promet une révolution scientifique. Problème : c’est du vent ! Jugeons-en ! Parmi les sources d’inspiration de notre gourou (2016 : lxi, ss.), relevons en deux :
- Ken Wilber pour ses travaux sur les états de consciences et de développement et sa “théorie intégrale de la conscience” dont le contenu relève clairement du New Age neuneu qui se donne des airs de scientificité en nous expliquant que toute réalité est composée d’une particule fondatrice : le holon…;
- Fransisco Varela, neurobiologiste chilien qui a allègrement surfé sur les analogies scientifiquement douteuses entre le vivant et le social avec ses notions de “autopoïese” et d’auto-organisation (Terré 1998 : 9ss.). Notions également reprises par le prix Nobel de la rigueur scientifique qu’est Frédéric Laloux avec son “Reinventing Organizations”.
La réalité, c’est que le propos de Scharmer ne repose sur pas grand chose d’autres que des anecdotes, des concepts mal ou peu définis, des affirmations rarement soutenues par des références bibliographiques explicites. Sa “théorie” n’est rien d’autre qu’une mode managériale (Kühl 2016 : 3) sans fondement empirique démontré et sans base théorique solide (Heller 2019).
Scharmer a raison, il nous propose bien une transformation de la science: celle qui consiste à revenir à une conception pré-Galiléenne de la démarche scientifique, irrationnelle, spiritualiste et ésotérique ! Il nous le dit clairement en plaçant Rudolf Steiner au pinacle des inspirateurs de sa théorie.
Anthroposophie, ésotérisme et occultisme*
A trois reprises dans son ouvrage (2016 : 30-1), Scharmer rend hommage à Rudolf Steiner le père fondateur de l’anthroposophie, un mouvement ésotérique et occultiste dont l’empire s’étend notamment aux Ecoles Steiner-Waldorf, aux produits de soin Weleda et à la “médecine anthroposophique”, en passant par l’agriculture avec la biodynamie et sa marque Demeter. Autant de pratiques sans aucun fondement scientifique, mais complètement délirantes, auxquelles il fait encore allusion à mot couverts dans son oeuvre :
- Promotion de la “salutogénèse” comme alternative à la “pathogénèse” (2018: 166) sur laquelle s’appuie la pseudo “médecine anthroposophique”;
- Promotion de la “pédagogie” des Ecoles Steiner-Waldorf : “Education 4.0 : système reliant les étudiants à leurs sources de créativité et leur essence humaine, permettant de sentir et de développer les possibilités émergentes (sic). Ce système d’apprentissage profond est déjà mis en oeuvre dans certaines écoles alternatives et l’ensemble du système scolaire finlandais” (2018 : 168)
- Promotion de la biodynamie : “Les fermes deviennent des lieux de renouveau et de ressourcement économique, écologique, social, culturel et spirituel et des espaces de guérison des écosystèmes” (2018 : 168).
Quand ça va tout droit, ça va dans le U
On veut croire que la plupart des lecteurs n’ont pas relevé ces références par ignorance ou par paresse. Le problème ne serait pas si inquiétant si la Théorie U n’était pas devenue mainstream dans les milieux du coaching, du développement personnel et surtout si son contenu n’était pas relayé dans le monde académique. Il suffit de quelques clics pour relever le nombre incalculable de coachs qui en font le fondement de leur méthode et de leurs pratiques. Quant au monde académique, on trouve de plus en plus souvent des formations délivrées par des universités ou des “business schools” : l’université de Strasbourg délivre un diplôme “Leadership, Méditation, Neurosciences” au sein duquel la Théorie U figure en bonne place ou encore la Haute Ecole de Gestion de Genève qui propose un Certificate of Advanced Studies (CAS) en “Bonheur dans les organisations” dont le processus d’apprentissage s’appuie sur les travaux de Scharmer.
Alors quoi ? Faut-il se résigner à constater que le management prend toujours plus un tournant spiritualiste, irrationnel et obscurantiste ?
Non. On peut au contraire chercher à mettre en lumière ses fondements délirants dans l’espoir que l’on se rendra compte au mieux de son inanité, au pire de sa dangerosité.
Le bullshit est spirituel. Dommage qu’il ne soit pas drôle, on pourrait en rire.
Pour le moment, c’est à pleurer.
Références :
W. Heller. The Philosophy of Theory U: A Critical Examination. Philosophy of Management (2019) 18:23–42
S. Kühl. 2016. The Blind Spots in Otto Scharmer’s Theory U. The Reconstruction of a (Change-) Management Fashion. Bielefeld University. Working paper 8.
O. Scharmer. 2016. Theory U. Leading from the Future as It Emerges. Oakland : Berett Koehler
O. Scharmer. 2018. Théorie U. L’essentiel. Gap: Editions Yves Michel
*Pour s’informer sur ce qu’est l’anthroposophie et s’informer sur sa nature ésotérique et occultiste, on ne saurait trop recommander les références suivantes :
– G. Perra & E. Feytit, Une vie en anthroposophie: la face cachée des écoles Steiner-Waldorf, La Route de la Soie, 2020 et la série de podcast de Meta de Choc.
– le site internet de l’ancien anthroposophe G. Perra
– le site internet de Free Binder qui porte sur la mindfulness et a publié quelques article sur l’anthroposophie.