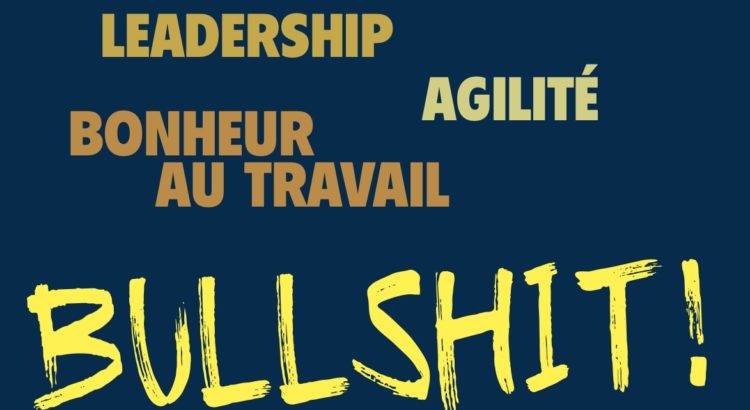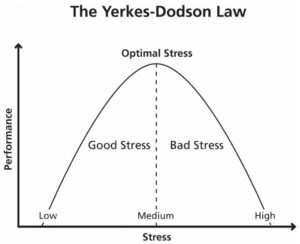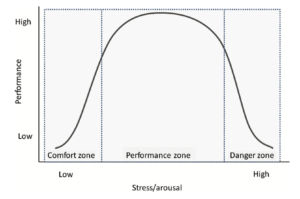L’intelligence collective fait émerger l’innovation dans les organisations grâce aux ateliers de brainstorming, de gamestorming, ou de design thinking. Vraiment ? Si ces techniques permettent de générer des idées, elles ne garantissent en rien la matérialisation de la nouveauté. Victimes de myopie organisationnelle ces approches conçoivent l’innovation comme un processus fluide de création harmonieuse et font l’impasse sur l’existence même de ce qu’est l’innovation dans les organisations : un conflit créateur.
Malgré le titre de son ouvrage séminal “Change by Design. How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation“, Tim Brown, l’un des papes du Design Thinking est avare en conseils sur comment on prépare ou on adapte une organisation existante. Tout au plus nous conseille-t-il de “prototyper” les organisations selon les principes du DT (sic), d’organiser des workshops, de réformer le leadership, de constituer des équipes interdisciplinaires, bref de développer une approche systémique (p.174 ss.).
Dans le plus récent “Guide du design thinking“, M. Lewrick, P. Link et L. Leifer, (2019) consacrent quatre pages sur près de trois cents cinquante à la question “Comment préparer l’organisation à une nouvelle mentalité?” (p. 190 à 193), dont une intégralement destinée à répondre à la question : “comment faire pour inscrire le design thinking dans l’organisation?” (p. 193). Voici en vrac les réponses : “reposer (le DT) sur un réseau d’utilisateurs et de soutiens dans toute l’entreprise“; “l‘idéal est que tous les salariés se considèrent comme et agissent comme des entrepreneurs“; “les dirigeants devraient faire de la centricité client un thème crucial, stratégique et le dire à tous leurs collaborateurs“; “vision claire“; “socle de confiance“; “mentalité ouverte“; “structure et cultures ouvertes“; “mise en oeuvre holistique” etc.
Convenir que dans les deux cas, les considérations organisationnelles développées sont faibles – quand elles ne sont pas teintées d’une charmante naïveté – ne revient nullement à remettre en question l’intérêt de l’invention organisationnelle que constitue le Design Thinking. Cela revient simplement à dire que faire appel à l’intelligence collective ou aux changement de “mindset” ne suffit pas et que les “faiseurs-inventeurs” ne sont pas de très bons innovateurs, n’en déplaise à la doxa.
L’innovation ordinaire
Dans une précédente chronique, nous tendions avec Michel Crozier et Ehrard Friedberg un lien intrinsèque entre l’innovation et la politique conçue sous le prisme du rapport de force. Norbert Alter, un autre sociologue des organisations – tout aussi essentiel – nous offre également une approche riche en enseignements. Son ouvrage majeur a été publié en 2000 et porte le titre magnifique de “L’innovation ordinaire“.
Selon Alter, l’innovation est essentiellement une déviance dans l’ordre établi. Elle introduit une forme de chaos, elle est caractérisée par l’ambiguïté des buts et est un processus fondamentalement incertain. Rien de bien décoiffant jusque-là. Sauf que cette déviance n’est pas le fruit d’un processus créatif harmonieux piloté par les idées, le mindset ou les prototypes, mais la résultante d’une inversion des normes le plus souvent introduite de façon volontaire et unilatérale, résultant plus du fait accompli que de la génération d’idées.
Le processus d’innovation suit ainsi invariablement un processus en quatre étapes. La première est celle de l’initialisation, caractérisée par des “croyances” et une forme “d’irrationalité” dans le lancement du processus d’innovation qui consiste à introduire de manière parfois arbitraire une “invention”. La seconde étape est celle de l’appropriation de la déviance créée par l’invention, de l’expérimentation, du conflit entre individus et groupes, et de la transformation de l’invention en quelque chose d’autre. Dans une troisième phase, le conflit ayant abouti, l’invention est métabolisée et normalisée. La déviance (re)devient alors règle, ordre. Enfin, il y a innovation, c’est-à-dire nouvelle pratique sociale, lorsque l’invention s’est diffusée dans le groupe social et qu’elle en a modifié les interactions.
Pour Alter, loin du chemin de fleurs de la maturation des idées surgies de l’intelligence collective des innovateurs, l’innovation naît sur un champ de bataille sur lequel s’affrontent les tenants de la déviance d’un côté et ceux de l’ordre de l’autre. Deux logiques s’affrontent : celle de l’innovation et celle de l’organisation.
Logique de l’innovation
- “Elle se construit initialement sur l’ambiguïté, le vide ou le caractère paradoxal des décisions prises pour transformer une situation. “
- “Elle est portée par les acteurs de cette nouvelle donne.”
- “Elle s’appuie sur un réseau d’alliés qui partagent au moins momentanément la logique défendue par les acteurs de l’innovation.”
- “Elle dispose de règles de fonctionnement internes au groupe lui permettant de jouer successivement le registre de la publicité ou de la clandestinité.”
- “Elle ne négocie donc pas. Elle accomplit ce qui lui semble devoir être fait et tente de légitimer cette action après coup.” (Alter 2000 : 102)
Logique de l’organisation
- “L’enjeu majeur du groupe est de repréciser les fonctions et rôles au fur et à mesure que se développe l’innovation.“
- “Pour ce faire, il dispose de ressources, comme la collaboration ou d’autres liées à la position formelle, la gestion administrative, les moyens budgétaires qui permettent de contrôler partiellement l’innovation.”
- “Si les tenants de la règle s’opposent trop frontalement à ceux de l’innovation, ils ne sont plus que « légaux ». S’ils acceptent de coopérer, ils doivent accepter de perdre une partie de leur influence et de leur reconnaissance sociale.”
- “La stratégie dominante du groupe est alors celle de la réorganisation. Ce dernier réduit les incertitudes du processus de travail en formalisant les mécanismes d’innovation pour parvenir à transformer les stratégies des innovateurs en simples fonctions.” (Alter 2000 : 102-3)
C’est donc du conflit entre ses deux logiques, incarnées par des acteurs que l’innovation naît ou pas. Le succès ne dépend pas de la qualité de l’invention à l’origine du processus, du mindset de l’organisation, ou de la qualité du prototype produit par l’application des outils du Design Thinking, mais bien d’un affrontement, d’une confrontation, d’une lutte de pouvoir au sein de l’organisation.
La coopération conflictuelle
Mais si tout est conflit, quelle place pour la coopération ?
Si coopération il y a, c’est que celle-ci est préférée à une stratégie d’opposition, par exemple. C’est donc bien qu’il y a rapport de force.
“La force des idées ne vient pas d’elles en tant que telles mais des conflits ordinaires qu’elles trahissent, des embarras qui les précèdent dans le réél dont – au mieux – elles nous permettent de sortir. Sans organisation matérielle et symbolique, autrement dit sans institution pour instruire les engorgements de l’action en conflits, une idée – fût-elle vraie – n’a pas de force.” (Clot et al. 2021 : 30)
Un ouvrage récent formidable (Clot et al. 2021) vient à point nommer illustrer que la production d’innovation peut émerger d’une coopération fondée sur l’opposition et la confrontation des conceptions et des idées.
A l’inverse de la technique du design thinking qui consiste notamment à ne pas formuler de contradiction ou de négation, mais que des compléments aux propositions générées, les trois études menées par ces sociologues montrent comment un conflit organisé autour de la définition des critères de qualité du travail a produit du neuf et relégitimé leur participants au sein de l’organisation. Dans un EHPAD (EMS en Suisse), dans le service de propreté d’une grande ville et dans une usine automobile, les auteurs montrent que l’acceptation et la reconnaissance d’un conflit de conception autour de ce que constitue un travail bien fait par les équipes de terrain a permis non seulement d’innover, mais de redonner un sens à la coopération. D’un côté, les travailleurs de terrain ont affirmé leurs compétences, de l’autre ils se sont réaffirmés comme groupe capable de changement face à une hiérarchie dépassée par les événements et embourbés dans les process, loin des tartes à la crème de la “résistance au changement“.
Au final, pas de post-it, pas de méditation pleine conscience, pas de positivité exacerbée, pas de quête de la fausse unanimité, mais l’expression et la prise au sérieux de conceptions divergentes de l’action collective.
“Le conflit de critères “dialogué”, systématiquement documenté, en quête de la différence des points de vue sur le même objet à transformer, rassemble davantage en réalité que les plans d’actions consensuels pour le “bien-être” qui rassurent à bon compte.” (Clot et al. 2021 : 43)
Innover consiste moins à cultiver l’harmonie, rechercher le consensus ou faire appel à des méthodes de génération fluide d’idées, qu’à organiser la déviance, cultiver l’opposition et stimuler la coopération conflictuelle.
C’est donc plus une affaire de management que de méthode ou de techniques.
Références
Alter, N. (2000). L’innovation ordinaire. Paris : Presse Universitaires de France
Brown, T. (2009) Change by Design. How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation, New York : Harper Collins
Clot, Y et al. (2021). Le prix du travail bien fait. La coopération conflictuelle dans les organisations. Paris : Editions de la Découverte
Lewrick M., Link, P., Leifer, L. (2019), Guide du design thinking. Activez la méthode, Paris : Pearson