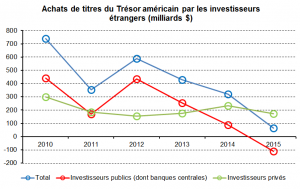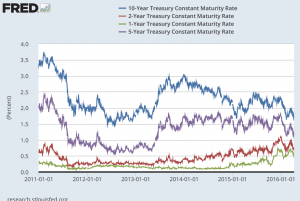Lors de la présentation d’une récente étude d’UBS Suisse, son président M. Gähwiler s’inquiétait du fait que la croissance récente reflète largement la demande intérieure : « le passage d'une croissance axée sur les exportations à une telle croissance fondée sur l'économie domestique n'est pas durable ».
Cette vision selon laquelle les exportations sont préférables à la demande domestique est inexacte. S’il est vrai que la force des entreprises orientées à l’export repose sur l’innovation et la recherche, comme le souligne l’étude à juste titre, il ne faut pas en tirer un lien entre les exportations et la bonne santé de l’économie.
Premièrement, la santé d’une économie repose sur sa capacité à accroître sa productivité sur la durée, et ce indépendamment du commerce extérieur. Les Etats-Unis accueillent plusieurs pôles de recherche alors que leurs exportations ne représentent que 13 pourcent du PIB (contre 52 pourcent en Suisse). En outre les Américains importent plus qu’ils n’exportent, l’inverse étant le cas chez nous. Ceci montre que ni la part du commerce international au PIB, ni la taille du solde commercial ne sont des indicateurs résumant à eux seuls la santé économique d’un pays.
Deuxièmement, afficher un excédent d’exportations n’est pas une fin en soi. Le but de l’activité économique est de produire les biens et services dont la consommation est source de bien-être. Les exportations servent à nous fournir les moyens d’acquérir les produits l’étranger que nous ne trouvons pas chez nous. Un excédent commercial indique donc que les ventes à l’étranger sont plus que suffisantes pour couvrir les achats. Est-ce un bienfait ? Rappelons tout d’abord qu’un excédent commercial représente une épargne envers le reste du monde : nous vendons plus que nous n’achetons et le solde est un crédit que nous détenons envers les autres pays sous formes d’actions, de titres obligataires, ou de prêts bancaires. Pour savoir si un excédent ou un déficit commercial est bon ou mauvais, il faut en comprendre les raisons. Nous pouvons faire le parallèle avec un individu. Lorsqu’une personne épargne, elle affiche un excédent entre son « exportation » de travail (son salaire) et son « importation » de biens et services (sa consommation), et inversement lorsqu’elle emprunte. Un emprunt est une bonne idée s’il finance par exemple des études, mais un choix discutable s’il est dépensé en vacances. De même, l’épargne est utile si elle vise à financer une vie confortable à la retraite, mais ne sert pas à grand-chose si elle dort à jamais sur un compte. Le fait qu’un pays affiche un surplus commercial année après année n’est donc pas en soi un signe de force.
Mais alors d’où vient la vision que les exportations ont une valeur particulière ? Elle résulte d’un parallèle trompeur avec une entreprise. Le but d’une entreprise est de vendre et de générer un profit. Comme l’entreprise n’utilise que peu ses propres produits, ses ventes sont envers les autres agents. En d’autres termes l’entreprise « exporte » la plus grande partie de sa production à ses clients. Pour réaliser un profit, les ventes de l'entreprise doivent être supérieures au coût du travail et des matières premières qu’elle « importe » des employés et fournisseurs. Il est donc impératif pour une entreprise d’afficher un excédent dans ses relations avec les autres agents. Il convient toutefois de ne pas arrêter le raisonnement à ce stade : cet excédent est distribué en dividendes, que les actionnaires vont alors dépenser pour acheter des biens et services. Ces achats représentent une « importation » envers les autres agents économiques. Si nous additionnons l’entreprise et ses actionnaires, nous constatons que l’excédent de l’entreprise est compensé par le déficit des actionnaires.
Un autre point discutable de la présentation de l’étude d’UBS est son ton alarmiste quant au rôle de l’Etat. Elle souligne que «l’administration publique engage 200 personnes par mois, le secteur de la santé 900 par mois, ce modèle de croissance n’est pas durable». Il convient là de faire quelques calculs. Entre 2010 et 2015 l’économie suisse a créé plus de 80'000 emplois par an. L’embauche annuelle de 2'400 fonctionnaires représente donc un peu moins de 3 pourcent de la création totale d’emploi. Ceci est tout à fait en ligne avec la part des emplois des administrations publiques au total des emplois en 2015, soit un peu moins de 4 pourcent. La Suisse n’est pas un pays où l’Etat est en train de prendre un poids démesuré. Il en va de même pour le secteur de la santé: une création annuelle de 10'800 emploi représente un peu plus de 13 pourcent de la création totale, et correspond à la part de la santé dans l'emploi en Suisse en 2015.