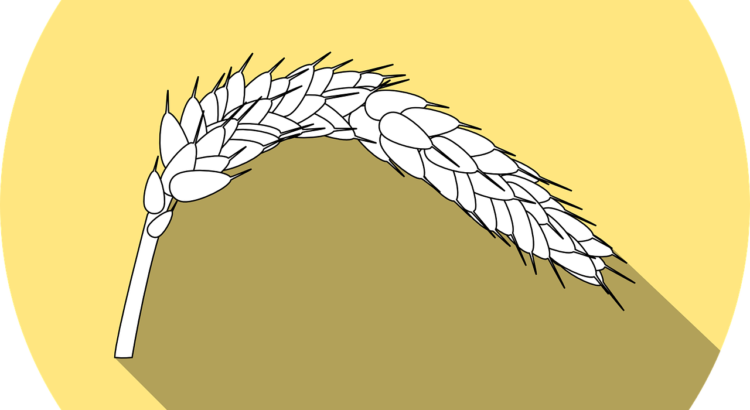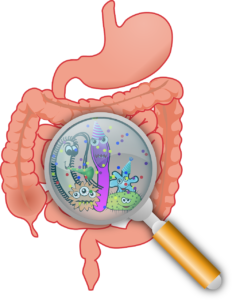La quoi ?!
Voilà peut-être un article un peu différent des précédents, mais il les rejoint en ce que j’y aborde mon vécu personnel et le fait que je mets en lumière un phénomène de santé peu et/ou mal connu du grand public (et même parfois des professionels de santé !). Je vais vous parler de la maladie coeliaque[1].
Ci-après, une conversation globalement typique que je peux avoir avec quelqu’un que je rencontre et qui ne me connaît pas ou peu (ou qui me connaît mais s’obstine) :
– Tu veux un bout de mon pain ?
– Moi: Non, merci, je ne peux pas, je suis coeliaque.
– Ceuquoi ?
– Moi: Ça signifie que je ne peux pas manger tout ce qui contient du gluten ou des traces de gluten.
– Ah ouais, pas cool… mais donc le fromage tu peux pas en manger ?
– Moi: Si, le fromage ne contient pas de gluten. Tu dois confondre avec le lactose.
– Ah ouais, sûrement. Pas simple ton affaire. Et tu peux pas faire une petite exception, de temps en temps ? Genre prendre un bout de mon pain ?
– Moi: Non, vraiment pas d’exception, la moindre trace déclenchera une réaction de mon système immunitaire. Car c’est une maladie auto-immune, pas simplement une intolérance. Ce que je ne dis pas: et arrête d’insister parce que j’en meurs d’envie de ton put*** de pain ! Il a l’air moelleux à souhait à l’intérieur et parfaitement croustillant à l’extérieur. Toute personne ayant déjà goûté du pain sans gluten devrait savoir qu’on n’en mange PAS PAR CHOIX.
– Carrément, ça doit être chiant. Moi je pourrais pas me passer du pain, des pâtes, des pâtisseries, je sais pas comment tu fais.
Ben j’ai pas le choix…c’est bien ça le problème, et c’est ce que je me tue à t’expliquer!
– Remarque, t’as de la chance, t’es toute fine comme ça, pas de poids en trop !
Retenez-moi ou je fais un massacre.
—-
 —-
—-
– Moi: Ouais mais tu sais c’est hyper contraignant, je dois me priver la plupart du temps et exit la spontanéité ! Je passe devant des boulangeries tous les jours sans pouvoir y acheter quoi que ce soit. Et au restaurant, c’est une galère ! A part quelques établissements qui indiquent les allergènes, je dois toujours tout demander et vérifier car la plupart des gens, même les restaurateurs, sont loin d’être bien informés. Tiens, l’autre jour, le serveur a insisté en disant que “y avait seulement un tout petit peu” de sauce soja dans le plat, donc que je pouvais le prendre. J’ai dû lui expliquer pour la troisième fois que “même un tout petit peu”, ben je peux pas. Et je le vois lever les yeux au ciel parce que je passe pour une meuf chiante et capricieuse.
Il faut dire qu’en tant que femme, féministe et de gauche, on me colle aussi tout de suite l’étiquette bobo-végane. Et apparemment, les vegan et les gens qui ne mangent pas de gluten sont au régime tout l’année et sont ravis quand on leur sert du tapioca à la noix de coco en dessert à la place du fondant au chocolat. Moi pas.
– Après y’a quand même pas mal de choix aujourd’hui, c’est plus comme avant. L’autre jour à la Coop j’ai vu un paquet de biscuits sans gluten.
Ça va peut-être te paraitre dingue mais j’ai été diagnostiquée coeliaque il y a “seulement” 3 ans et demi, et les trois paquets de biscuits sans gluten de la Coop, j’ai eu le temps d’en faire le tour.
—-

Typiquement ce que le serveur attend comme réaction de ma part quand il me dit que,
comme dessert sans gluten dans la liste, il y a la salade de fruits.
—-
– Et avec un peu de bol, ça va peut-être partir comme c’est venu.
On va reprendre la définition de la maladie auto-immune… C’est pas une gastro qui te file la chiasse pendant trois jours, c’est un régime strict à vie. Le non respect de ce régime implique une destruction des villosités de l’intestin grêle, une malapsorption des nutriments et donc un amaigrissement et des carences, de même qu’une probabilité accrue de développer d’autres maladies auto-immunes (diabète, problèmes de thyroïde,…) et des cancers. Donc la bouchée de pain, c’est quand même un sacré risque.
—
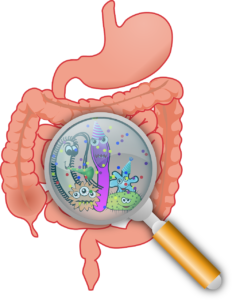
—
– Moi: Non, c’est chronique. C’est à vie…
– Purée, vraiment pas de bol ! J’aimerais pas souffrir de ce truc. Après t’économies de l’argent si tu achètes moins à manger j’imagine. J’essaie de trouver du positif, hein !
7.50 CHF le paquet de biscuits, 9 CHF le paquet de céréales, c’est pas tout à fait ce que j’appellerais économiser. Mais bon, au moins, je peux déduire un certain forfait dans les impôts avec mon certificat médical.
– Bon ben en tout cas, pas cool ton histoire d’intolérance (ce n’est pas une intolérance…), j’insiste plus pour le pain, mais tu prendras bien un chocolat en dessert!
– Moi: ça dépend, il faut que je vérifie l’emballage. Le gluten il y en a quasiment partout, même dans certains chocolats et bonbons !
– C’est ouf. Bon, je dois y aller, on m’attend pour un brunch.
Encore un truc hyper galère à organiser: les brunchs… on me proposera sûrement une salade verte avec des noix, et des fruits en dessert. On me dira sûrement que je ne peux pas prendre de la purée car il y a des pommes de terre (alors que c’est sans gluten) et que mon renversé contient du lait, mais il faudra garder mon calme et réexpliquer, encore et encore, justifier, et sûrement payer un repas qui m’a laissée sur ma faim alors que j’ai vu mes voisins de table se régaler. Mais bon, au moins je ne suis pas obèse et il paraît que j’ai de l’épargne !
– Moi: Salut, bon brunch !
[1] La maladie coeliaque est une réaction auto-immune au gluten, un composant de différentes sortes de céréales. Plus ici.