Jeudi dernier, une journaliste du Temps sollicitait mon opinion au sujet de l’affaire Fricker (probablement suite à ma publication de ce texte d’Yves Bonnardel). Ayant pris la peine de répondre soigneusement à ses questions, quelle ne fut pas ma surprise quand je constatai qu’elle avait finalement préféré rapporter les propos de Jean Romain. L’article, qui questionne la légitimité de l’analogie entre exploitation animale et holocauste, se conclut d’ailleurs sur cette fine observation du philosophe: «Lorsque la raison vacille, c’est l’émotion qui prend le dessus.» Car l’emploi de telles analogies serait «propre aux mouvements dont la charpente conceptuelle est fragile».
Cette leçon de rationalité est franchement loufoque, venant de quelqu’un qui ignore manifestement tout du sujet. Pour preuve: d’après Romain, «seul l’être humain, doué de la capacité d’anticipation et de raison, est sujet de droit.» On se croirait au siècle de Descartes. Heureusement, la recherche en éthique animale a connu quelques progrès dans l’intervalle. D’une part, on sait désormais que la raison et la capacité d’anticipation ne jouent pas le rôle que leur attribue Romain, qu’elles ne sont pas nécessaires à la possession de droits moraux – ce dont peuvent au passage se réjouir les êtres humains qui en sont dépourvus. D’autre part, l’éthologie contemporaine a largement démontré la présence de ces capacités chez de nombreux animaux. N’en déplaise à Romain, nous n’avons le monopole ni de la raison ni de l’anticipation, et encore moins des droits moraux. Il s’agirait donc de s’informer un minimum avant de faire le malin dans la presse.
Au-delà de cette réponse ouvertement ad hominem, que faut-il penser de l’idée que ces analogies sont essentiellement émotionnelles, propres aux militants qui manquent d’arguments solides? Un raisonnement par analogie consiste à montrer qu’une pratique est injuste parce qu’elle possède les caractéristiques qui rendent injuste une autre pratique, dont l’injustice est communément admise. Nous avons déjà rencontré un tel argument dans un post antérieur: le spécisme est injuste parce qu’il possède la propriété qui rend le racisme et le sexisme injustes, à savoir reposer sur un critère purement biologique. Dans le présent contexte, l’idée est donc que l’exploitation des animaux est injuste parce qu’elle possède la caractéristique qui rendait l’holocauste injuste, à savoir impliquer le massacre d’une classe d’individus sans la moindre considération pour leurs intérêts.

Face à un tel argument, la charge de la preuve repose sur les épaules des objecteurs. Tant que ces derniers ne sont pas en mesure d’identifier une différence moralement pertinente entre les pratiques en question – une propriété qui rende injuste l’une mais que n’instancie pas l’autre –, l’analogie tient la route. Or, justement, les belles âmes qui se scandalisent depuis une dizaine de jours des déclarations de Jonas Fricker sont apparemment incapables d’identifier une telle différence entre l’holocauste et l’exploitation des animaux. De fait, en lieu et place d’une telle réponse, elles se contentent de s’offusquer en cœur et de crier à l’antisémitisme. Fricker et ses amis antispécistes ne sont même pas humanistes!
Comme Yves Bonnardel, je suis d’avis que cette polémique est avant tout symptomatique du spécisme de notre société. Ceci dit, je pense qu’elle révèle aussi les difficultés plus générales qu’ont les gens avec l’argumentation, difficultés qui sont encore accentuées lorsqu’on touche à un sujet sensible. Car on peut trouver que l’analogie ne fonctionne pas pour des raisons philosophiques. Ou concéder qu’elle est philosophiquement légitime tout en s’y opposant pour des raisons stratégiques. Mais cette accusation d’antisémitisme (ou de misanthropie) manifeste une incompréhension totale de son fonctionnement. Les antispécistes ne minimisent en aucun cas l’injustice de ce qu’ont subi les Juifs au cours de la Seconde Guerre mondiale. Une telle tactique affaiblirait considérablement leur argument, qui repose précisément sur le constat consensuel que la Shoah était une abomination.
La fanfare de réactions outragées suscitée par les propos de Fricker est décidément plus émotionnelle que le recours à un argument dont on devrait pouvoir discuter rationnellement. Comme quoi, la raison n’est pas toujours du côté où on l’attend le plus.
(Illustration: Fanny Vaucher)
 Ce nombre a quelque chose de glaçant. Et les conditions du massacre n’arrangent rien à l’affaire. N’étant soumise à aucune réglementation, l’horreur de la pêche n’a franchement rien à envier aux dérapages routiniers médiatisés en France grâce à l’association L214. Les poissons dont les organes n’explosent pas du fait de la dépressurisation quand ils sont violemment extirpés du fin fond des océans agonisent parfois pendant des heures avant de mourir asphyxiés. Imaginez un instant la levée de boucliers que susciterait un abattoir dans lequel de jolis lapins seraient noyés de la sorte.
Ce nombre a quelque chose de glaçant. Et les conditions du massacre n’arrangent rien à l’affaire. N’étant soumise à aucune réglementation, l’horreur de la pêche n’a franchement rien à envier aux dérapages routiniers médiatisés en France grâce à l’association L214. Les poissons dont les organes n’explosent pas du fait de la dépressurisation quand ils sont violemment extirpés du fin fond des océans agonisent parfois pendant des heures avant de mourir asphyxiés. Imaginez un instant la levée de boucliers que susciterait un abattoir dans lequel de jolis lapins seraient noyés de la sorte. pertinentes pour leur survie, n’a rien d’étonnant. Après tout, elles ne sont pas moins que nous le résultat de milliards d’années d’évolution – car non, nous n’avons pas plus évolué que les autres êtres vivants qui peuplent la Terre. Mais qu’on les appelle “intelligence” ou non, ces facultés n’impliquent pas la moindre sensation, ni la moindre volition. L’argument de l’intelligence des plantes ne fait donc pas honneur à celle des humains.
pertinentes pour leur survie, n’a rien d’étonnant. Après tout, elles ne sont pas moins que nous le résultat de milliards d’années d’évolution – car non, nous n’avons pas plus évolué que les autres êtres vivants qui peuplent la Terre. Mais qu’on les appelle “intelligence” ou non, ces facultés n’impliquent pas la moindre sensation, ni la moindre volition. L’argument de l’intelligence des plantes ne fait donc pas honneur à celle des humains. comment on pourrait avoir la moindre obligation à son égard – ce qui confirme (1). Supposons maintenant que Gédéon soit un basset. Parce qu’il est alors possible de lui faire du bien ou du mal, nous avons manifestement au moins une obligation le concernant: celle de ne pas lui faire de mal inutilement – ce qui confirme (2). En somme, Gédéon est un patient moral si, et seulement si, il est possible de lui faire du bien ou du mal.
comment on pourrait avoir la moindre obligation à son égard – ce qui confirme (1). Supposons maintenant que Gédéon soit un basset. Parce qu’il est alors possible de lui faire du bien ou du mal, nous avons manifestement au moins une obligation le concernant: celle de ne pas lui faire de mal inutilement – ce qui confirme (2). En somme, Gédéon est un patient moral si, et seulement si, il est possible de lui faire du bien ou du mal.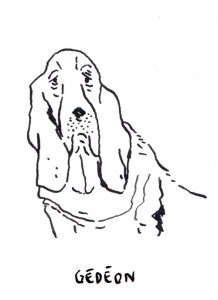 Parce qu’il est alors incapable de ressentir quoi que ce soit, on voit mal comment on pourrait lui faire du bien ou du mal – ce qui confirme (3). Supposons maintenant que Gédéon soit un basset. Parce qu’il est alors susceptible de ressentir du plaisir et de la douleur, on pourra lui faire du bien (en lui caressant le ventre) et du mal (en lui marchant sur la queue) – ce qui confirme (4). En somme, il est possible de faire du bien ou du mal à Gédéon si, et seulement si, Gédéon est sentient.
Parce qu’il est alors incapable de ressentir quoi que ce soit, on voit mal comment on pourrait lui faire du bien ou du mal – ce qui confirme (3). Supposons maintenant que Gédéon soit un basset. Parce qu’il est alors susceptible de ressentir du plaisir et de la douleur, on pourra lui faire du bien (en lui caressant le ventre) et du mal (en lui marchant sur la queue) – ce qui confirme (4). En somme, il est possible de faire du bien ou du mal à Gédéon si, et seulement si, Gédéon est sentient.