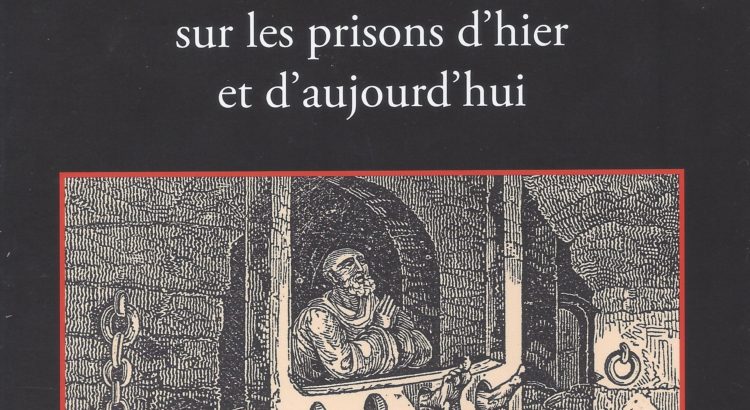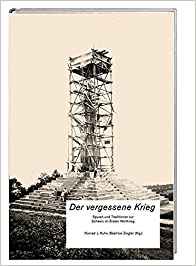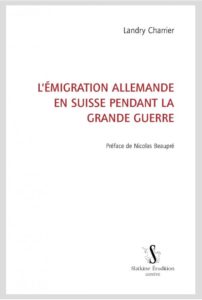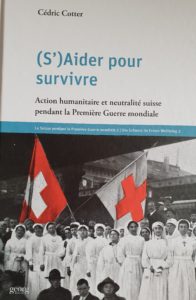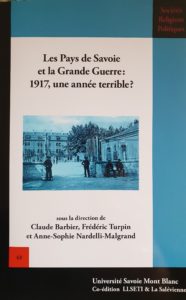En 2015, je consacrais un ouvrage sur l’espionnage en Suisse durant la Première Guerre mondiale, et, à cette occasion, je mettais en lumière un aventurier du renseignement, une ombre fuyante influent sur de nombreux destins qui à plusieurs reprises était parvenu à modifier le cours de l’histoire[1]. Un espion allemand, du nom de Hans Schreck, travaillant au cours des années de guerre pour le compte de l’Abteilung IIIb, qui avait été actif en Suisse comme chef du contre-espionnage des armées de Guillaume II. La Suisse, au cours de la guerre, avait été une plaque-tournante de l’espionnage en raison de sa neutralité et de sa position géographique particulière, littéralement sur le seuil des pays belligérants. Et l’existence et le rôle de Hans Schreck avaient été dévoilés lors du procès portant sur l’affaire des bombes de la Nordstrasse, à Zurich en 1918[2].
Suite à ce procès retentissant dans l’univers de l’espionnage, les services de renseignement français tinrent Hans Schreck, la cheville ouvrière de l’affaire des bombes, sous étroite surveillance. Hans Schreck, alias Roehm, alias Faust, alias Nitsche, alias Hermann Schmidt, était né à Berlin en 1880 au sein d’une famille ouvrière. Particulièrement intelligent, il avait réussi à se hisser dans la société malgré la perte de ses parents alors qu’il n’était âgé que de 12 ans. Devenu ingénieur, mais un ingénieur de fortune puisqu’il s’avérerait plus tard qu’il avait falsifié des documents et créé son propre diplôme en 1910, notre homme avait quitté l’Allemagne pour la Suisse peu avant la guerre pour échapper à des affaires d’escroquerie dont il était accusé. Et c’est à Zurich qu’il avait offert ses services au consul allemand comme agent de renseignement au début du conflit. Faisant preuve d’aptitudes hors du commun, il avait obtenu rapidement des responsabilités. Des aptitudes qui le conduisirent à des succès retentissants. Le SR français en ferait d’ailleurs la liste quelques années plus tard. Il avait ainsi conçu une opération depuis la Suisse visant le dreadnouhg italien Victor-Emmanuel, un vaisseau de première classe capitale pour la marine italienne qui fut neutralisé dans l’Adriatique et qui ne put jamais prendre part aux combats.

C’est également Hans Schreck qui anima la propagande contre le marchand de canons suisse Jules Bloch dont les usines neuchâteloises alimentaient l’armée française en fusée d’obus. Et ce fut également lui, faussaire de génie, qui participa à la confection de la fameuse lettre de Zinoviev, un faux qui avait été adressé en 1924 aux communistes anglais et qui avait été publiée par le Daily Mail quatre jours avant les élections de 1924, impactant largement la politique britannique intérieure.

Mais l’affaire de Nordstrasse à Zurich fut sans doute la première machination aussi importante à laquelle il fut mêlé. Une affaire complexe impliquant des dizaines de personnes, des agents allemands évidemment mais également des anarchistes italiens, des révolutionnaires indiens en lutte contre les Anglais et exilés sur le territoire de la Confédération, ainsi que des Suisses recrutés pour exécuter des basses œuvres. Le complot formé par l’Allemagne à partir de 1915 visait à déstabiliser l’Italie qui s’était rangée du côté des Français et des Anglais en instrumentalisant des anarchistes. Entre 1915 et fin 1917, la Légation allemande de Zurich avait peu à peu constitué un arsenal dans ses caves se montant à plusieurs tonnes d’explosifs, d’armes à feu diverses et d’un large éventail de matériel de guerre. C’est à la fin de l’année 1917 que les Allemands décidèrent de déplacer ce matériel dans une écurie de la Nordstrasse, plus discrète, avant de l’envoyer en Italie. Le transfert de ces armes allait devoir se faire en plusieurs fois, éveillant l’attention des espions français qui surveillaient la légation. Ces derniers attendirent le moment le plus opportun pour dénoncer le complot à la police zurichoise. 120 personnes devaient être arrêtées et écrouées dans la prison de Regensdorf dans l’attente de leur procès. Mais lors de l’instruction, plusieurs prévenus se suicidèrent. Peut-être les avait-on aidé… seule une étude historique du passé de cette prison pourrait éventuellement le révéler. On sait en effet que le réseau allemand de Zurich bénéficiait d’accointances au sein des autorités locales, notamment au sein de la police. Le juge fédéral Samuel Bickel lui-même, l’un des juges fédéraux extraordinaires nommés en 1916 par le Tribunal fédéral pour instruire les enquêtes dans les affaires d’espionnage, avait quant à lui joué un rôle suffisamment ambigu pour que le Service de renseignement français le relève.
Hans Schreck, avait été l’un des organisateurs principaux de ce complot, en constituant des faux papiers pour les agents de son réseau et en gérant l’ensemble de la machination. Celle-ci, si elle avait abouti aurait entraîné plusieurs assassinats de personnalités italiennes, et la destruction de structures stratégiques comme des arsenaux, des gares, des banques ou des ponts, de quoi paralyser le pays et permettre à l’Autriche-Hongrie de reprendre la main dans le conflit se déroulant dans les Alpes.
L’opération fut toutefois un échec et Hans Schreck, à l’instar de ses complices, fut arrêté. Il ne fut pourtant pas enfermé à Regensdorf comme les membres de son réseau mais dans une clinique médicale dépendant de l’hôpital cantonal de Zurich. Le juge avait en effet estimé que le personnage était mentalement instable et avait préféré le confier aux médecins. Ce faisant, il plaçait le responsable du contre-espionnage allemand en Suisse dans un établissement dénué de surveillance. Et bien entendu, Hans Schreck n’eut aucune peine à s’évader, un soir, à l’issu d’une partie de billard joué dans les salons de l’institution et d’un cigare. L’homme montait dans une voiture qui l’attendait et qui allait le conduire en Allemagne !
C’est ainsi que disparaissait de mon radar Hans Schreck puisqu’en 2015, lorsque je terminais mon livre, je n’avais pas encore eu connaissance de nouvelles pièces d’archives. C’est grâce à un collègue[3] qu’il m’allait être possible de prendre connaissance d’un nouveau lot de documents conservés à Vincennes et provenant des fameuses archives du Deuxième Bureau saisies par les Allemands en 1940 puis par les Russes en 1945 et rapatriées en France au début des années 2000[4]. Des documents, constitués par les Services de renseignement français et portant sur Hans Schreck mais datant des années vingt et des années trente. L’affaire des bombes de la Nordstrasse s’était déroulée à Zurich et aurait pu avoir une portée considérable si elle avait été couronnée de succès. Les opérations dans lesquelles Hans Schreck allait être impliquées au cours des quinze années suivantes devaient avoir une ampleur tout aussi importante, avec comme toile de fonds la Suisse, encore une fois.
Schreck, en 1918, avait donc regagné l’Allemagne. Une Allemagne vaincue et humiliée par le traité de Versailles, soumise à de nombreuses contraintes, et notamment sa démilitarisation. Schreck, à l’issue de la guerre et durant quelques années se reconvertit dans le commerce, mais il conserva inévitablement ses anciens réseaux et continua très certainement à servir l’Allemagne et notamment la Reichswehr qui était venue remplacer la Deutsches Heer en février 1919.
Rappelons que la république de Weimar avait alors succédé à l’empereur exilé en Hollande, et que de nombreuses mouvances socialistes et communistes ébranlaient le pays alors que la Rhénanie était occupée par 250’000 soldats français jusqu’en 1930, 1935 pour la Sarre. La fin de la guerre en Europe inaugurait une guerre civile et une révolution en Allemagne et de nombreux affrontements entre des mouvements considérés alors comme révolutionnaires et les Freikorps, ces milices paramilitaires et nationalistes, constituées de civils et de nombreux vétérans. La révolte spartakiste de Berlin et la mort de Rosa Luxemburg tuée par les corps francs le 15 janvier 1919 devait en être l’un des sommets.

De nombreuses organisations secrètes virent le jour au cours de ces années à travers l’Allemagne, ultranationalistes, radicales, revanchardes, et souvent violentes. Parmi elles, le Stahlhelm, les fameux casques d’aciers issus des Freikorps et composé de vétérans de la Première Guerre mondiale, équivalent des croix de feux français, mais également le Bund Oberland, la Ligue de Bismarck, le Pavillon d’Empire, les Wehrwolfs, Olympia, ou encore l’Opération consul, active en 1921 et 1922 et qui avait réussi à assassiner le ministre Walter Rathenau en 1922. Citons encore la Ligue Viking qui avait succédé à l’Opération Consul, sans parler bien évidemment des Hitlériens. Des organisations qui toutes appartenaient au milieu völkisch. L’armée, quant à elle, avait été largement réduite par le Traité de Versailles et les officiers autant que les soldats de la Reichswehr considéraient que le gouvernement de Weimar,… les Scheidegger, Ebert et Walter Rathenau, avait poignardé dans le dos l’armée allemande qui résistait sur le terrain en signant l’armistice de 1918. Un officier, Bruno Ernst Buchrucker, avait créé en réaction à la démilitarisation forcée de l’Allemagne, une armée secrète, appelée Reichswehr noire entraînant des hommes à la guerre et reconstituant des stocks d’armes. Il devait lancer un putsch avec 500 hommes et tenter en vain de s’emparer des dépôts d’arme de Kustrin et de Spandau en octobre 1923, quelques semaines avant un autre putsch, celui de la brasserie du 8 novembre 1923 organisé par Hitler. L’échec de Buchrucker n’avait pourtant pas mis un terme aux activités de la Reichswehr noire opposée à la politique de Gustav Streseman chancelier depuis 1923. Gustav Streseman reste méconnu tant les événements précédant et suivant son gouvernement sont venus occulter son mandat. Gustav Stresemann avait pourtant permis à l’Allemagne de retrouver un poids diplomatique et économique perdu après la guerre et à faire entrer l’Allemagne dans la SDN en 1926, en menant une politique de compromis. Une politique pragmatique qui l’avait mené, avec Aristide Briand, à entamer un rapprochement franco-allemand et qui lui vaudrait le Prix Nobel de la paix, mais également de très nombreux ennemis.
C’est dans ce contexte trouble que Hans Schreck allait évoluer, fréquentant, pour évoquer Ian Kershaw, des cercles dans lesquels la démocratie apparaissait comme “le plus grand malheur” qui se fut abattu sur l’Allemagne[5]. Il est difficile pourtant de renouer tous les fils et d’apprécier toutes les implications tant le personnage avait fait du mensonge un principe de vie, et de l’escroquerie une religion. Il est toutefois évident, au vu de ses états de service, qu’il resta fidèle à l’Allemagne. Mais à une Allemagne impériale et volontiers pangermanique plutôt qu’à la nouvelle république de Weimar. Hans Schreck restait ainsi dans le sillage des mouvements ultra-nationalistes. Lors de son procès en 1927, un témoin rapporterait d’ailleurs que Hans Schreck était à Munich lors du putsch d’Hitler et qu’il aurait proposé à ce dernier à la veille du coup de main, au restaurant Platel, de prendre en charge tous ses frais s’il devait être emprisonné. Hitler avait refusé poliment !
Deux ans plus tard, en 1925, Hans Schreck, après avoir influencé la politique britannique par le biais de la fausse lettre de Zinoviev, vendait des documents secrets au gouvernement polonais en se faisant passer pour un membre dissident du Frontbann, l’organisation d’Ernst Roehm qui était venue remplacer la SA après que celle-ci ait été interdite temporairement après le putsch de la Brasserie. Des documents falsifiés également mais comportant des éléments de vérité sur des fortifications souterraines allemandes en Silésie. Cette nouvelle opération d’Hans Schreck intervenait après que des documents officiels aillent disparu, des documents compromettant la Reichswehr, lesquels démontraient clairement les collusions entre les milieux officiels et la Reichswehr noire ainsi qu’avec des associations paramilitaires. Des informations qui étaient parvenues à la Pologne et qui avaient déclenché l’indignation au sein du gouvernement, quelques mois avant le coup d’état de mai 1926 de Józef Piłsudski, et surtout une série d’opposition à la France de la part de la Pologne au cours des travaux de la Commission préparatoire de la conférence du désarmement de mars 1926, des difficultés que l’historien Richard Fanning avaient déjà relevées en 1995 en indiquant les craintes polonaises pour ses frontières occidentales[6].
C’était là tout l’enjeu des efforts déployés par Hans Schreck, à savoir neutraliser les effets des documents volés à la Reichswehr se trouvant entre les mains du gouvernement polonais et calmer les suspicions de ce dernier alors que des négociations diplomatiques étaient menées à Genève sous l’égide de la SDN, devant parvenir à une réduction et une limitation des armements. Des négociations débutées en 1926 avec les travaux de la Commission préparatoire qui se réunit régulièrement entre le mois de mai 1926 et le mois de mai 1929, et qui allait se poursuivre de 1932 à 1934 par la Conférence réunissant les anciens belligérants de la Grande Guerre. Des négociations entamées alors que l’Allemagne et la France connaissaient une embellie de leur relation. Hans Schreck devait ainsi vendre des faux à la Pologne puis se faire arrêter pour divulgation de secrets militaires et pour falsification. C’était là le plan et c’est ce qui advint à la fin de l’année 1926. Hans Schreck était arrêté et enfermé derrière les murs de la prison de Brandebourg. Une arrestation d’opérette, tout comme le procès qui suivrait. Un procès largement public et relayé dans la presse qui ferait estimer au SR français qu’il s’agissait là d’un coup monté, le but étant : « l’armée allemande aurait voulu donner aux puissances étrangères et notamment à la Pologne l’impression que les papiers en question étaient faux. Dans ce but, des faux auraient été très habilement fabriqués à base de documents authentiques ». Hans Schreck servait dès lors de bouc émissaire. Une incarcération toutefois relativement confortable puisque le coupable pouvait circuler librement la plupart du temps, allant même à se servir des camions de la Reichswehr pour déménager son appartement. Le tribunal ne ménagea pourtant pas sa peine pour faire illusion, faisant venir devant lui Ernst Roehm, le chef des SA hitlériennes, pour obtenir publiquement son témoignage selon lequel Hans Schreck avait falsifié le tampon du Frontbann. Tout était bon pour enfumer la Pologne dont la frontière occidentale était considérée comme une ignominie par les Allemands.
Hans Schreck fut condamné, bien sûr, mais il ne continua guère à fréquenter les geôles de la prison de Brandebourg. Ses services étaient trop précieux.
En 1932, la Conférence pour le Désarmement commença à siéger à partir du 2 février. Quatre jours plus tard, le 6 février 1932, le colonel Chapoully, attaché militaire à l’ambassade de France à Berlin écrivait à Paris avoir reçu la visite d’un certain Heinrich Simader, appartenant à la Deutscher Rechtsbund München, une association pacifique, qui proposait de donner aux Français des documents prouvant l’existence d’armements secrets et des preuves de la collusion de la Reichswehr avec des organismes interdits qui « pourraient, s’ils étaient rapidement et opportunément utilisés à Genève, prouver ouvertement que le désarmement est un leurre et la préparation de ce pays à la guerre certaine ». Simader proposait encore que Hans Schreck s’entretienne de ces questions avec une personnalité française à Bâle. Le maître espion allait encore se fendre d’un mémoire adressé au colonel Chapoully apportant des précisions à ces allégations, notamment sur les effectifs potentiels, les stocks d’armes et les relations militaro industrielles entretenues par la Reichswehr noire et l’URSS ainsi qu’avec les USA, et proposer qu’il apporte des preuves matérielles à ces observations. Les informations contenues dans le mémoire Schreck étaient toutefois dépourvues de valeur car les services de renseignement français n’étaient pas dupes des efforts menés par l’Allemagne en matière de réarmement. Les relations avec l’URSS étaient également connues puisque les deux pays avaient signé le traité de Rapallo en avril 1922 prévoyant une collaboration militaire secrète qui durerait jusqu’en 1933, et des camps d’entraînement allemands sur le territoire russe dont une école des gaz de combat à Saratov, une école de pilote à Lipetsk et un camp d’entraînement pour tankistes à Kazan. De même, les gouvernements européens connaissaient les accords passés en 1927 entre des entreprises américaines et allemandes, notamment entre Krupp et General Electric que l’historien Alfred Wahl a mis en lumière en 1993[7].
Hans Schreck ne vint jamais apporter de preuves tangibles aux Français dans la commune de Saint-Louis, comme il en avait été convenu, ne faisant que confirmer les convictions de ces derniers qui avaient reconnu celui qui avait fomenté l’affaire de 1925 avec la Pologne et qui estimaient que le but de sa manœuvre était de déstabiliser la France lors de la conférence de désarmement de Genève en jetant la suspicion sur ses représentants. On peut en l’occurrence aisément imaginer que Hans Schreck, commandité par la Reichswehr noire, avait pour mission d’atténuer les appréhensions européennes en diminuant les chiffres. C’est ainsi qu’il avait indiqué un effectif de 220’000 hommes pour le Stahlhelm alors que l’historien George Mosse a estimé ce chiffre à un million de membres en 1930[8]. De même Schreck observait un effectif de 275’000 hommes pour la SA alors que nous savons que la réalité des chiffres se montait plutôt à 400’000 hommes.
Le 21 juin 1932, le chef du Service des communications militaires à Belfort, le chef d’escadron Schütz signalait au Deuxième bureau à Paris que l’agent allemand Hans Schreck avait été « liquidé comme escroc ». Ainsi se terminait une vie de mystifications au service de l’Allemagne. Assez bêtement d’ailleurs. Un an plus tard, le 14 octobre 1933, l’Allemagne se retirait de la Conférence du Désarmement et annonçait son retrait de la Société des Nations.
La Suisse, alors qu’elle avait été le terrain de jeux des services de renseignement étrangers durant la Première Guerre mondiale était devenue avec la SDN l’antichambre de l’équilibre international, attisant les activités de renseignement sur son sol et à l’étranger, faisant d’elle un théâtre de marionnettes manipulées depuis des cabinets étrangers. Un phénomène permettant d’avancer, pourquoi pas, que la neutralité fonctionne comme catalyseur du renseignement. C’est du moins ce qui ressort de l’exemple helvétique dont le paysage de neutralité bucolique dissimulant les réalités cyniques et unilatérales d’intérêts impérialistes ne furent plus contenus par les conventions policées de la diplomatie à partir de 1933. La Pologne en ferait l’amer expérience six ans plus tard.
[1] La Suisse face à l’espionnage, 1914-1918, Slatkine, Genève, 2015.
[2] Émile Thilo, La répression de l’espionnage en Suisse : Etude systématique des jugements rendus par la Cour pénale fédérale en 1916 et 1917, Lausanne, 1917.
Archives fédérales allemandes, Coblence, Sicherung der Südgrenze Deutschlands, II Kriegsakten 1914-1918, Reichskanzlei, R 43/2461a ().
Archives fédérales allemandes, Bonn, Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Personnalités militaires, Schweiz, 54 3.
Archives fédérales suisses, Schreck Hans, 1880, E4320B #1990/133 #2123*.
Gazette de Lausanne : 1er janvier 1914 au 31 décembre 1918.
[3] Jean-Michel Gilot.
[4] « Archives russes », Vincennes, Carton 422.
[5] L’Europe en enfer, 1914-1949, Seuil, Paris, 2016.
[6] Peace and Disarmament, Naval Rivalry and Arms Control, 1922-1933, The University Press of Kentucky, Lexington, 1995.
[7] L’Allemagne de 1918 à 1945, Paris, Armand Colin, 1993.
[8] Les racines intellectuelles du Troisième Reich : la crise de l’idéologie allemande, Paris, Calmann-Levy, coll. « Histoire », 18 octobre 2006.