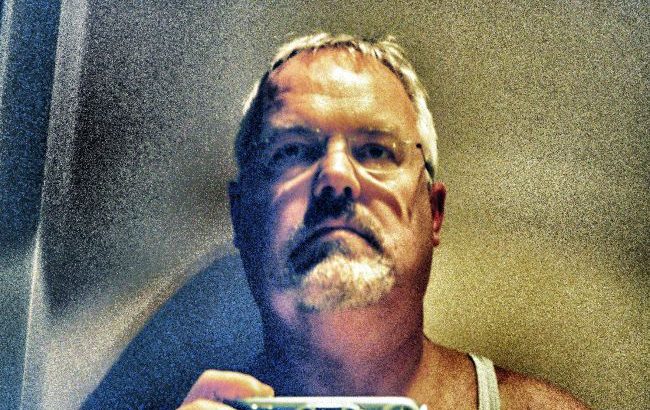Le dollar vient juste de passer au-dessus de la parité. Désormais, il faut payer plus d’un franc pour un billet vert. Les Suisses voyageant aux Etats-Unis ne vont plus avoir le sentiment d’être très riches.
Est-ce la fin du franc fort? Pas encore. Face au dollar, la monnaie suisse est relativement faible et plus les perspectives d’un relèvement des taux d’intérêt aux Etats-Unis se renforcement, plus le billet vert s’élèvera. C’est face à l’euro que le franc reste trop haut, car la monnaie unique reste plombée par la faiblesse de la reprise, les incertitudes sur la gouvernance de la zone euro et, surtout, par l’assouplissement quantitatif massif entrepris par la Banque centrale européenne.
Si le franc suisse s’affaiblit face à la monnaie unique, ce ne sera pas du fait des étrangers, mais des Suisses eux-mêmes. Et même s’ils ont essayé beaucoup de choses – cours plancher, achats massifs d’euros, et même, ironiquement, un coup de frein à la croissance – il leur reste une solution pour rendre leur monnaie moins désirable.
Cette solution, est politique: c’est nommer une personnalité incompétente à la tête du Département fédéral des finances (DFF). Une personne qui ne sache pas de quoi elle parle quand elle aborde les questions de politique monétaire, qui ne se rende pas dans les cénacles internationaux où se décident les grandes orientations de politique des changes ou de fiscalité. Une personne qui n’ose pas dire leur fait aux méga-banques et les laisse faire ce qu’elles veulent, quitte à déstabiliser le système financier.
Le mieux est encore de nommer un comptable sans vision stratégique. Ou, idéalement, un politicien qui, par principe, refuse de voyager, d’échanger des idées avec ses collègues d’autres pays, rejette la réalité d’aujourd’hui pour cultiver celle de hier. Le Conseil fédéral actuel compte un tel candidat, c’est Ueli Maurer, actuellement chef du Département de la défense. Mais il pourrait en compter un autre, notamment si le Parlement élit le président de l’UDC Toni Brunner.
Avec de tels étendards, le franc ne sera plus défendu par un ministre des Finances qui voyage et défend les intérêts de la place financière et des entreprises suisses selon une vision réaliste des enjeux et des rapports de force, qui impose ses décisions aux grandes banques même quand cela ne leur fait pas plaisir, comme le faisait Eveline Widmer-Schlumpf.
Avec Ueli Maurer ou Toni Brunner, le franc serait défendu par des responsables dénués de crédibilité à l’échelle internationale. Quand les investisseurs s’en seront rendus compte, ils auront toutes les cartes en mains pour faire plonger le franc. Et même si elle s’en réjouit dans un premier temps, la Suisse des exportateurs et des gérants de fortune le regrettera très vite.