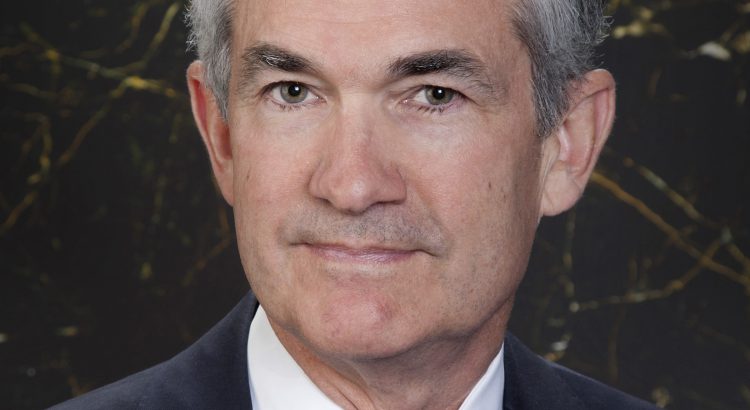La politique, notamment au niveau fédéral, n’est pas qu’affaire de lois claires et nettes, de réglementations pointues, d’ordonnances pointilleuses. Elle peut aussi laisser de béantes zones grises que même de multiples arbitrages populaires ne parviennent pas à effacer.
Telle est la description saisissante de rigueur et de précision de l’ouvrage « Démocratie populaire contre droit international » publié l’automne dernier par Denis Masmejan à la collection « Le savoir suisse » des Presses polytechniques et universitaires romandes (PPUR). L’auteur, journaliste au bénéfice d’une longue expérience du droit, expose de manière brillante comment le syndrome de non-décision des Chambres fédérales a abouti à la situation ubuesque où nous nous trouvons aujourd’hui, à savoir qu’une seule initiative populaire, dite « le droit suisse au lieu de juges étrangers », risque d’abattre en un seul vote l’édifice des relations bilatérales patiemment construites entre la Suisse et Bruxelles.
Tout commence par une ambiguïté : qui détient la souveraineté suprême : le peuple ou le droit international ? Faute d’avoir voulu apporter plus qu’une réponse minimale, le monde politique a ouvert la porte aux populismes. Pendant des années – et même des décennies, si l’on compte un premier épisode sans lendemain survenu pendant les années 1950 – les Chambres fédérales se sont gardées de se prononcer. Certes, la Constitution fédérale de 1999 stipule que les actes interdits par le droit international impératif, notamment la torture et la peine de mort, ne peut pas être contredit par l’ordre juridique suisse. Mais pour tout le reste, silence.
Ce flou a entraîné la prise de plusieurs décisions contradictoires durant les vingt dernières années au cours desquelles le Souverain a dû se prononcer. Sans qu’aucune instance ne cherche sérieusement à apporter son arbitrage. Pourquoi ? Question d’équilibres politiques. L’UDC favorisant fermement la suprématie du vote, la gauche soutenant le contraire, et les partis du centre-droit se montrant hésitants.
Le vent est-il en train de tourner ? C’est ce que suggère le livre de Denis Masmejan. Au vu des risques très concrets que font encourir pour la Suisse et sa prospérité la possibilité d’un oui à l’initiative sur les « juges étrangers », une amorce de mobilisation semble parcourir les rangs du PLR et du PDC. Mais il en faudra naturellement bien davantage pour qu’une clarification survienne, si seulement elle reste à l’ordre du jour en cas de rejet du texte de l’UDC.