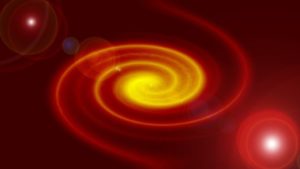Le mot transition signifie aller vers un au-delà, trans-iter. Il marque le passage d’un état à un autre. Un passage qui peut être brutal ou gradué. Et relever d’états de différentes natures : le mot transition peut s’appliquer à la technologique, à l’énergie, à l’écologie, à la politique, et à sa propre intériorité. Selon le niveau de temporalité, d’intensité et du champ où s’applique la transition en question, les résultats escomptés ne seront pas les mêmes, ni les processus de sa mise en œuvre concrète.
En écologie intégrale, le mot transition est estimé insuffisant pour certain.e.s, quasiment assimilé à ce que fut jadis le développement durable. Ce dernier, porté à son apogée dans les années 1990, misait sur le découplage possible des flux matières et de la croissance. En d’autres termes, on pensait possible de maintenir un niveau de croissance élevé sans porter atteinte à la restriction des ressources naturelles, sans détruire les éco-systèmes, sans bouleverser le système terre, avec le seul appui des technologies. Et le tout en réduisant les inégalités. On sait aujourd’hui que c’est un échec radical.
En 2020, jamais les ressources n’ont été autant impactées. A titre d’exemple, en termes de minéraux et pas seulement de métaux avec une sur-exploitation du cuivre utile pour isoler les conducteurs, même le sable est en passe de devenir une denrée rare car nous en mettons de partout : de la construction à nos ordinateurs, dans le textile (pour l’effet dévalé de nos jeans), les verres, les panneaux solaires, les installations sportives, les litières de zoo, les systèmes de freinage etc.
Parallèlement, le fossé des inégalités mondiales n’a jamais été aussi élevé, au point que 10% des plus riches de notre planète consomment la moitié des ressources de cette dernière. La proportion est simplement inverse pour les plus précaires dont l’impact écologique est très faible, non seulement au regard de leur nombre, mais surtout compte-tenu des répercussions qui leur tombent directement dessus : catastrophes naturelles, pandémie, sècheresse et menace de famine. Car c’est bien de famines que meurent aujourd’hui chaque jour et chaque année encore des milliers et des millions de personnes dont des enfants ! Avant le Covid – qui se surajoute – c’est la faim qui les tue.
Dans ce contexte, quel sens donner à la transition ? Est-il déjà suranné ou au contraire trop ambitieux ? Je dirais que tout dépend du contexte dans lequel on emploie le terme : à quel état de changements se réfère-t-il ? Et avec quelle force et intensité temporelle ? Mais pour en apprécier les degrés et les champs d’action, il importe de comprendre les enjeux actuels de la planète que nos actions humaines ont contribué à impacter avant de proposer un exemple concret de piste d’action possible en matière de coopération économique et de création d’emplois innovants et vertueux pour une économie au service des vivants.
Système terre, état des lieux
Le monde qui nous guette selon les scientifiques n’est pas réjouissant. Selon les données scientifiques les plus rigoureuses (Selon la mise à jour de l’étude de Rockström et al. (2015). Will Steffen et al., « Planetary Boundaries: Guiding Human Development on a Changing Planet », Science, 15 janvier 2015), 4 des 9 limites planétaires sont aujourd’hui dépassées.
La première limite, qui est aussi la plus connue, concerne le changement climatique. Pour limiter l’ampleur du réchauffement climatique mondial à 2 °C d’ici 2100, il est admis par la communauté internationale que la concentration atmosphérique en CO2 ne devrait pas dépasser une zone d’incertitude comprise entre 350 à 450 ppm (parties par million). Or, la concentration actuelle atteint depuis peu 400 ppm, et les 450 ppm pourraient être dépassés si la croissance actuelle des émissions de gaz à effet de serre se poursuit.
La deuxième limite touche l’érosion de la biodiversité. Le taux d’extinction « normal » des espèces peut être fixé à 10 espèces par an sur un million. Or, le taux actuel d’extinction planétaire serait 100 à 1000 fois supérieur. Ces disparitions ont des impacts majeurs sur les écosystèmes et sur les fonctions qui ne sont plus remplies par les espèces disparues.
La troisième limite a trait à la perturbation des cycles biochimiques (azote et phosphore). La modification des cycles de l’azote et du phosphore contenus dans les sols résulte notamment de l’agriculture et de l’élevage intensifs. L’usage d’engrais et les déjections issues de l’élevage contribuent à perturber ces cycles indispensables au bon état des sols et des eaux. Alors que la limite était déjà atteinte pour l’azote en 2009, elle est désormais aussi franchie pour le phosphore, avec cependant des variations importantes selon les régions.
Enfin, la dernière limite récemment franchie résulte des modifications des usages des sols. L’analyse de cette limite a été recentrée, dans l’actualisation de l’étude scientifique de 2015, sur les processus de régulation naturelle du climat, via les échanges d’énergie, d’eau et de CO2 entre les sols et l’atmosphère. Les chercheurs s’intéressent plus particulièrement au rôle des forêts dans cette régulation et constatent que, pour continuer à profiter de leurs bénéfices, il faudrait accroître leurs superficies, notamment celles des forêts tropicales et boréales.
Or, ces dégradations résultent du substrat énergétique et matériel de nos modes de vies actuels et de la manière dont ceux-ci envahissent les territoires les plus divers et reculés. Malgré ce, la consommation énergétique mondiale ne cesse d’augmenter. Les dernières communications du GIEC ont fait énormément parler cet été 2021 avec les épisodes climatiques désastreux qui se sont déroulés sous nos yeux. Comment prendre ces données en cours dans une transition nécessairement multi-niveaux sans rester dans un état de choc culpabilisant et improductif bloquant notre action au bénéfice d’une autre vision du vivre-ensemble ?
Une transition à décliner à différents niveaux
Le franchissement des limites planétaires nous invite à revoir nos modes de production et de consommation. A-t-on besoin d’autant produire de tout ? Ne peut-on pas envisager une relocalisation de nos économies avec une valorisation des métiers du low tech, de l’agroécologie, de l’urbanisme, du textile, de la permaculture, de la finance, de la distribution qui s’inscrivent déjà d’emblée dans le respect des ces limites planétaires ?
C’est une transition plurielle dont nous avons urgemment besoin : dans l’énergie, le transport, l’économie, l’agriculture afin de rentrer dans ce cercle bien matérialisé par la théorie du donut. Il s’agit de ne pas extraire plus que ce que la terre peut supporter pour se régénérer.
Une transition déjà amorcée par le mouvement des villes en transition, mais qui a besoin de changement économique et d’un portage politique. Sans les actrices et acteurs de la transition, le monde politique ne fera rien. Et inversement, les leviers politiques doivent permettre de soutenir massivement celles et ceux qui font déjà le monde de demain aujourd’hui ! Et qui ont cruellement besoin de soutien, financier certes, mais pas seulement : elles et ils ont besoin d’accompagnement et de se sentir en réseaux, avec d’autres qui ne participent pas seulement à une aventure individuelle mais à un projet collectif, citoyen, pour rendre enfin les territoires résilients.
Qu’est ce que cela signifie concrètement ? Cela veut dire qu’en cas de crise, d’effondrement, de pandémie, il importe de pourvoir avoir déjà des réseaux de personnes organisées qui assureront la production de bien nécessaires à la vie, à commencer par nous nourrir. Cela signifie se déplacer, se vêtir, se loger grâce à des entreprises respectueuses des personnes employées, soucieuses des matériaux utilisés, des savoirs transmis. Précisément, c’est dans ce contexte que j’expérimente avec des personnes de terrain le dispositif du revenu de transition écologique (RTE) qui, malgré son nom, ne se limite pas à un revenu individuel et monétarisé indexé sur la croissance.
Un revenu de transition écologique pour des territoires résilients
Le revenu de transition écologique (RTE) est un outil à disposition des politiques publiques visant à « accélérer » la transition, et plus encore la création d’emplois à impact écologique et social positif. Ce dispositif fait sens dans une société qui a choisi de vivre en accord avec les impératifs écologiques déduits des rapports scientifiques (GIEC / IPBES). Afin de ne pas dépasser l’augmentation de 2° de la température moyenne dans les prochaines décennies – seuil au-dessus duquel le système Terre réagira avec de trop fortes inconnues pour garantir la pérennité du vivant – nous devons réduire drastiquement nos émissions carbone, mais pas seulement : nous devons surtout stopper la destruction des écosystèmes qui menace l’équilibre de la planète et produire dans le respect des limites planétaires.
De fait, l’éthique fondatrice du RTE est éco-centrée : la protection de la Terre conditionne notre survie, à commencer par la sécurité alimentaire directement menacée notamment par des épisodes caniculaires répétés (stress hydrique, augmentation des insectes ravageurs de récoltes), des catastrophes naturelles (cyclones, méga-feux, etc.), des terres rendue infertiles à cause de l’utilisation massive de pesticides. L’enjeu est donc avant tout humain : c’est de notre survie dont il est question.
Or, les métiers de la transition, dans le biosourcé, l’éducation, la santé et la sécurité alimentaire, le textile, l’énergie, l’agriculture décarbonnée ont besoin de soutien : pas seulement monétairement et individuellement, mais avec une formation et une mise en réseau. C’est ce que vise le RTE en aidant les porteuses et porteur d’emplois à coopérer entre eux (mutualisation d’outils, partage de terres, formation) et avec les autres acteurs locaux : créer des circuits-courts et non juste relancer la consommation. Pensons aux cantines scolaires, aux épiceries locales, aux restaurants de quartier, aux réseaux de mobilité et de distribution, à toute la chaîne de la transformation de produits aux métiers dits de bouche : c’est tout un ensemble d’acteurs clés qui peuvent être mis en œuvre dans le secteur de l’agriculture, élargi à la mobilité douce, à la vente de proximité, y compris à domicile pour les personnes âgées, confinées, donc aux soins. Autant de créations de nouveaux emplois non ubérisés.
Le RTE n’est pas juste une idée (Pour le modèle économique et le détail pratique des expérimentations en cours, voir Le revenu de transition écologique : mode d’emploi, Puf, 2020). La première coopérative de transition écologique, destinée à verser les RTE, a été créée il y a tout juste une année dans le Nord de la France à Grande-Synthe, à l’initiative du maire, aujourd’hui eurodéputé, Damien Carême. Ce dernier a perçu dans ce dispositif un intérêt complémentaire à celui du revenu minimum garanti mis en place en amont pour assurer un revenu minimal à des personnes en dessous du seuil de pauvreté (fixé à 60% du revenu médian, en moyenne inférieur à 10’000 CHF par an dans cette région).
L’histoire, la géographie et le patrimoine de cette ville du Nord se sont construits en même temps que l’histoire industrielle. Le terme de conversion écologique fait donc sens aussi ici. D’autres territoires français se sont aussi lancés : en Nouvelle Aquitaine, avec un accent mis sur la construction et les monnaies locales ; en Occitanie avec la création à l’automne prochaine de la deuxième coopérative de transition écologique. L’agroforesterie et la biodiversité y sont à l’honneur. En Suisse les discussions et pistes d’expérimentation sont en cours dans plusieurs cantons romands.
Au fond, le RTE reste un instrument combinable avec d’autres (tva circulaire, etc.) et ne vaut que si l’on a compris l’enjeu de fond qui se joue. Sans la perception que le modèle économique que nous vivons en l’état sans intégrer d’autres critères que la seule rentabilité est injuste pour les précaires, injuste pour la Terre et les autres espèces vivantes dont nous causons la disparition chaque jour, alors cet outil ne peut pas être compris ; pas plus que le mot transition et ses différents niveaux.
La transition intérieure comme piste à (pour)suivre ?
C’est bien de transition économique, politique mais aussi sans doute intérieure dont nous avons besoin. Beaucoup de travaux ont été développés sur la critique de la croissance, du consumérisme. Et quid de la transition intérieure et de son lien à l’écologie ?
Je suis persuadée que la crise inédite et tragique que nous traversons peut nous pousser à opérer ce « déclic » d’une recherche de sens dans son travail, dans sa vie. Et peut-être nous aider à glisser vers cet état particulier de la transition dite intérieure : comment renaître et s’éveiller à son propre lien à la nature et à son intériorité ?
Notre intériorité, c’est aussi bien le jardin de Voltaire, que la rose du Petit Prince ou le recueillement dans sa connexion à la perception d’autre chose que soi mais en soi. Cela consiste simplement à définir l’espace propre de son intime intériorité de pensée, de sa reliance en soi, interconnectée aux autres. Et dans les autres, cela inclut le vivant (et le non-vivant) dans son ensemble : les mondes minéraux et végétaux sont d’une importance capitale pour les cultures et l’identité des peuples premiers. En reconnaître l’importance en accordant des droits à des espaces dits « sacrés » pour ces peuples, à l’instar de fleuves, de sites, de montagne, permet de les protéger juridiquement et de lutter contre la déforestation qui nous menace mondialement.
Attention, cela ne signifie pas que nous devions nous obliger à penser comme un membre d’un clan d’un peuple premier, mais d’accepter humblement que leurs croyances ne sont pas forcément moins louables que celle de penser qu’aller sur Mars sera la seule solution pour notre espèce. Au contraire, les chercheur.es contemporains et les spécialistes de la biodiversité montrent que les connaissances des peuples premiers, sans être issus de nos universités, sont compatibles avec la protection du vivant. Anthropologiquement, elles sont mêmes bâties sur cette protection qui respecte le cycle de régénération de la terre.
Peut-être pourrions-nous aussi nous interroger et développer ce lien à la nature telle que nous la ressentons en nous, ce lien à une inter-relation qui n’est pas juste humaine. Après tout, dans un siècle qui ne cesse de revendiquer la « transition », reconnaître d’autres formes de savoirs, sans récuser la science traditionnelle, bien au contraire, cela ne devrait donc pas être si sorcier…à condition de mettre un terme définitif à toute forme de bûchers et de laisser librement les personnes qui le souhaitent amorcer leur transition intérieure.
Car tout l’enjeu des transitions en cours réside dans la compréhension de l’incroyable richesse des forces en présence, souvent insoupçonnées, dont nous disposons en nous pour créer !
(Cet article a servi de base à une publication en automne dernier pour le journal AOC)