A plus d’un titre, “L’oiseau qui buvait du lait” est un polar rare et troublant. D’abord parce qu’il se passe en Lituanie, particularité qui nous permet d’entrer plus avant dans la réalité et la vie quotidienne de ce petit pays balte. Ensuite parce que son auteur, Jaroslav Melnik, est né en 1959 en Ukraine, qu’il est à la fois écrivain et philosophe, qu’il écrit en russe… et vit à Vilnius depuis de nombreuses années. Ajoutons à la complexité de sa biographie que ses parents, condamnés à mort puis déportés pour “propagande anti-soviétique”, s’étaient rencontrés au goulag. Un statut de “fils de prisonniers politiques” qui n’empêchera pas Jaroslav Melnik d’obtenir un diplôme en philologie à l’université d’Etat de Lviv, en Ukraine, puis de poursuivre ses recherches à Moscou.
Dans sa forme et sa structure, “L’oiseau qui buvait du lait” relève du polar plutôt classique. Il s’articule autour de la figure complexe et sympathique d’Algimantas Butkus, commissaire de la police criminelle de Vilnius. A 53 ans, l’homme n’est pas en grande forme. Il tousse de façon inquiétante et, faute de soins adéquats, ses dents commencent à bouger. Il se sent seul et désemparé devant le temps qui passe. Sa femme l’a quitté, sa fille est partie en Arabie saoudite, son propre père a refait sa vie. En dépit de son malaise et de ses doutes, Butkus reste cependant un enquêteur hors pair susceptible de résoudre les enquêtes les plus compliquées. Et celle qui l’attend s’annonce particulièrement délicate.
Un meurtre barbare
 Le 22 octobre 2016, une jeune femme, apparemment une jeune mère, est retrouvée morte, entièrement nue dans la forêt. Elle n’a pas été violée, mais le tueur a bu son lait avant de mutiler ses seins. Sur son front, la police découvre une colombe sans vie. Un grand aigle a par ailleurs été vu planant non loin de la scène du crime. D’autres homicides similaires suivront ce meurtre barbare, la police tourne en rond, la population commence à paniquer, on entrevoit la possibilité d’avoir affaire à une secte.
Le 22 octobre 2016, une jeune femme, apparemment une jeune mère, est retrouvée morte, entièrement nue dans la forêt. Elle n’a pas été violée, mais le tueur a bu son lait avant de mutiler ses seins. Sur son front, la police découvre une colombe sans vie. Un grand aigle a par ailleurs été vu planant non loin de la scène du crime. D’autres homicides similaires suivront ce meurtre barbare, la police tourne en rond, la population commence à paniquer, on entrevoit la possibilité d’avoir affaire à une secte.
De façon une fois encore assez classique, Jarolsav Melnik donne au lecteur de l’avance sur l’enquêteur. Il lui permet, au gré d’une alternance régulière mais non systématique, de partager le vécu du tueur, ses obsessions, sa folie. Car oui – on le découvre assez vite – l’homme agit seul, avec pour unique et inquiétant complice un aigle apprivoisé. Son moteur? Sa raison d’être et de tuer? Une soif inextinguible de vengeance….et de lait maternel. L’occasion, pour l’auteur, de nous révéler tout un commerce, voire un authentique trafic, autour de cet aliment primordial.
En raison de son parcours singulier, Jaroslav Melnik conserve un regard neuf, amusé, parfois même étonné, sur son pays d’adoption. Le lecteur en profite pour apprendre une foule de chose sur la Lituanie, son histoire, son économie, sa géographie et le caractère taciturne de ses habitants. Il s’immerge dans la magie de l’isthme de Courlande, découvre que Vilnius est un immense village avec “cà et là des traces de ville” et que ses parcs ressemblent plutôt à des bois. En suivant Butkus chez son médecin, il réalise que le pays a connu une véritable épidémie de tuberculose en 2016. Enfin, à l’occasion d’un repas entre collègues, il apprend que, “en Lituanie, on arrose toujours la pizza de sauces”. Pas très gastronomique, mais pittoresque et utile pour y préparer son estomac si l’on planifie un voyage dans le pays.
 “L’oiseau qui buvait du lait”. De Jaroslav Melnik. Traduit du russe par Michèle Kahn. Actes sud (Actes noirs), 492 p.
“L’oiseau qui buvait du lait”. De Jaroslav Melnik. Traduit du russe par Michèle Kahn. Actes sud (Actes noirs), 492 p.







 Situé au Nigéria, “Les colliers de feu” de Femi Kayode relève de cette catégorie-là. Son auteur, qui vit aujourd’hui en Namibie, a grandi à Lagos. Il a étudié la psychologie clinique avant d’entamer une carrière dans la publicité. Après avoir écrit pour la télévision et le théâtre, il a suivi une formation en creative writing couronnée de succès. “Les colliers de feu”, son premier livre, a reçu le Little, Brown/UEA Crime Fiction Award. Il est en cours de traduction dans une dizaine de pays.
Situé au Nigéria, “Les colliers de feu” de Femi Kayode relève de cette catégorie-là. Son auteur, qui vit aujourd’hui en Namibie, a grandi à Lagos. Il a étudié la psychologie clinique avant d’entamer une carrière dans la publicité. Après avoir écrit pour la télévision et le théâtre, il a suivi une formation en creative writing couronnée de succès. “Les colliers de feu”, son premier livre, a reçu le Little, Brown/UEA Crime Fiction Award. Il est en cours de traduction dans une dizaine de pays.



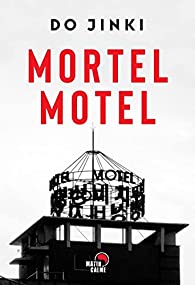

 “Froid comme l’enfer”. De Lilja Sigurdardóttir. Traduit de l’islandais par Jean-Christophe Salaün. Editions Métailié, 288 p.
“Froid comme l’enfer”. De Lilja Sigurdardóttir. Traduit de l’islandais par Jean-Christophe Salaün. Editions Métailié, 288 p. 
 “Je vis la bête surgir de la mer”. D’Ulrich Effenhauser. Traduit de l’allemand par Carole Fily. Actes Sud, coll. Actes noirs, 240 p.
“Je vis la bête surgir de la mer”. D’Ulrich Effenhauser. Traduit de l’allemand par Carole Fily. Actes Sud, coll. Actes noirs, 240 p. 
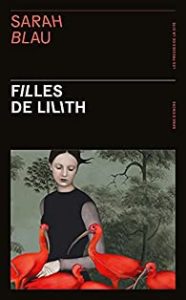 “Filles de Lilith”. De Sarah Blau. Traduit de l’hébreu par Sylvie Cohen. Les Presses de la Cité, 252 p.
“Filles de Lilith”. De Sarah Blau. Traduit de l’hébreu par Sylvie Cohen. Les Presses de la Cité, 252 p.