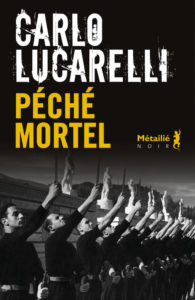Peu de romanciers se sont emparés du Covid. Une relative amnésie qui redouble l’intérêt du dernier polar de Qiu Xiaolong, « Amour, meurtre et pandémie ». Non content de redonner travail et respectabilité à son désormais ex-inspecteur principal Chen Cao, l’écrivain nous plonge dans l’indicible horreur d’une Chine soumise, contre vents et marées, à l’implacable politique du zéro Covid. L’auteur dédie d’ailleurs son livre à tous ceux « qui ont souffert de la pandémie ». En précisant : « La longue liste des victimes inclut mon mentor, le professeur Li Wenjun.»
Un regard percutant sur la Chine
Rappelons que Qiu Xiaolong, qui vit aujourd’hui aux Etats-Unis et écrit en anglais, est né à Shanghai en 1953. Alors que son père, professeur, était victime des brimades des gardes rouges, il fut lui-même interdit de cours durant la révolution culturelle. Ces obstacles ne l’ont pas empêché d’apprendre l’anglais, et de se passionnner pour le poète T.S. Eliot auquel il a consacré sa thèse. Parti poursuivre ses études aux Etats-Unis en 1988, Qiu Xiaolong choisit d’y rester quand éclatent les événements de Tiananmen. Cette distance géographique et la mise en perspective du polar lui permettent ainsi, depuis plus de vingt ans, de poser un regard indépendant, percutant et lucide sur ce pays cher à son cœur dont il décrit l’évolution et les dérives livre après livre.
Quand démarre « Amour, meurtre et pandémie », le policier poète Chen Cao est « en congé de convalescence ». Sanctionné par ses supérieurs, il a par ailleurs été relégué à un poste purement formel à la tête de la réforme du système judiciaire. Alors que le Covid s’étend de jour en jour, il se promène dans une ville désertée, suivant des yeux l’incessant ballet des ambulances et des voitures en route pour l’hôpital. Il n’en oublie pas pour autant de faire un saut au Pavillon de l’abricotier en fleurs pour acheter « des brioches fourrées au porc grillé et des raviolis aux crevettes et au porc », l’un des mets préférés de sa mère. Fin gourmet il fut, fin gourmet il reste même en temps de crise.
Les trois meurtres de l’hôpital Renji
De retour chez lui, et alors qu’il reçoit la visite de sa jeune, charmante et visiblement très amoureuse assistante Jin, Chen Cao voit débarquer sans prévenir le directeur du personnel de la municipalité de Shanghai, Hou. Cet officiel du Parti, qui se déplace dans une prestigieuse voiture Drapeau rouge, vient requérir son aide dans « une grave affaire de meurtres en série », trois cadavres retrouvés à proximité de l’hôpital Renji.  Sa requête s’apparente à un ordre. Chen doit s’y soumettre sans tarder, efficacement secondé par Jin.
Sa requête s’apparente à un ordre. Chen doit s’y soumettre sans tarder, efficacement secondé par Jin.
Parallèlement à son enquête, notre légendaire inspecteur reçoit par Internet des petits textes d’un ami écrivain de Wuhan. Ces billets glaçants parlent de gens qui meurent emmurés dans leur appartement, de femmes enceintes et d’enfants en bas âge qui décèdent dans l’ambulance ou devant l’hôpital faute de pouvoir produire un test Covid négatif de moins de 24 heures. Ils témoignent aussi de la répression qui frappe sans pitié tous ceux qui se révoltent contre les ordres du Parti.
Ces récits – désignés comme « Le Dossier Wuhan » – vont alimenter l’enquête de Chen, et contribuer à sa découverte de la vérité. Car bien entendu notre policier finira par démasquer le – ou les – coupable. Il se verra toutefois contraint de dissimuler la réalité des faits à ses concitoyens afin de ne pas porter préjudice à la politique sanitaire aberrante du gouvernement. Cet interdit ne fera que renforcer sa résolution de tenter de publier hors de Chine le contenu du « Dossier de Wuhan ». Quitte à tromper la censure en traduisant les textes en anglais et en les plaçant sous la couverture d’un recueil de poésie classique.
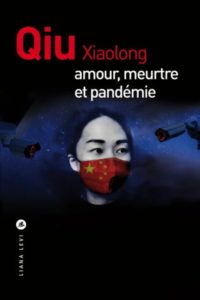 « Amour, meurtre et pandémie ». De Qiu Xiaolong. Traduit de l’anglais par Françoise Bouillot. Liana Levi, 224 p.
« Amour, meurtre et pandémie ». De Qiu Xiaolong. Traduit de l’anglais par Françoise Bouillot. Liana Levi, 224 p.


 Sa requête s’apparente à un ordre. Chen doit s’y soumettre sans tarder, efficacement secondé par Jin.
Sa requête s’apparente à un ordre. Chen doit s’y soumettre sans tarder, efficacement secondé par Jin.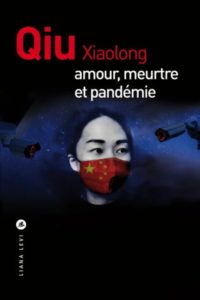 « Amour, meurtre et pandémie ». De Qiu Xiaolong. Traduit de l’anglais par Françoise Bouillot. Liana Levi, 224 p.
« Amour, meurtre et pandémie ». De Qiu Xiaolong. Traduit de l’anglais par Françoise Bouillot. Liana Levi, 224 p. 
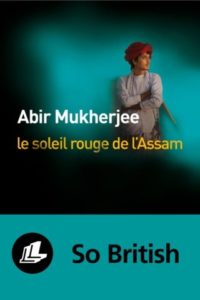 « Le soleil rouge de l’Assam ». D’Abir Mukherjee. Traduit de l’anglais par Fanchita Gonzalez Batlle. Liana Levi, 414 p.
« Le soleil rouge de l’Assam ». D’Abir Mukherjee. Traduit de l’anglais par Fanchita Gonzalez Batlle. Liana Levi, 414 p. 
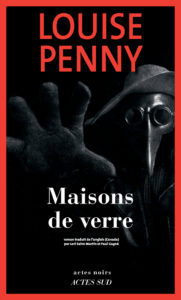 « Maisons de verre ». De Louise Penny. Traduit de l’anglais par Lori Saint-Martin et Paul Gagné. Actes Sud, coll. Actes noirs, 446 p.
« Maisons de verre ». De Louise Penny. Traduit de l’anglais par Lori Saint-Martin et Paul Gagné. Actes Sud, coll. Actes noirs, 446 p. 
 « Le rideau déchiré ». De Maryla Szymiczkowa. Traduit du polonais par Cécile Bocianowski. Agullo, 388 p.
« Le rideau déchiré ». De Maryla Szymiczkowa. Traduit du polonais par Cécile Bocianowski. Agullo, 388 p. 
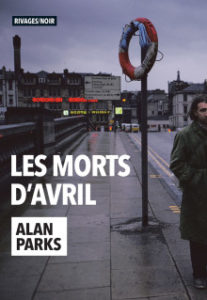 « Les Morts d’avril ». D’Alan Parks. Traduit de l’anglais par Olivier Deparis. Editions Payot & Rivages, collection Rivages/ Noir, 446 p.
« Les Morts d’avril ». D’Alan Parks. Traduit de l’anglais par Olivier Deparis. Editions Payot & Rivages, collection Rivages/ Noir, 446 p.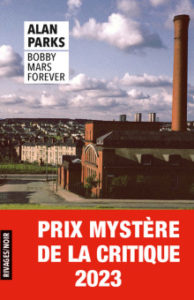 A lire aussi : « Bobby Mars forever ». D’Alan Parks. Traduit de l’anglais par Olivier Deparis. Rivage/Noir poche, 320 p.
A lire aussi : « Bobby Mars forever ». D’Alan Parks. Traduit de l’anglais par Olivier Deparis. Rivage/Noir poche, 320 p. 
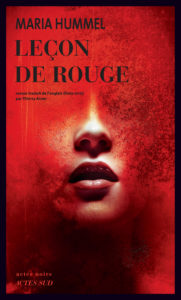 « Leçon de rouge ». De Maria Hummel. Traduit de l’anglais par Thierry Arson. Actes Sud, coll. Actes noirs, 334 p.
« Leçon de rouge ». De Maria Hummel. Traduit de l’anglais par Thierry Arson. Actes Sud, coll. Actes noirs, 334 p. 
 Son nouveau roman, « Je suis le châtiment », rompt avec cet héritage d’intrigues labyrinthiques, de perversions mafieuses et de violences extrêmes. Il s’articule autour de la figure séduisante et complexe du procureur adjoint Manrico Spinori della Rocca, Rick pour les intimes, un aristocrate de vieille souche ruiné par une mère ludopathe. Un homme divorcé, amateur de belles femmes, et surtout d’opéra. Il assiste d’ailleurs à une représentation de « Tosca » quand, juste après le deuxième acte et parce qu’il est de garde, il se voit « convoqué dans un tout autre théâtre ».
Son nouveau roman, « Je suis le châtiment », rompt avec cet héritage d’intrigues labyrinthiques, de perversions mafieuses et de violences extrêmes. Il s’articule autour de la figure séduisante et complexe du procureur adjoint Manrico Spinori della Rocca, Rick pour les intimes, un aristocrate de vieille souche ruiné par une mère ludopathe. Un homme divorcé, amateur de belles femmes, et surtout d’opéra. Il assiste d’ailleurs à une représentation de « Tosca » quand, juste après le deuxième acte et parce qu’il est de garde, il se voit « convoqué dans un tout autre théâtre ».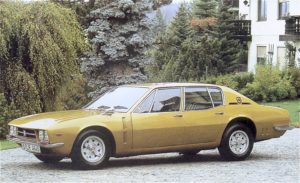
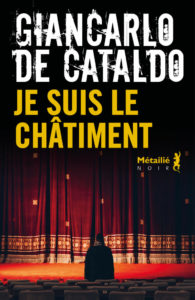

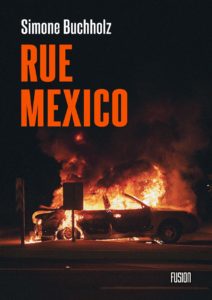 « Rue Mexico ». De Simone Buchholz. Traduit de l’allemand par Claudine Layre. Editions L’Atalante, Collection Fusion, 252 p.
« Rue Mexico ». De Simone Buchholz. Traduit de l’allemand par Claudine Layre. Editions L’Atalante, Collection Fusion, 252 p.