Deux crimes, perpétrés à trois mois de distance, dans deux villes aussi éloignées l’une de l’autre que Calcutta et Londres. Pour les résoudre, un seul enquêteur. Idéaliste, doué, mais débutant. Et à l’autre bout de la chaîne, un lecteur parfaitement ignorant qui va devoir découvrir les deux affaires simultanément, au gré de chapitres savamment alternés, et heureusement clairement balisés.
L’écrivain Ajay Chowdhury ne s’est pas simplifié la tâche pour son premier roman. Son audace lui a visiblement réussi puisque “Le serveur de Brick Lane” a été récompensé en 2019 par le Debut Crime Writing Award et que les droits audiovisuels en ont été acquis par la BBC. Il est vrai que cet entrepreneur dans les nouvelles technologies s’aventurait en terrain connu. Il a lui-même grandi entre Calcutta et Bombay et vit depuis 1986 à Londres, où il a fondé une compagnie de théâtre revisitant notamment “Le marchand de Venise” au sein des communautés indo-pakistanaises.
Dans “Le serveur de Brick Lane”, l’enquêteur s’appelle Kamil Rahman. Obligé de quitter Calcutta après avoir trop bien enquêté sur le meurtre d’une star de Bollywood, ce trentenaire a abandonné ses parents et sa fiancée pour se réfugier à Londres chez des amis de sa famille. Les Chatterjee – qui ont une charmante fille baptisée Anjoli – tiennent le restaurant Tandoori Knights sur Brick Lane, au cœur du quartier des communautés bangladaise et indienne de Londres. Troquant son uniforme blanc de policier contre le gilet et le nœud papillon du serveur, notre ex-sous-inspecteur aux homicides y travaille provisoirement au noir. C’est dans le cadre de cet emploi précaire qu’il se retrouve confronté au meurtre du richissime homme d’affaire Rakesh Sharma, un ami de ses hôtes londoniens.
Une vérité qui fait mal
Qui avait intérêt à éliminer Rakesh Sharma? Beaucoup de monde apparemment. Et notamment tous ceux que le magnat avait ruinés dans sa brusque faillite. Il s’avère aussi que ce crime n’est pas sans lien avec celui de Calcutta. A titre totalement inofficiel, Kamil Rahman retrouve ses réflexes et ses talents d’enquêteur, secondé dans sa tâche par la pétillante et infatigable Anjoli. Au cours de ses investigations, notre attachant policier-serveur va découvrir que son propre père – commissaire en chef de la police de Calcutta à la retraite – n’est pas aussi irréprochable et incorruptible qu’il l’avait cru. Dans la foulée, il apprendra lui-même qu’il faut parfois accepter de faire quelques entorses à ses principes pour sauver ceux qu’on aime.
Un polar à croquer
 “Le serveur de Brick Lane” est un polar riche, coloré, accrocheur, jamais simpliste. Il se lit en outre avec délices et gourmandise car Ajay Chowdhury ne manque pas une occasion de décrire avec précision les mets et les parfums entêtants de son pays d’origine, curcuma orange, fenouil jaune, poudre de piment rouge, cumin, coriandre, graine de moutarde ou cannelle. Il nous permet même d’assister, en direct, à une dégustation de kathi rolls de chez Nizam, au New Market de Calcutta. Une galette brûlante que son héros retrouve comme dans son souvenir, “chaude et épicée, le goût fumé et légèrement acide de la viande se mariant parfaitement avec la pâte feuilletée et croustillante de la paratha, l’onctuosité de l’œuf et la saveur piquante et fraîche des oignons, des tomates et des piments crus.” A tomber, nous assure l’auteur. On le croit aisément.
“Le serveur de Brick Lane” est un polar riche, coloré, accrocheur, jamais simpliste. Il se lit en outre avec délices et gourmandise car Ajay Chowdhury ne manque pas une occasion de décrire avec précision les mets et les parfums entêtants de son pays d’origine, curcuma orange, fenouil jaune, poudre de piment rouge, cumin, coriandre, graine de moutarde ou cannelle. Il nous permet même d’assister, en direct, à une dégustation de kathi rolls de chez Nizam, au New Market de Calcutta. Une galette brûlante que son héros retrouve comme dans son souvenir, “chaude et épicée, le goût fumé et légèrement acide de la viande se mariant parfaitement avec la pâte feuilletée et croustillante de la paratha, l’onctuosité de l’œuf et la saveur piquante et fraîche des oignons, des tomates et des piments crus.” A tomber, nous assure l’auteur. On le croit aisément.
 “Le serveur de Brick Lane.” D’Ajay Chowdhury. Traduit de l’anglais par Lise Garond. Editions Liana Levi, 304 p.
“Le serveur de Brick Lane.” D’Ajay Chowdhury. Traduit de l’anglais par Lise Garond. Editions Liana Levi, 304 p.


 Lui-même passionné de pêche à la truite, Keith McCafferty – dont les sept romans ont reçu de nombreux prix littéraires – a le sens des titres qui font mouche. Voici donc “Le Baiser des Crazy Mountains”, une histoire dont je vous mets au défi de découvrir le fin mot avant la dernière partie. Un récit romanesque, voire épique qui, comme il se doit, commence par une macabre découverte.
Lui-même passionné de pêche à la truite, Keith McCafferty – dont les sept romans ont reçu de nombreux prix littéraires – a le sens des titres qui font mouche. Voici donc “Le Baiser des Crazy Mountains”, une histoire dont je vous mets au défi de découvrir le fin mot avant la dernière partie. Un récit romanesque, voire épique qui, comme il se doit, commence par une macabre découverte.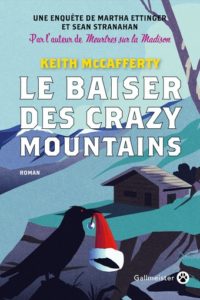 “Le Baiser des Crazy Mountains”. De Keith McCafferty. Traduit de l’américain par Marc Boulet. Gallmeister, 486 p. En librairie le 6 mai.
“Le Baiser des Crazy Mountains”. De Keith McCafferty. Traduit de l’américain par Marc Boulet. Gallmeister, 486 p. En librairie le 6 mai.
 La Yougoslavie se fissure, elle s’apprête à basculer dans le chaos, mais nos héros ne le savent pas encore. “C’était une journée chaude et splendide de septembre, comme si le ciel se moquait d’eux par avance”, écrit Jurica Pavičić. Après un dîner en famille, Silva quitte ses parents et son frère jumeau Mate pour se rendre à la fête des pêcheurs. C’est la dernière fois qu’ils la verront. La jeune fille ne rentre ni le lendemain, ni les jours qui suivent. Les policiers interrogent son petit ami – absent de Misto ce soir-là – ainsi que le fils du boulanger, Adrijan, avec qui elle a passé la soirée. Peu à peu le portrait de la jeune fille un brin rebelle mais sans histoire se fissure. On découvre qu’elle dealait de l’héroïne et rêvait de s’enfuir à l’étranger. Le père et son fils placardent des photos de la disparue dans toute la région. On craint le pire. C’est alors qu’une jeune femme déclare l’avoir vue le lendemain de sa disparition à la gare routière de Split où elle s’apprêtait à acheter un billet au guichet international.
La Yougoslavie se fissure, elle s’apprête à basculer dans le chaos, mais nos héros ne le savent pas encore. “C’était une journée chaude et splendide de septembre, comme si le ciel se moquait d’eux par avance”, écrit Jurica Pavičić. Après un dîner en famille, Silva quitte ses parents et son frère jumeau Mate pour se rendre à la fête des pêcheurs. C’est la dernière fois qu’ils la verront. La jeune fille ne rentre ni le lendemain, ni les jours qui suivent. Les policiers interrogent son petit ami – absent de Misto ce soir-là – ainsi que le fils du boulanger, Adrijan, avec qui elle a passé la soirée. Peu à peu le portrait de la jeune fille un brin rebelle mais sans histoire se fissure. On découvre qu’elle dealait de l’héroïne et rêvait de s’enfuir à l’étranger. Le père et son fils placardent des photos de la disparue dans toute la région. On craint le pire. C’est alors qu’une jeune femme déclare l’avoir vue le lendemain de sa disparition à la gare routière de Split où elle s’apprêtait à acheter un billet au guichet international. “L’Eau rouge”. De Jurica Pavičić. Traduit du croate par Olivier Lannuzel. Agullo, 362 p.
“L’Eau rouge”. De Jurica Pavičić. Traduit du croate par Olivier Lannuzel. Agullo, 362 p.
 Native précisément du Vermont, la Maggie du roman s’est initiée toute jeune au journalisme d’investigation avec un ponte du genre. Après un détour par la Thaïlande où elle rencontre Greg Ferguson, elle s’installe à Los Angeles avec son compagnon. Elle travaille au Rocque Museum comme rédactrice-correctrice. Il devient galeriste. Le couple toutefois se sépare quand Greg tombe amoureux d’une artiste célèbre, la belle et intrigante Kim Lord dont le processus créatif ressemble à une synthèse de plusieurs démarches artistiques qui nous sont désormais familières. Kim Lord, en effet, se photographie déguisée et maquillée en quelqu’un d’autre. Ces clichés lui servent ensuite de point de départ à la réalisation de peintures, avant d’être détruits.
Native précisément du Vermont, la Maggie du roman s’est initiée toute jeune au journalisme d’investigation avec un ponte du genre. Après un détour par la Thaïlande où elle rencontre Greg Ferguson, elle s’installe à Los Angeles avec son compagnon. Elle travaille au Rocque Museum comme rédactrice-correctrice. Il devient galeriste. Le couple toutefois se sépare quand Greg tombe amoureux d’une artiste célèbre, la belle et intrigante Kim Lord dont le processus créatif ressemble à une synthèse de plusieurs démarches artistiques qui nous sont désormais familières. Kim Lord, en effet, se photographie déguisée et maquillée en quelqu’un d’autre. Ces clichés lui servent ensuite de point de départ à la réalisation de peintures, avant d’être détruits. “Le Musée des femmes assassinées”. De Maria Hummel. Traduit de l’anglais par Thierry Arson. Actes Sud, 402 p.
“Le Musée des femmes assassinées”. De Maria Hummel. Traduit de l’anglais par Thierry Arson. Actes Sud, 402 p. 

 “Les vagues reviennent toujours au rivage”. De Xavier-Marie Bonnot. Belfond, 300 p
“Les vagues reviennent toujours au rivage”. De Xavier-Marie Bonnot. Belfond, 300 p
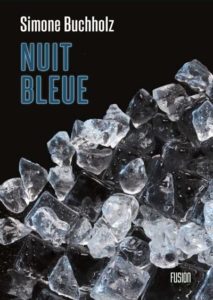 “Nuit Bleue”. De Simone Buchholz. Traduit de l’allemand par Claudine Layre. Collection Fusion, Editions L’Atalante, 336 p. Parution reportée, en librairie depuis le 4 mars.
“Nuit Bleue”. De Simone Buchholz. Traduit de l’allemand par Claudine Layre. Collection Fusion, Editions L’Atalante, 336 p. Parution reportée, en librairie depuis le 4 mars. 

 “Un alibi en béton”. De Peter May. Traduit de l’anglais par Ariane Bataille. Editions du Rouergue, 362 p.
“Un alibi en béton”. De Peter May. Traduit de l’anglais par Ariane Bataille. Editions du Rouergue, 362 p. 
 “Trahison”. De Lilja Sigurdardóttir. Traduit de l’islandais par Jean-Christophe Salaün. Editions Métailié, 350 p.
“Trahison”. De Lilja Sigurdardóttir. Traduit de l’islandais par Jean-Christophe Salaün. Editions Métailié, 350 p. 
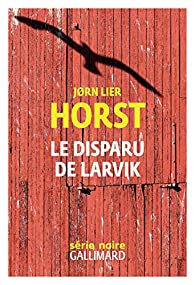 “Le disparu de Larvik”. De
“Le disparu de Larvik”. De 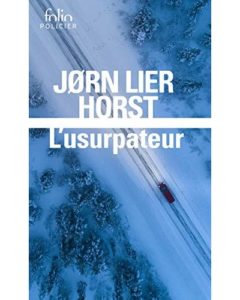 A lire également: “L’usurpateur”. De Jørn Lier Horst. Traduit du norvégien par Céline Romand-Monnier. Folio policier, 446 p.
A lire également: “L’usurpateur”. De Jørn Lier Horst. Traduit du norvégien par Céline Romand-Monnier. Folio policier, 446 p.
 Gérard Gémeaux n’en a toutefois pas transmis le mot de passe à ses proches. Un code d’accès qui peut contenir jusqu’à 80 caractères. L’a-t-il consigné quelque part ou s’est-il contenté de le mémoriser ?
Gérard Gémeaux n’en a toutefois pas transmis le mot de passe à ses proches. Un code d’accès qui peut contenir jusqu’à 80 caractères. L’a-t-il consigné quelque part ou s’est-il contenté de le mémoriser ? « Le code et la diva ». De Christian Grenier. Editions du Rouergue, 478 p.
« Le code et la diva ». De Christian Grenier. Editions du Rouergue, 478 p.