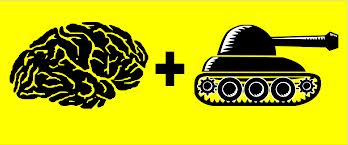Cette question désagréable jaillit au détour de presque chaque conversation sur l’Union européenne, l’immigration, le secret bancaire: «Mais toi, tu es pro-européen?». J’ajoute le point d’interrogation par sympathie. En vérité, le ton est plus à l’affirmation qu’à la question polie. Cette question m’énerve prodigieusement depuis de longues années. Cette semaine, elle m’a été posée une fois de trop. Je tente de canaliser mon énervement sous forme de chronique. D’autres lancent des initiatives populaires, chacun son truc.
De manière fondamentale, la question énerve parce qu’elle induit un débat tronqué. Elle énerve parce qu’elle fait le jeu des isolationnistes. Elle énerve parce qu’elle empêche depuis vingt ans un débat européen apaisé en Suisse.
Depuis décembre 1992, la question «es-tu pro-européen?» est la version raccourcie de la question «es-tu pour l’adhésion?». Cette question sous-entend donc plusieurs éléments très importants. Premièrement, elle suppose que la question de l’adhésion reste la pierre angulaire de toute discussion sur l’UE. Deuxièmement, elle suppose que l’UE peut être mise de côté dans une discussion de politique suisse. Le vice-président du PLR Suisse, le Genevois Christian Lüscher, souffre de ce syndrome lorsqu’il affirme espérer que la «question européenne» ne vienne pas «polluer la campagne des élections fédérales 2015» (Le Temps, 15 mai 2014). Plus grave, les acolytes du vieux monsieur zurichois et de son comité «UE Non» utilisent la question pour présumer que l’existence même de l’UE peut être remise en question. Dans leur imaginaire, l’UE disparaitra bientôt.
L’UE est une réalité que les décideurs politiques doivent accepter. Son importance économique, politique, sociale et culturelle s’impose à la Suisse. Sa pertinence se glisse dans chacune de nos discussions. Virtuellement, aucun sujet de politique suisse n’échappe à la dimension européenne. Dans ce contexte, la question d’être «pro-européen» n’a absolument pas de sens car il n’y pas d’autres options que de réfléchir à nos relations avec l’UE. A ce titre, le vieux monsieur zurichois est devenu le premier (ex)-parlementaire vraiment «contre-européen». Depuis deux semaines, il prône ouvertement une voie solitaire qui nie l’existence de l’UE et son importance pour la Suisse.
Outre cette frange coupée de toute réalité, nous sommes donc tous «pro-européens». Soit me direz-vous, la question n’est pas pertinente, mais elle n’est pas bien méchante non plus. Détrompons-nous. Depuis 1992, les isolationnistes entretiennent avec ferveur cette question. Qui s’en étonne? Dès qu’elle est posée, elle fait déjà 80% du travail de persuasion. Personne ne peut répondre par l’affirmative sans être rangé dans le camp de l’adhésion. La question crée un fossé dans n’importe quelle discussion politique car l’interlocuteur est forcé de réaliser un faux choix entre l’adhésion et la négation de la pertinence de l’UE. Le spectre politique des solutions constructives est éliminé d’une seule question: soit l’adhésion et l'isolement politique interne, soit la marche solitaire et l’isolement politique externe. De manière intéressante, le 9 février et l’action décidée du NOMES ont remis cette question au goût du jour. En effet, l’organisation est ouvertement pour l’adhésion et elle peut donc travailler avec aisance dans le champ conceptuel ouvert par la question.
Sous l’effet de cette question du «pro-européen», le match est perdu d’avance pour les forces politiques constructives. Il est urgent de la remplacer par une approche à la fois pragmatique et fonctionnelle. Dans cette nouvelle optique, la question ressemblerait à ceci: comment la Suisse peut-elle défendre au mieux ses intérêts auprès de l’UE?
Cette question exige de se focaliser sur les éléments clefs du débat: quels sont les intérêts de la Suisse et comment les défendre. La définition des intérêts peut-être réalisée de manière plus ou moins large, incluant notamment nos contributions de solidarité au projet européen. Il est essentiel de lier cette question à une définition substantielle de la souveraineté. Une Suisse souveraine est une Suisse qui défend ses intérêts, pas une Suisse qui s’arcboute sur des compétences vidées de leur substance. La question des moyens pour défendre ces intérêts ouvre un spectre de solutions institutionnelles qu’on peut ensuite décliner selon les thématiques. Le degré de collaboration peut varier selon la sensibilité des sujets abordés. A titre d’exemple, nous n’aurons pas le même degré de collaboration sur le contrôle des frontières, en matière de recherche ou dans le domaine de la sécurité militaire.
L’essentiel se trouve dans l’espace de dialogue politique qu’ouvre cette nouvelle question. La discussion ne se pose plus en noir et blanc, elle permet des nuances et des avancées. L’adhésion n’est pas exclue à titre d’option politique. Elle représente l’une des réponses possibles à la question «comment défendre au mieux nos intérêts». Cette approche permet aux supporters du NOMES de mettre en avant des éléments substantiels permettant d'expliquer pourquoi une Suisse forte est une Suisse membre. Grâce au nouvel espace de dialogue, nous quittons le terrain idéologique. A l’inverse, l’option de l’«Alleingang» semble exclue, à moins de pouvoir démontrer que l’isolement est la meilleure façon de défendre nos intérêts. C’est en posant avec fermeté cette question aux isolationnistes que la faiblesse de leur argument apparaitra.
La prochaine fois que votre interlocuteur vous demande si vous êtes «pro-européen», croquez une chips et buvez une gorgée. Puis relancez la discussion en demandant comment la Suisse peut défendre au mieux ses intérêts auprès de l’UE. La conversation sera bien plus intéressante. Pari tenu.