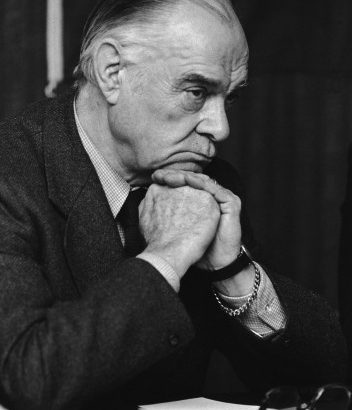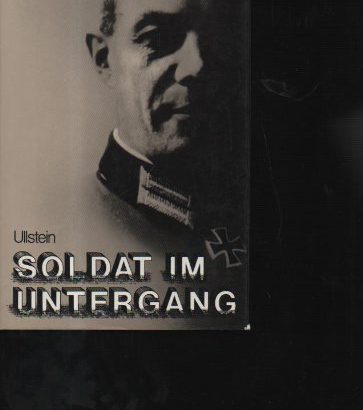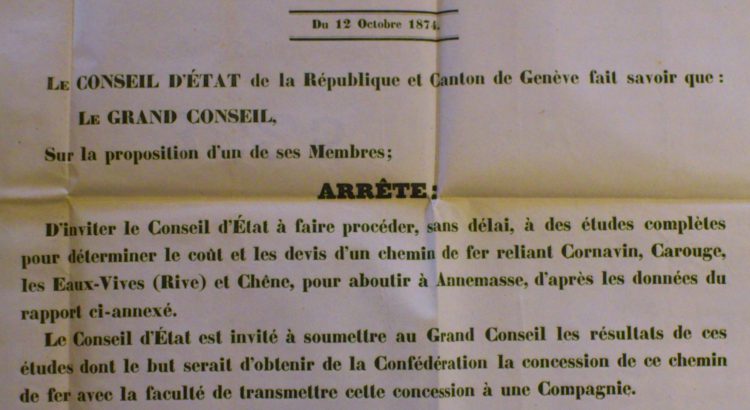Il est des aventures qui ne sont ni intérieures, ni guerrières, ni amoureuses, ni financières et dont les défis semblent insurmontables.
La presse écrite aujourd’hui se réduit au profit du numérique, nul ne peut nier l’évidence, et les livres « internetisés » se multiplient, obligeant les éditeurs à se réinventer. Se réinventer en partie seulement puisque, d’un autre côté, la production de livres ne semble pas fléchir. Quoi qu’il en soit, la tendance au numérique est en expansion. Le Fonds National de la Recherche Scientifique n’échappe pas à cette évolution puisque l’année passée, décision a été prise d’encourager les publications on line en diminuant les financements d’ouvrages papiers. Une décision qu’il faut saluer en ce qui concerne de nombreuses sciences exactes comme la médecine ou la biologie pour lesquelles un vecteur d’informations informatique s’avère logique, permettant ainsi d’améliorer la diffusion du savoir et d’économiser de l’argent utile à la recherche. Pour d’autres disciplines comme l’histoire, par exemple, pour qui le livre en papier d’un demi-kilo fait encore référence dans la plupart des universités, cette option numérique pourrait s’avérer une calamité ! C’est que, pour reprendre les mots de l’écrivain Mikhaïl Boulgakov, « Le papier couvert d’écriture brûle mal », tant il est vrai que les idées une fois exprimées par l’encre demeurent plus longtemps dans les esprits puisque physiquement incarnées dans un objet.
Face à ces évolutions technologiques, faire le saut dans l’inconnu, se lancer dans un projet à contre-courant en créant un media n’ayant encore jamais existé jusqu’alors en Suisse romande, sur du papier de surcroît, semblait une gageure perdue d’avance. Et pourtant Justin Favrod a fermé les écoutilles sur les sombres échos d’oiseaux de mauvais augures et s’est jeté dans la bataille à corps perdu ! Il a ainsi inventé, organisé et diffusé une revue d’histoire, intitulée Passé simple, destinée à un grand public en tablant sur le passé des cantons romands, un passé multiple, différent, parfois en relation, souvent compliqué. Mais une histoire, ou plutôt des histoires passionnantes trop peu racontées.
Le résultat après un trimestre est, je crois, un succès indéniable. La fin inéluctable du papier n’est pas encore pour demain, et la demande « d’histoire » permettant de mieux comprendre le passé demeure plus que vivante ! Mais je ne suis en définitive, pour plagier le Canadien Albert Brie, qu’un « témoin oculaire d’événements qui se produisent sur papier » et le mieux est donc de donner la parole à Justin Favrod afin qu’il puisse s’exprimer sur son expérience.
"Passé simple, ce n’est pas toujours simple (de Justin Favrod)
Voilà plus de quatre mois que le numéro de lancement de Passé simple est sorti de presse. Après quatre numéros publiés, c’est peut-être le moment de tirer un premier bilan de la création de ce mensuel romand d’histoire et d’archéologie.
Cette première étape semble constituer un succès. Pour financer les charges, il me fallait entre 1200 et 1400 abonné-e-s. Pour m’accorder un salaire, le nombre de 3000 abonnements est nécessaire. Il fallait impérativement parvenir à 2000 adhésions en décembre 2015 sans quoi la viabilité économique du projet était menacée. Or à la fin du mois de mars 2015, 1950 personnes ont déjà contracté un abonnement.
Ce succès s’explique surtout par la couverture médiatique importante et spontanée accordée à Passé simple: la bienveillance des journalistes à l’égard de cette entreprise, qui met le papier en avant à un moment de profonde crise de ce support, a joué un rôle crucial. Car chaque article ou chaque émission parlant de Passé simple a permis de contracter des dizaines d’abonnements. Il reste que Passé simple doit répondre à une attente: le public ne contracterait pas d’abonnement si l’histoire, l’archéologie, le patrimoine de la Suisse romande ne l’intéressaient nullement.
Les autres soutiens ont été nombreux. La petite équipe qui accompagne chaque édition de Passé simple s’est montrée compétente et dévouée. De nombreuses personnes extérieures ont apporté leur aide. Les musées, les bibliothèques et les archives fournissent des illustrations sans rien demander en retour. Des maisons d’édition ont prodigué des aides techniques. Des sociétés savantes ont appelé leurs membres à s’abonner.
La question de la diffusion hors abonnement constituait une autre difficulté lancinante: l’envoi d’exemplaires par la poste aux divers points de vente qui en faisaient la demande s’avère coûteux et chronophage. La diffusion est assurée depuis le mois de mars 2015 par les librairies Payot, qui à l’exception du Jura et du Jura bernois, couvrent bien la Suisse romande.
D’un point de vue personnel, la création et la gestion de Passé simple constitue une expérience palpitante, pleine de joies et de satisfactions tant humaines qu’intellectuelles. Elle n’en est pas moins semée d’embûches.
Lorsqu’en septembre 2014, j’ai lâché mon travail salarié au quotidien 24 Heures pour créer cette revue, j’ai entendu comme commentaire: «C’est courageux». Les personnes qui me disaient cela pensaient surtout au caractère aventureux sur le plan financier.
Progressivement, je me suis rendu compte que l’inconscience de la démarche ne reposait pas tant sur un possible manque de liquidités que sur les lacunes dans mes compétences. Journaliste pendant bien des années, j’étais sûr qu’il suffisait d’écrire des articles pour produire un journal. Or tel n’est pas le cas: les difficultés apparaissent le plus souvent ailleurs. Les questions de graphisme, de recherches iconographiques, de cohérence dans les normes d’écriture, de recrutement d’auteur-e-s, de relations avec les abonné-e-s, avec l’imprimerie, avec la poste et avec les rares annonceurs, la promotion, la gestion, la recherche de publicité, le réseau à mettre en place pour ne pas rater d’informations importantes et savoir ce qui se fait. L’ampleur de toutes ces activités m’a valu un premier faux pas: j’ai présenté comme inédites des photos de la fusillade de Genève de 1932. Pour la plupart, elles ont été éditées dans les années 1970 : vérification insuffisante faute de temps, faute de systématique.
Même lorsqu’on est épaulé par des professionnels, remplir tant d’exigences émiette irrémédiablement les journées, demande du temps et des compétences. Cela peut sembler une évidence. Pour ma part, elle m’est tombée dessus sans crier gare. Je me suis ainsi rendu compte que toutes les personnes qui travaillaient dans un journal sans être journalistes n’étaient pas seulement utiles, mais indispensables.
Une autre question se pose, celle de la ligne éditoriale. Peu porté sur les concepts, je l’ai réglée instinctivement. Pour peu qu’un article soit instructif, de lecture agréable et repose sur des bases scientifiques solides, il peut être publié. Ne pas imposer sa vision du passé, mais offrir des perspectives variées. Cela m’a conduit à ouvrir mes colonnes à un article sur une identité romande historique à laquelle je ne crois guère. J’ai également publié un dossier sur l’entreprise de l’EPFL visant à scanner et à valoriser toutes les archives de Venise. Le dossier était élogieux, mon éditorial très réservé. D’où le reproche d’incohérence. Je crois en l’intelligence des lectrices et des lecteurs parfaitement capables de se faire leur propre opinion. Reste que mettre côte à côte deux articles qui conduisent à des conclusions opposées n’est confortable pour personne. Jusqu’où aller?
La troisième difficulté est de trouver le juste niveau d’écriture pour une revue qui ambitionne de s’adresser au grand public. Il s’agit de ne pas brader la rigueur scientifique des disciplines historiques tout en donnant un tour plaisant aux articles. La majeure partie des contributrices et contributeurs sont issus du monde académique; une partie travaille dans des universités. Ce n’est pas là qu’on apprend à écrire pour être lu. Quoi qu’on en pense, l’écriture journalistique est un métier à part entière. Il y a un équilibre à trouver dans une réécriture qui respecte le style individuel et le contenu, mais qui permette une lecture aisée. Pour tenter de régler cette question, des recommandations aux auteur-e-s ont été rédigées. Elles ne sont pas toujours respectées…
La dernière embûche est de respecter les équilibres. Il faut que tous les cantons, toutes les périodes, les diverses disciplines du passé soient représentées pour répondre à l’éparpillement des lectrices et des lecteurs qui viennent de toute la Suisse romande et qui ont des intérêts divers. Si les sujets ne manquent pas, il n’est pas si facile de trouver dans chaque région des auteur-e-s. Cela dépend de la présence de réseau de spécialistes et d’universités, mais aussi de mon propre parcours qui m’a conduit à nouer des relations dans telle région et pas dans telle autre. Il m’est en tout bien plus facile de dénicher un spécialiste lausannois qui parle d’histoire vaudoise qu’un archéologue jurassien traitant d’un site de son canton. Autre défi que je n’attendais pas. Il y a dans le monde de la recherche une quasi parité entre femmes et hommes. Il est toutefois en général plus difficile de convaincre une femme qu’un homme d’écrire une contribution. Pour l’heure, les offres spontanées sont exclusivement venues de la gent masculine. Cela tient probablement à l’éducation reçue par les unes et par les autres et au fait que les femmes font encore souvent des doubles journées de travail. Mais ce fut pour moi une surprise et j’ai conclu avec un vrai dépit le numéro de février où il n’y avait que des auteurs.
Tous ces points soulevés montrent qu’un effort continu est nécessaire pour ne pas tomber dans le sillon de l’habitude et de la facilité. Remettre en question chaque contribution, chaque illustration, chaque choix. Le principal danger qui guette Passé simple, comme la plupart des entreprises humaines répétitives, c’est l’habitude et les certitudes."