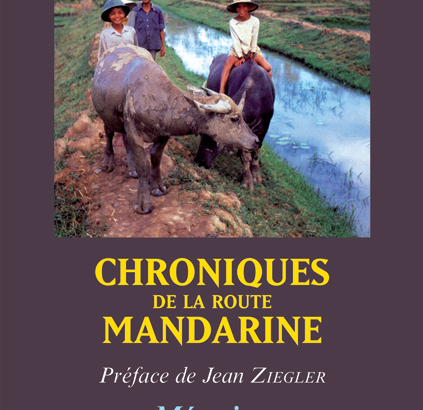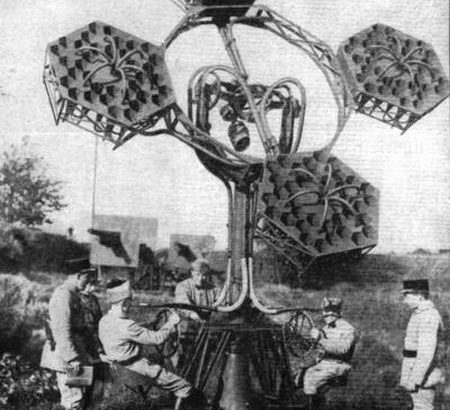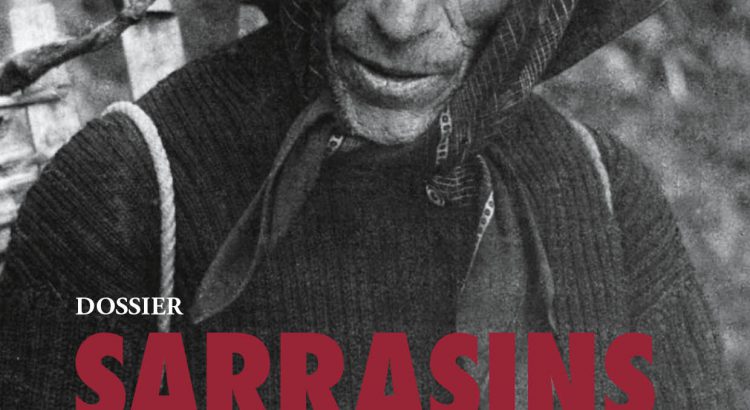Il est des sujets qui fâchent ! Parmi eux, l’histoire suisse. Le débat à propos de « notre histoire si tranquille » ne fait qu’enfler dépassant les cercles de spécialistes. Les dérapages de certains personnages politiques ont, il est vrai, éveillé des passions et surtout suscité des craintes. Que doit-on retenir de notre histoire, quels sont les aspects qu’il convient de mettre en lumière, pourquoi faut-il dénoncer les manipulations du passé ? Des questions qui partagent puisque derrière celles-ci se profilent des enjeux politiques pouvant avoir potentiellement des portées à moyen et long terme (cf. La médiatisation de l’histoire, un enjeu de notre temps – www.hebdo.ch/les-blogs/vuilleumier-christophe-les-paradigmes-du-temps/la-m%C3%A9diatisation-de-l%E2%80%99histoire-un-enjeu-de). Sans tomber dans des discours dramatiques et angoissés de visions totalitaristes, ce sont bien évidemment des positionnements politiques de la Suisse à l’égard de ses voisins, de l’Europe, de l’immigration, mais encore de l’armée ou du rôle de la femme dont il est notamment question !
Plusieurs historiens, et parmi eux des scientifiques de premier plan comme Thomas Maissen, se sont exprimés sur le sujet. Les Assises de l’histoire du 28 janvier 2015, qui se sont déroulées à Lausanne, et dont le thème était « À quoi sert l’histoire aujourd’hui ? » ont déplacé le cadre de ce débat en se concentrant sur les enjeux de l’enseignement de l’histoire, un enseignement controversé en raison de sa place laissée au sein du Plan d’enseignement romand.
L’Hebdo du 10 avril consacrait un article de fonds à cette problématique, et plus récemment encore, le journaliste du Temps Emmanuel Gehrig publiait le 15 avril un article intitulé Prisonnière du populisme, l’histoire suisse attend sa libération.
D’un autre côté, des politiques appartenant aux mêmes cénacles ayant allumé le feu prétendent que l’histoire ne sert à rien (cf. Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur – www.hebdo.ch/les-blogs/vuilleumier-christophe-les-paradigmes-du-temps/plus-vous-saurez-regarder-loin-dans-le).
Il semblerait en outre, mais cela n’est pas nouveau, qu’oser formuler des considérations, voire des remarques, des critiques mêmes, à propos de déclarations fallacieuses et tronquées portant sur notre passé soit décrié. En témoignent ces commentaires anonymisés provenant de réseaux sociaux : « L'Hebdo, le Temps… autant de temps à économiser à ne plus les lire. J'ai résilié mes abonnements il y a longtemps. Il n'est pas nécessaire de payer pour lire ce qu'on lit déjà partout et ce qu'on entend partout, savoir la pensée unique / Il y a déjà longtemps que la presse a vendu son âme au socialisme ce n'est plus un secret de polichinelle / Une presse aux idées alignées… ployant sous un vent de gauche… et une presse qui se meurt. Et des journalistes qui pour se défendre accusent les lecteurs de lire Facebook en lieu et place des journaux. Bientôt le chômage pour la plupart d'entre eux. Heureusement qu'il y a des sites et des blogs sur le net qui permettent un peu d'air frais dans nos cerveaux d'incultes prétendus. Horresco referens / Le jour où les journalistes, ceux de gauche donc 80%, décideront de faire de l'investigation objective pour redonner une information et non un point de vue personnel, cela signifiera qu'ils ont découvert l'esprit d'entreprise et non du mouton » [sic]. Nous voilà tombé dans la Nef de fous de Sébastian Brant et de son ordo mundi à l’envers !
Loin d’être journaliste, l’historien que je suis, ainsi que la majorité des historiens de ce pays, ont pour éthique d’essayer de conserver une vision la plus objective possible sur des problématiques de ce type. Peut-on faire de l’histoire et rester objectif me diront certains ? Certainement pas, mais du moins est-il possible de s’extraire de positions partisanes ! Les mises en perspective et le recours à des analyses multiples constituent ainsi un champ de référencements que l’on souhaite le plus large possible.
Et s’il est évident que l’histoire ne sert pas à rien, au grand dam des ténors de la pensée facile, comme le démontre le débat actuel, il est tout aussi manifeste que notre pays repose sur une histoire complexe, multiple et passionnante plus riche que le récitatif instrumentalisé ou pas (Morgarten, Marignan, Guisan, etc…) qui constitue la vitrine de l’histoire suisse devant laquelle le quidam, le plus souvent, soupire d’aise ou d’ennui. Faut-il encore en avoir quelques échos ! Qu’il me soit donc permis d’évoquer ici partiellement une collection que je connais bien, puisque publiée par la Société d’Histoire de la Suisse Romande, témoignant de cette richesse de notre histoire :
VONECHE CARDIA, Isabelle, Neutralité et engagement. Le relations entre le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et le Gouvernement suiss, 1938-1945, SHSR, 2012.
PIBIRI, Eva, En voyage pour Monseigneur. Ambassadeurs, officiers et messagers à la cour de Savoie (XIVe-XVe siècles), SHSR, 2011.
TOSATO-RIGO, Danièle, La chronique de Jodocus Jost. Miroir du monde d'un paysan bernois au XVII e siècle, SHSR, 2009.
DEMOTZ, François, La Bourgogne dernier des royaumes carolingiens (855-1056) : rois, pouvoirs et élites autour du Léman, SHSR, 2008.
ANDENMATTEN, Bernard, La Maison de Savoie et la noblesse vaudoise (XIIIe- XVe siècle). Supériorité féodale et autorité princière, SHSR, 2005.
La Suisse occidentale et l’Empire. Actes du colloque des 25-27 avril 2002, édités par J.-D. Morerod, D. Tappy, C. Thévenaz-Modestin et F. Vannotti, SHSR, 2004.
René de Weck, Journal de guerre (1939-1945). Un diplomate suisse à Bucarst. édition critique établie par Simon ROTH, SHSR, 2001.
DUBUIS, Pierre, Dans les Alpes au Moyen Age. Douze coups d’œil sur le Valais, SHSR, 1997.
SEEGER, Cornelia, Nullité de mariage, divorce et séparation de corps à Genève, au temps de Calvin, SHSR, 1989.
Collectif, La formation territoriale des cantons romands: Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève, SHSR, 1989.
Helvetia et le goupillon, Religion et politique en Suisse romande, XIXe-XXe siècle. Actes du colloque de Lausanne du 20 novembre 2010, publié par Alain Clavien, SHSR, 2012.
Guillaume Tell et la libération des Suisses, sous la direction de Jean-Daniel Morerod et Anton Näf, SHSR, 2011.
Art et politique dans le canton de Vaud au XIXe siècle, une relation équivoque. Actes du colloque de Lausanne du 8 novembre 2008 publiés par Olivier MEUWLY, SHSR, 2009.
Les Romands et la Gloire. Actes du colloque de Lausanne du 17 novembre 2001 publiés par Jean-Daniel Morerod et Nathan Badoud, SHSR, 2006.
BORNET, Jean-Marc Bornet, Entre les lignes ennemies. Délégué du CICR (1972-2003), Georg – SHSR, 2011.
VUILLEUMIER, Christophe, Les élites politiques genevoises – 1580-1652, Éditions Slatkine /SHSR, 2009.
VAN DONGEN, Luc, Un purgatoire très discret. La transition "helvétique" d'anciens nazis, fascistes et collaborateurs après 1945, Éditions Perrin /SHSR, 2008.
FELBER, Jean-Pierre, De l’Helvétie romaine à la Suisse romande, Éditions Slatkine / SHSR, 2006.
CLAVIEN, Alain, Les Helvétistes. Intellectuels et politique en Suisse romande au début du siècle, Éditions d’En Bas / SHSR, 1994.