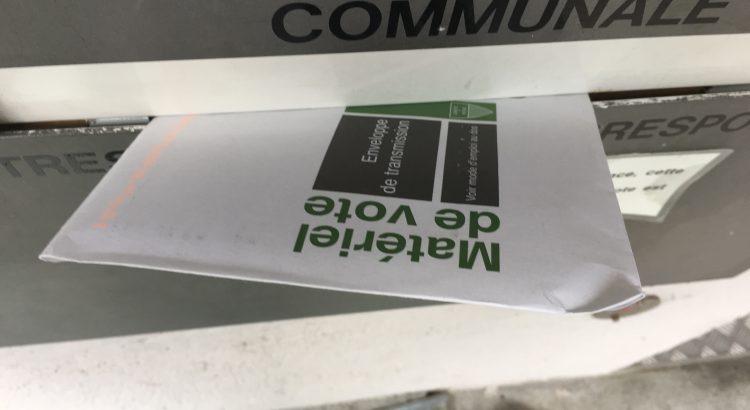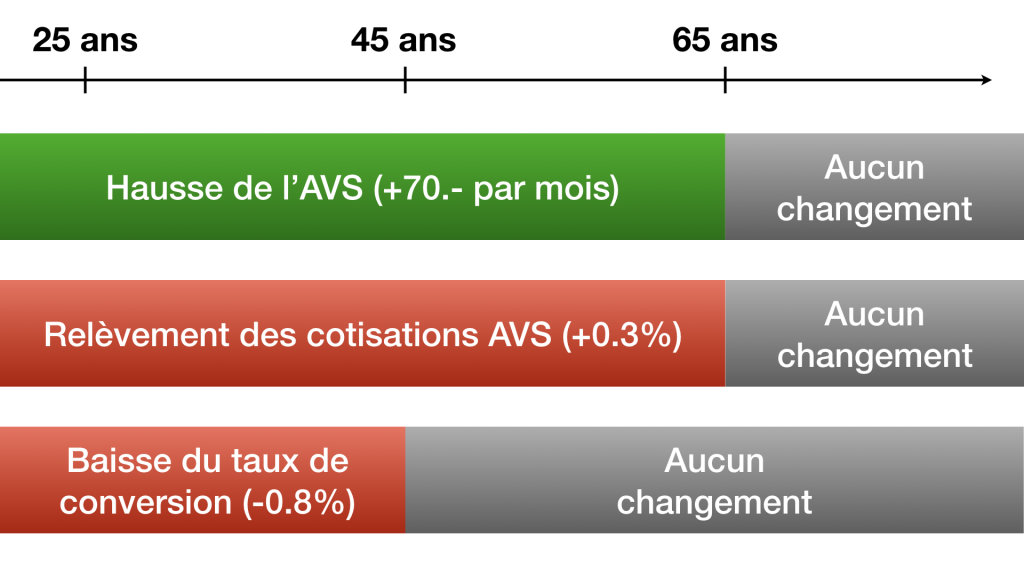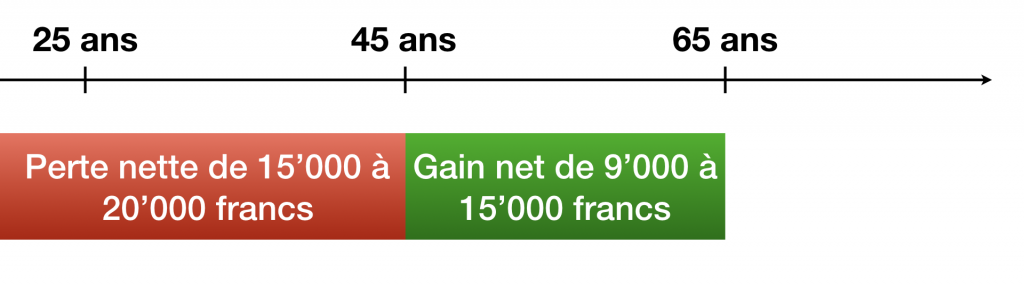Au soir des élections fédérales allemandes, le 24 septembre dernier, Angela Merkel paraissait défaite. Même si son parti demeurait le premier du pays dans les urnes, l’avenir de la chancelière semblait se boucher à grande vitesse. Un mois et demi après, pourtant, elle semble avoir donné à ses adversaires une leçon de politique – sans même qu’ils ne s’en aperçoivent…

Lorsque les premiers résultats tombent, la victoire annoncée d’Angela Merkel semble en demi-teinte. Son parti demeure certes le premier du pays, mais, avec seulement 33% des voix (avec son alliée bavaroise CSU), il réalise son pire résultat depuis 1949. Et pire encore, les deux alliés perdent 65 sièges au Bundestag – alors que celui-ci, paradoxalement, s’agrandit de 78 députés*. Désormais largement minoritaire, l’Union devra donc trouver des partenaires pour se maintenir au pouvoir.
Face à elle, le SPD, usé par cinq ans de coalition gouvernementale, est plus faible que jamais – à peine au-dessus de 20% des voix. Le parti annonce immédiatement qu’il refusera toute coalition pour se lancer dans une véritable politique d’opposition, espérant ainsi redresser la barre lors des élections suivantes.

À l’inverse, les eurosceptiques de l’AfD entrent triomphalement au Bundestag avec 94 sièges, marquant le retour de l’extrême-droite au Parlement d’un pays où ceci est loin d’être anodin. À peine moins nombreux, les libéraux du FDP retrouvent aussi le chemin de Berlin avec 80 sièges, après 5 ans d’absence.
Angela Merkel se retrouve donc débordée de toute part : à gauche, le SPD lui tourne le dos, à l’extrême-droite, l’AfD critique son manque de fermeté, tandis que sur le plan libéral, le FDP est là pour dénoncer le conservatisme de la chancelière.
Mathématiquement, après le refus du SPD, une seule possibilité s’offre à elle : tenter une coalition dite «Jamaïque» avec les Verts et les libéraux du FDP. Autrement dit, le mariage de la carpe et du lapin… Angela Merkel parait nettement affaiblie, et son départ, dans le but de satisfaire l’un ou l’autre de ses alliés est ouvertement évoqué.

Un mois et demi après, pourtant, la situation s’est, en réalité, inversée. Incapable de s’entendre sur un programme gouvernemental, les Verts et le FDP ont dû jeter l’éponge, perdant ainsi beaucoup de leur crédibilité à réellement diriger un jour l’Allemagne. Ceux qui auraient pu être des alliés difficiles semblent devenir des opposants finalement peu gênants.
Du côté du SPD, c’est exactement l’inverse qui semble se produire. Alors que le parti avait annoncé haut et fort sa décision de mener cinq ans de politique d’opposition, ses dirigeants se voient maintenant contraints d’ouvrir la porte à des négociations avec la CDU/CSU, dans le but de respecter le résultat du vote des Allemands, et éviter de nouvelles élections qui, sans doute, risqueraient de mener au même résultat. La véhémence de Martin Schulz pendant la campagne s’est effacée pour faire place à la conciliation. Ainsi, les socio-démocrates sont en passe de redevenir des alliés fidèles d’Angela Merkel, à peine capables d’influencer réellement sa politique, mais tenus à un silence consensuel.
Enfin, l’extrême-droite n’a pas eu besoin d’aide pour s’effriter. À peine 24 heures après avoir été élue députée, la co-présidente Frauke Petry claque la porte de son propre parti. Celui-ci se plonge alors dans une lutte de pouvoir interne, révélant aussi d’importante dissensions sur la ligne politique à mener.

En moins de deux mois, Angela Merkel a donc su retourner la situation à son avantage. Subtilement et presqu’imperceptiblement, elle a fait disparaître ses opposants les plus dangereux – lorsqu’ils ne se sont pas sabordés d’eux-mêmes. Sachant exploiter le temps à son avantage, elle renforce jour après jour son avenir à la tête du pays, laissant la pression populaire et médiatique forcer ses futurs partenaires à avaler n’importe quelle couleuvre. Loin d’être affaiblie, elle vient de donner une brillante leçon de politique à ses adversaires !
* En raison du mode d’élection un peu particulier du Parlement allemand, un mixte entre proportionnelle et majoritaire, le nombre de sièges n’est pas fixe. Lors des élections de 2017, il passe de 631 à 709, le plus au niveau de son histoire.