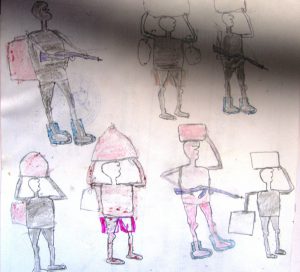Pierre Hazan,
Après 24 ans de service, après avoir procédé à 161 inculpations et presque autant de jugements, écouté quatre mille six cent témoins pendant 10800 jours de procès, produit des millions de pages et coûté quelques deux milliards de dollars, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie va fermer ses portes le 31 décembre 2017. A l’exception de la 2èmeguerre mondiale, aucune guerre n’aura été autant scrutée, et sûrement jamais aucune n’aura été aussi judiciarisée que celle qui ensanglanta l’ex-Yougoslavie durant les années 1990.

L’heure des premiers bilans est venue et à l’évidence, le l’héritage du TPIY est considérable. Son impact majeur fut de contribuer à judiciariser les relations internationales, et de tenter de rendre celle-ci effective dans le temps même de la guerre. Une révolution dont nous n’avons pas fini de mesurer les effets. Conséquence connexe de ce processus de judiciarisation : le tribunal a créé une classe de clercs spécialisés dans les violences de masse et a développé le droit de la guerre par son importante jurisprudence. Le TPIY fut une justice à la fois lente, chère et au langage souvent incompréhensible pour le commun des mortels. Mais par son travail, elle fit la lumière sur des événements clefs de l’histoire européenne contemporaine. Retour sur quelques traits majeurs de son héritage et sur les périodes clefs de son histoire.
L’héritage du TPIY
Le mandat du TPIY
En 1993, lorsque le Conseil de sécurité adopte les résolutions 808 et 827, la communauté internationale assigne un triple rôle au premier tribunal pénal international jamais créé : établir les faits, sanctionner les auteurs de crimes internationaux et participer à la restauration et au maintien de la paix ainsi qu’à « réparer les effets » des crimes. Sur ces trois thèmes, le TPIY a remporté de vrais succès et a subi aussi de lourdes défaites, même si sa responsabilité ne fut pas uniquement la sienne, tant dans les jours de réussite que de défaite.
Le déclencheur de la révolution juridique des années 1990
Porté par la fin de la guerre froide et la lutte contre l’impunité, le TPIY a été l’agent déclencheur de la révolution juridique des années 1990. Une année après sa création, le Conseil de sécurité de l’ONU fut moralement obligé de créer un nouveau tribunal ad hoc après le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Ce fut le Tribunal pénal international pour le Rwanda. S’en est suivi dans la foulée et dans le même esprit de lutte contre l’impunité et de stigmatisation des criminels, la mise sur pied en 1995 de la Commission vérité et réconciliation en Afrique du Sud. Puis en 1998, se tint la conférence diplomatique de Rome qui élabora les statuts de la Cour pénale internationale avant que celle-ci devienne opérationnelle en juillet 2002, lorsque la barre des 60 ratifications fut atteinte. Cette même année 1998, pour la première fois, un ex-dictateur, le général chilien, Augusto Pinochet, fut inculpé par un juge espagnol alors qu’il était soigné en Angleterre, donnant un coup de fouet au principe de la juridiction universelle. Un principe créé plusieurs siècles plus tôt pour lutter contre la piraterie en haute mer et pratiquement tombé en désuétude. En 1999, le TPIY inculpa pour la première fois un président en exercice, en l’occurrence, le chef de l’Etat de la Fédération de Yougoslavie, Slobodan Milosevic, pour crime de guerre et crime contre l’humanité. Les règles et la jurisprudence du TPIY ont donc contribué à réduire considérablement les limites permissibles des amnisties et des immunités. De quoi satisfaire les organisations de défense des droits de l’homme, mais ulcérés ceux qui considèrent que la justice internationale sont les habits neufs d’un néo-impérialisme judiciaire.
La justice dans la guerre
La principale et hautement controversée innovation du TPIY fut d’introduire la justice internationale dans le temps même de la guerre. Quitte à brouiller les séquences traditionnelles des relations internationales, où au temps de la guerre succédait la paix, puis parfois, celui de la justice. Insérer le temps de la justice internationale dans la guerre a polarisé les opinions : d’un côté, ceux qui considère que le droit international peut dissuader la commission de nouveaux crimes et se félicitent de ces développements, de l’autre, ceux qui doutent de l’indépendance d’une telle justice et estiment par ailleurs, qu’elle rendra encore plus problématique une négociation de paix, voire renforcera un leader militaire ou politique coupable de crimes internationaux à s’accrocher au pouvoir pour éviter de passer le restant de ses jours derrière des barreaux, tel le Syrien, Bashar el Assad. Les débats sur le bien-fondé de la justice internationale en temps de guerre restent vifs, mais c’est désormais un acquis repris par la Cour pénale internationale.
L’établissement des faits
Le Tribunal a inculpé des auteurs de crimes internationaux appartenant aux différentes nationalités de l’ex-Yougoslavie et a joué un rôle crucial dans l’établissement des faits relatifs aux crimes internationaux tombant sous sa juridiction, en particulier s’agissant de la guerre de Bosnie-Herzégovine (1992-1995). Les principaux responsables bosno-serbes de la politique du nettoyage ethnique, Radovan Karadzic et Ratko Mladic, ont été sanctionnés. L’événement le plus marquant fut l’analyse minutieuse de la chaîne de commandement, partant des membres du peloton d’exécution jusqu’au général Ratko Mladic dans l’organisation et l’exécution de plus de 8000 Musulmans à Srebrenica, qui fut le crime majeur des guerres des années 1990 dans l’ex-Yougoslavie. Le siège de Sarajevo, les politique de nettoyage ethnique ainsi que les violences administrées par les trois parties au conflit furent aussi dûment établis et les auteurs sanctionnés.
En revanche, après avoir été condamné à 24 ans de prison en première instance pour crime de guerre et crime contre l’humanité, le général croate Ante Gotovina, responsable de l’opération Storm, dont furent victimes des civils serbes, la Cour d’appel l’acquitta en novembre 2012, laissant un goût amer au sein de la société serbe et bien au-delà. De même, si les crimes commis par les forces serbes ont été clairement établis à l’encontre des Kosovars, il n’en est pas de même des crimes imputés à l’Armée de libération du Kosovo, l’UCK. L’acquittement par le TPIY de Ramush Haradinaj, l’actuel Premier Ministre du Kosovo et ex-commandant de l’UCK a porté un coup dur au TPIY. Aucun responsable kosovar n’a inculpé par le TPIY malgré le fait que des dizaines de milliers de Serbes et de Roms ont été contraints de fuir le Kosovo. Le fait que l’Union européenne a créé un tribunal spécifique sur les crimes commis entre 1998 et 2000 par l’UCK montre les limites de l’action du TPIY en ce domaine. De même, les juges du TPIY ne purent prouver la responsabilité des crimes internationaux imputés à l’ultranationaliste serbe, Vojislav Seselj, et l’acquittèrent.
La jurisprudence du TPIY
Le TPIY a développé une importante jurisprudence sur les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les actes de génocide. Il a étendu la définition et la sanction contre les auteurs de violences sexuelles, établi que la réduction en esclavage et les persécutions constituent des crimes contre l’humanité, précisé des règles de procédure concernant notamment la protection des témoins et les plaidoyers de culpabilité.
Lors de son allocution devant le Conseil de sécurité de l’ONU, le président du TPIY a rappelé quelques décisions majeures du tribunal qui sont devenus depuis lors des acquis en droit, repris par d’autres Cours tant nationales qu’internationales. Citons, notamment :
- 2 octobre 1995 : « Ce qui est inhumain, et par conséquent proscrit dans les conflits internationaux ne peut être qu’inhumain et inadmissible dans les conflits internes (procureur contre Dusko Tadic).
- 10 décembre 1998 : « Le viol peut aussi équivaloir à une violation graves des Conventions de Genève, une violation des lois de la guerre ou un acte de génocide, si les éléments requis sont présents, and peut être poursuivis en conséquence. (Proc. Contre Anto Furundzija)
- 5 décembre 2003 : « Des actes de violence dirigé intentionnellement contre la population civile avec pour but premier de terroriser constitue une violation des lois et des coutumes de la guerre (Proc. Contre Stanislav Galic)
Les plaidoyers de culpabilité et la réconciliation
Le TPIY a obtenu de 19 des 161 inculpés qu’ils passent aux aveux et prononcent un plaider-coupable en échange d’une réduction de peine. Ces plaidoyers visaient plusieurs objectifs : obtenir des informations clefs sur les chaînes de commandement ainsi que les lieux des fosses communes, ce qui permit à des familles de récupérer les dépouilles des leurs et de commencer à faire un travail de deuil. Disponible sur internet, ces plaidoyers de culpabilité visaient aussi à créer un récit alternatif aux récits nationalistes qui prévalent auprès des différentes communautés. Sur ce point, le TPIY a échoué. Ce fut l’une des limites de la justice internationale : le TPIY n’a à ce jour jamais réussi à faire passer son message auprès de la majeure partie des populations de l’ex-Yougoslavie : nombre de criminels de guerre, indépendamment de leur nationalité, étant encore considérés aujourd’hui comme des héros par une partie importante de leur communauté. Le TPIY porte une part de responsabilité : avant 1999, les jugements n’étaient pas traduits en serbo-croate et le premier communiqué de presse en serbo-croate remonte à 2000. C’est dire combien le tribunal était orienté vers l’opinion publique occidentale et non vers les sociétés de l’ex-Yougoslavie auxquelles il était pourtant censé s’adresser en premier ! Certains inculpés, notamment Slobodan Milosevic, l’ex-président serbe qui mourut avant son jugement, sut aussi se servir du TPIY comme d’une tribune politique. Certains jugements (en particulier, les affaires Gotovina, Haradinaj, et Seselj) ont été aussi virulemment critiqués.
Mais rappelons aussi que ni la société allemande, ni la société japonaise, ne furent favorables en leur temps aux procès de Nuremberg et de Tokyo. Autre facteur qui contribua au rejet des décisions du TPIY, le fait que l’échelle des peines ne pouvait être en rapport avec la gravité des crimes commis, ce qui ne pouvait générer que la frustration des victimes. Difficulté que la philosophe d’origine allemande, Hannah Arendt, avait parfaitement décrit, évoquant les crimes nazis, elle nota qu’ils étaient si terribles que l’on ne pouvait ni les pardonner, ni les châtier. Il n’en reste pas moins que le TPIY a échoué dans son mandat de réconciliation. Mais pouvait-il réussir ? La paix de Dayton n’avait réussi qu’à faire taire les armes, mais non à créer une véritable paix.