
C’est l’été, on peut se permettre de lire quelque chose pour le plaisir, sans aucune obligation, non ? Voici une suggestion.
J’ai découvert cet auteur en 2018, quand son livre « Une vie d’emprunt » a été présenté au Salon du livre de Genève. Boris Fishman est, comme moi, un ex-soviétique, mais également un juif athée. Il est né à Minsk et a émigré aux États-Unis en 1988 – il avait 9 ans à l’époque, je doute donc qu’on ai demandé son avis. Il habite aujourd’hui New York et enseigne l’écriture créative à l’université de Princeton – sa maman doit être très fière de lui. Malgré cette réussite, les souvenirs du périple familial sont vifs pour lui, et vif est son intérêt pour ses origines.
En 2018 le roman « Le Festin sauvage » qui vient de paraitre en français aux Éditions Noir sur Blanc, était encore en préparation chez HarperCollins, aux USA. On constate que son titre original, « Savage Feast : Three Generations, Two Continents, and a Dinner Table », a été abrégé en français. Mais les trois générations sont bien présentes dans le texte, ainsi que les deux continents et une table à manger.
Ayant lu les deux livres, je trouve que le nouveau est en quelque sorte une continuation du précédent – à la différence que l’histoire de cette famille juive qui fuit l’URSS et, après un passage par Vienne et Rome, s’installe à Brooklyn, est raconté en grande partie à travers des recettes de cuisine. Ce roman est un éloge à la cuisine russe en exil et une étude analytique des rapports particuliers que mes compatriotes ont avec la nourriture. En lisant le roman, les fou-rires se mélangent avec les larmes, ce qui donne ce gout aigre-doux caractéristique de la littérature russe en général et plus particulièrement la littérature juive russe.
Le thème de la faim traverse les 300 et quelques pages du roman. Écrit en anglais (d’ailleurs, aucun livre de Boris Fishman n’est traduit en russe à ce jour), il s’adresse principalement aux lecteurs non-Russes, ce qui nécessite l’explication d’un nombre de faits historiques et de phénomènes sociétaux qui sont évident pour nous. La famine après la Révolution de 1917 et pendant la Deuxième guerre mondiale ; les tickets de rationnement pour lesquels certains étaient prêts à tuer ; les magasins vides et les queues interminables ; l’usage de « délicatesses » inatteignables comme des pots-de-vin et la monnaie la plus fiable… Tout ce système artificiel de survie établi en Union soviétique qu’on aimerait tant oublier et dont on utilise toujours les méthodes pour contourner les imprévus. Les expériences réelles de manque de nourriture de ses ancêtres prennent chez le personnage principal une forme de faim métaphorique pour l’indépendance de ce jeune adulte en pleine crise identitaire. Mais l’indépendance dans une famille juive, ce n’est pas pour tout de suite, vous le découvrirez en lisant le livre.
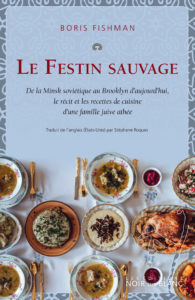
« Nous venons du peuple qui mange », écrit cet américain de la première génération, en s’incluant dans cette formation de gens, qui, ayant connu la faim à un moment de leur vie, restent pour toujours affamés. La nourriture devient un culte et une preuve ultime de l’amour, déclaré souvent trois fois par jour. Ou plus.
L’amour est aussi abondant dans le roman que la bouffe. Ils sont indissociables. Chaque page nous le confirme. La déclaration d’amour à travers la nourriture prend quelquefois des formes énervantes : qui parmi nous, dans son enfance, n’était pas frustré par les tentatives incessantes de nos mères et grand-mères pour nous faire avaler encore un morceau. Et puis encore un. Et puis le dernier… « Comment, tu ne veux plus ? Tu n’as pas aimé ? Veux-tu autre chose ? » Ce n’est qu’en devenant adultes que nous comprenons d’où vient cette gourmandise. Nous acceptons notre défaite, nous mangeons et donnons à manger à notre tour. Parfois, de force.
Globalement, les émigrés soviétiques aux États-Unis méprisent l’alimentation locale. La curiosité initiale satisfaite, ils retournent à leur nourriture traditionnelle dont les recettes passent d’une génération à l’autre. Pour le héros du roman, cette nourriture familiale symbolise l’emprise de la famille sur sa vie plus généralement – il lui est impossible de refuser une assiette de bortsch tout comme il lui est impossible de ne pas demander l’approbation de la famille de chacune de ses actions…
Les tables couvertes de mets délicieux (si vous y êtes habitués) nous retiennent avec la même force que les livres de Ilf et Petrov, Boulgakov et Nabokov, qui figurent dans le roman à côté des blinis et des syrnikis. Pour rompre avec cette dépendance, Boris part en quête de son identité. Cette quête l’emmène dans une ferme typiquement américaine, dans la cuisine d’un restaurant russe local et même dans une réserve indienne. Il fait également un voyage en Ukraine, où, en 2013, les livres en russe et en ukrainien se mélangent aussi naturellement que des langues et les recettes. La boucle est bouclée, pour ainsi dire, dans la cuisine de son grand-père à Brooklyn, où Oksana, l’aide-soignante ukrainienne, lui apprend à faire le bortsch – ce « traitement » se révèle plus efficace que la psychothérapie.
Ce livre touchant contient une trentaine de recettes l’une plus excitante que l’autre, prévues pour les situations les plus inattendues – un vrai régal pour les amateurs. A consommer sans modération, mais attention aux airettes des harengs !
Boris Fishman: Le Festin sauvage. Éditions Noir sur Blanc, 2022. 288 pages • 24 Euros • 28 CHF
Comme vous, l’auteur du “Festin sauvage” est né en Russie soviétique. Sauf erreur de ma part, parti d’URSS avec sa famille en 1988, il avait alors 8 ans. Né dans l’immédiat après-guerre à Genève, de parents apatrides d’origine russe et donc apatride moi-même (la Suisse ne reconnaissant pas le droit du sol), j’aurais donc pu être son père. Souvent, on entend dire que les Russes d’URSS reprochent aux émigrés, les Russes dits “blancs”, de ne pas avoir connu la période soviétique et en particulier la Seconde Guerre Mondiale. A quoi les seconds répondent qu’ils n’ont pas été “infectés” par ce qu’Alexandre Zinoviev appelait “l’avenir du saucisme et des lendemains qui sentent”.
Il ne m’appartient pas de juger de tels parti-pris. Comme les autres, ma génération doit faire face aux réalités de son temps et le passé est le passé. Pourtant, s’il est une chose que je n’ai pas oubliée de l’héritage de nos parents, c’est bien l’art culinaire. Née comme vous à Moscou, en 1910, ma mère, comme ma grand-mère exilée à Paris, avait une façon à elle de préparer blinis, pirochki, shashlik, koulibiak, paskha pascale, koulitch et bitoks (je transcris ces mots en français, vous me le pardonnerez) comme nul autre ne saurait le faire. Pour les bitoks, ma mère nous montrait comment pétrir longuement la viande, et pas n’importe laquelle: si ce n’était pas de l’agneau ce n’était bon à rien. Et la manière de recevoir leurs invités à table relevait chez ma mère et ma grand-mère, malgré l’exiguïté de son petit appartement du boulevard Murat, Porte-Saint Cloud à Paris, de l’art princier de recevoir pour le petit montagnard descendu de ses Alpes suisses à la découverte de cette autre Russie, celle que Marina Gorboff, la seule de ma génération à lui avoir consacré une étude exhaustive, appelle “La Russie fantôme”*.
Raison pour laquelle je me dis que si Mac Donald’s, avec les autres super-stars du “venture capitalism” post-soviétique ont quitté la Russie en raison des sanctions en vigueur, ce n’est certainement pas la perte du hamburger, aussi Big Mac soit-il, qui découragera les Russes, bien au contraire. Quel Big Mac saurait-il en effet égaler le bitok, cet anti-Big Mac par excellence?
L’auteur du livre dont, après avoir lu votre compte-rendu, je n’ai pu résister à la faim de l’acheter et de commencer à le lire, appartient, je crois, à ce qu’on appelle la seconde génération des émigrés russes, celle des années 60 à 80, dont firent partie de grands noms comme ceux de Solenitsyne et de Zinoviev. Celle de mes parents et grand-parents était la première génération, qui a donné son nom au mot “apatride”.
Aujourd’hui, que voyons-nous? Une troisième génération, celle des Russes, souvent comme autrefois l’élite du pays, qui fuient le régime poutinien comme Boris Fishman et les siens le système soviétique et nos parents et grand-parents avant eux le terreur rouge, se retrouvent “sur la route” en perpétuels déraçiné(e)s, en parias, hors-caste et sans-grades. Comme tant d’autres avant lui, comme le héros du film “America, America” d’Elia Kazan, l’auteur du “Festin sauvage” ne se retrouve-t-il pas sur la route de la génération “Beat” – la mienne – en “Nowhere Man in Nowhere Land”? Les Russes de la diaspora sont-ils donc à chaque nouvelle génération condamnés à être des étrangers sur la Terre?
Pour en revenir au “Festin” (sauvage ou pas), n’est-ce pourtant pas la cuisine qui lie nos trois générations? Au point que je rêve parfois, comme l’un de ces émigrés sybarites oisifs d’autrefois, dont toute l’action d’anti-héros forcé consistait à manger, boire et dormir, dormir, boire et manger, de nous voir réunis autour d’un banquet digne de la table de Trimalcion dans le “Satyricon” de Pétrone ou de celle du banquier Taillefer dans “La Peau de chagrin” de Balzac. Je ne peux résister à vous en soumettre la carte:
“Tourtes au poulet et aux champignons frais, concombres salés, baies, saumon frais, esturgeon ambré, gelinottes blanches, poulardes, marinades de pommes et de cerises, confitures, “kacha” à la poêle, “koulibiak”, pâtés vaporeux, moules, poulets en papillottes aux truffes, viandes douces, légumes raffinés, soupe à l’anglaise, “pirojki”, fraîche perdrix à la chair blanche, sandre salé, galantine. vodka de cassis, petits pois à la française, soupe de grémille, rôti de mouton et oreillettes aux cerises, fèves fraîches, bécasseaux, jambon aux petits pois, le tout arrosé de madère, de Château-Lafitte ou de rhum de la Jamaïque, au choix…
Et comme disaient nos mères: “A table, les enfants…”
* Marina Gorboff, “La Russie fantôme”, paru aux Editions l’Age d’Homme en 1995, ce livre semble épuisé. L’auteur l’adresse à celles et ceux de ma génération qui connaissent peu, ou mal celle de leurs ancêtres, dont ils ont oublié jusqu’à la langue.
(Si mon texte est trop long, n’hésitez pas à l’abréger).
Cher Monsieur, merci infiniment pour ce commentaire – il est tout sauf long! Il est si touchant, sincère, profond… je suis ravie si mon texte vois a inspiré d’acheter le livre et j’espère que vous n’êtes pas déçu. Je pense que tout ce qui nous lie à notre enfance constitue l’attache le plus fort – nous le comprenons en grandissant… je vous souhaite une excellente journée et vous remercie encore de votre lecture attentive.