Javier Cercas est un écrivain hanté. Après avoir consacré plusieurs romans au passé récent et éminemment tragique de l’Espagne, notamment à la guerre civile, il revient une fois encore sur ce thème dans “Le monarque des ombres”, son nouveau livre. Et c’est par le biais de l’histoire familiale qu’il revisite cette fois-ci la grande histoire. Fouillant dans les archives, interrogeant les rares témoins encore en vie, s’efforçant avec obstination à lever le voile du non-dit, il enquête un peu à la manière d’un journaliste sur la vie et la mort héroïques de Manuel Mena, un oncle paternel de sa mère tué à 19 ans, le 21 septembre 1938, au cours de la bataille de l’Ebre.
La honte du passé
“C’était un franquiste fervent, ou du moins un fervent phalangiste, ou du moins l’avait-il été au début de la guerre”, nous prévient-il. Les difficultés et l’enjeu de la démarche sont ainsi posés dès les premières pages. “Manuel Mena était le paradigme de l’héritage le plus accablant de ma famille”, ajoute-t-il “raconter son histoire ne voulait pas seulement dire que je prenais en charge son passé politique mais aussi le passé politique de toute ma famille, ce passé qui me faisais rougir de honte.”
Ce livre auquel Javier Cercas, 56 ans, pensait depuis très longtemps – et auquel il croyait avoir renoncé – a donc lui-même une longue histoire. L’auteur la partage généreusement avec son lecteur tout en le conviant dans la fabrique du récit. Réalité? Fiction? Comme de coutume, Cercas met en scène les incertitudes et les failles d’une vérité à jamais inaccessible. Mais cette fois-ci, dit-il, “l’affabulation m’est interdite”. Pour nous permettre de juger sur pièces, il commence donc par nous convier à Ibahernando, le village d’Estrémadure d’où ses parents ont émigré dans les années 60 pour s’installer en Catalogne. C’est là que lui-même a vécu ses toutes premières années. Là également qu’est né et qu’a vécu Manuel Mena.
Mort pour rien?
Ayant choisi habilement de se dédoubler pour mieux garantir une certaine objectivité, Javier Cercas confie par moment le récit à un narrateur extérieur qui, du coup, transforme Cercas lui-même en personnage. L’entreprise est complexe. Elle exige du lecteur qu’il reste actif et se glisse avec souplesse dans le trouble et les incertitudes de l’écrivain. Manuel Mena est-il mort en héros convaincu de la justesse de sa cause ou avait-il pris conscience qu’il s’était fourvoyé et qu’on l’avait trompé? Pièce après pièce, le roman tente de recoller les pièces d’un puzzle condamné à rester incomplet. Une quête qui parfois peut devenir un peu fastidieuse quand l’auteur évoque, dans ses moindres détails, le déroulement d’une bataille à laquelle participa son “héros”. Mais la vérité est à ce prix. Elle réside toujours dans l’infinie complexité. On ne peut que remercier Javier Cercas de nous le rappeler.
“Le monarque des ombres”. De Javier Cercas. Traduit de l’espagnol par Aleksandar Grujicic avec la collaboration de Karine Louesdon. Actes Sud, 320 p. En librairie le 29 août 2018.


 “L’Irlandais”. De Maurice Gouiran. Editions Jigal, 238 p.
“L’Irlandais”. De Maurice Gouiran. Editions Jigal, 238 p.


 “La disparue de Noël”. De Rachel Abbott. Traduit de l’anglais par Muriel Levet. Belfond, 469 p.
“La disparue de Noël”. De Rachel Abbott. Traduit de l’anglais par Muriel Levet. Belfond, 469 p. 
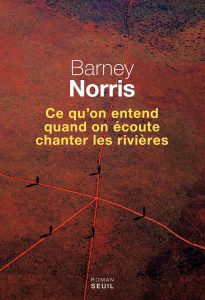

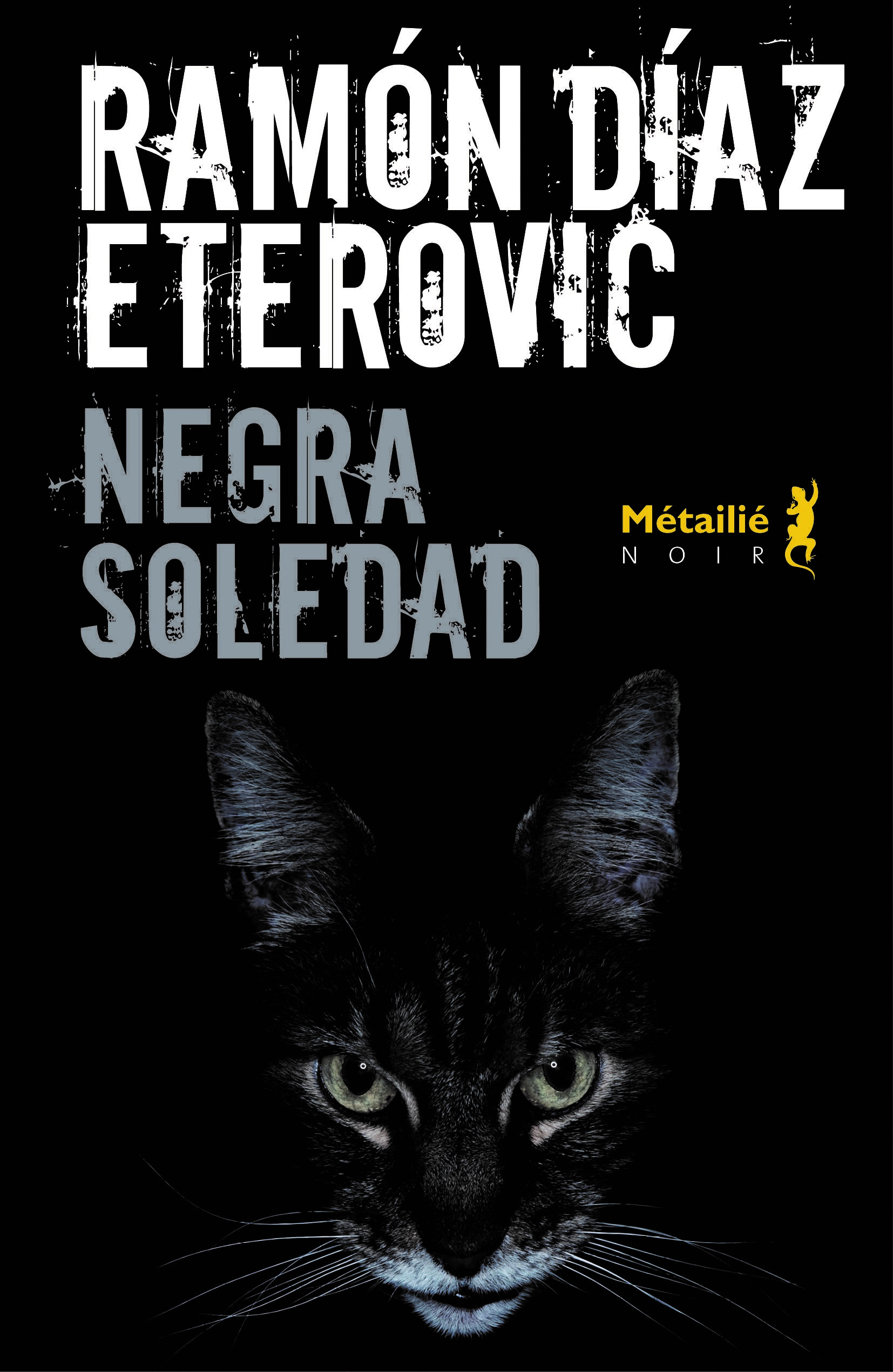 de alors de se rendre sur place et s’installe pour quelques jours dans ce petit village du nord du Chili. Rassurez-vous, toutefois. Simenon n’est pas abandonné sans subsistance. De toute manière, Heredia ne reste pas absent très longtemps. Il va bien vite retourner à Santiago pour poursuivre l’enquête qui désespérément piétine, reprendre sa tournée des bistrots et ses errances urbaines qui nous donnent l’impression de connaître un peu Santiago sans même jamais y avoir été.
de alors de se rendre sur place et s’installe pour quelques jours dans ce petit village du nord du Chili. Rassurez-vous, toutefois. Simenon n’est pas abandonné sans subsistance. De toute manière, Heredia ne reste pas absent très longtemps. Il va bien vite retourner à Santiago pour poursuivre l’enquête qui désespérément piétine, reprendre sa tournée des bistrots et ses errances urbaines qui nous donnent l’impression de connaître un peu Santiago sans même jamais y avoir été.



