
En moins d’une quinzaine d’années, le téléphone mobile a colonisé nos vies et transformé profondément nos habitudes sociales. À l’exception de la voiture et de l’ordinateur, nul autre objet industriel de consommation massive n’a autant modifié l’habitus des individus et des collectivités. Espace public, voitures, transports collectifs de tous les genres : il suffit d’observer quotidiennement les nouveaux rites sociaux de la communication permanente et en flux direct pour s’en convaincre. Certains, parfois sourcilleux, n’hésitent pas à évoquer une nouvelle forme d’autisme social. Voire d’aliénation.
Marché colossal
Le téléphone portable représente un des plus foudroyants développements technologiques de l’histoire industrielle. Il est né en 1973 (prototype) pour être commercialisé dès 1983. En 2006, un milliard de mobiles ont été vendu dans le monde. Fin 2015, s’y ajoutent environ 2 milliards de smartphones ! Tous les chiffres sont en inflation. En 1992, la France compte 500 000 abonnés au téléphone portable. Depuis 2007, le nombre des abonnés dépasse les 90% de la population adulte – 97% des 18-24 ans possèdent un téléphone portable ou un smartphone. Nos amis japonais changent de mobile tous les 12-18 mois. En France, 19 millions de portables sont remplacés annuellement. Marché colossal, on le sait.
Remplacer son portable signifie encore bien souvent le jeter : 500 millions d’exemplaires ont été jetés en 2005 un peu partout sur la planète, dès lors le chiffre augmente malgré les campagnes de recyclage qui tentent d’obvier les problème de pollution avec la dispersion des composant toxiques que renferment les téléphones portables.
Réchauffement de l’ADN
L’industrie des portables est très lourde sur le plan énergétique : savez-vous que la fabrication d’une puce de 2 grammes équivaut à 1.7 kilo d’énergie fossile, 1 mètre cube d’azote et 32 litres d’eau… soit plus que pour une automobile de 750 kilos!?
Le marché du portable, les intérêts et les profits économiques sont colossaux… les politiques de marketing agressives. S’édifient des monopoles inédits depuis le XIXe siècle. Les usages du mobile sont pourtant risqués. Le débat sanitaire flambe sans être tranché : cancer du cerveau, réchauffement de l’ADN, addiction, dangerosité automobile, hypnotisme auditif. La domestication du portable n’est pas achevée pour en limiter les effets pernicieux.
Le bonheur portatif
Mais…. votre portable garantit votre bonheur ! La publicité des opérateurs est sans état d’âme. Elle associe le mobile à un imaginaire social de la réussite: fluidité, signe extérieur de richesse, portabilité des données, modernité communicationnelle, communauté planétaire, mondialisation. Le téléphone portable flatte l’imaginaire de la liberté et de la mobilité infinie. Être moderne, revient à communiquer à chaque instant et n’importe où ! Sans limite. Chaque utilisateur de portable est un acteur de la mondialisation ! Le bonheur est portatif avec la nouvelle configuration du lien social virtuel.
Pourtant, le téléphone mobile instaure de facto la liberté sous surveillance permanente. Le sans-fil enchaîne les individus-consommateurs. Le portable est la prothèse d’une perte d’autonomie. Le portable est un mouchard parfait : il laisse les innombrables traces dont l’utilisation policière culmine sous l’état d’urgence ou dans le cadre de campagnes sécuritaires. Le portable, c’est notre laisse électronique.
Mouchard parfait
En France, les 35 000 antennes qui maillent le territoire permettent de localiser les individus en temps réel. « Déterminer un emploi du temps… définir un itinéraire… reconstituer un réseau de relations… » : le portable radicalise le contrôle social des suspects et mais aussi des autres. Le « bornage » des suspects par le réseau des mobiles : nous vivons maintenant à l’heure de cette nouvelle technique policière du suivi à la trace électronique. Le bornage fait partie de la guerre larvée contre le cancer terroriste : et ensuite ? De telles techniques et de tels usages policiers ne seront jamais abandonnés. Un peu partout, régimes démocratiques ou autoritaires, il n’est pas rare que certains journalistes voient maintenant leurs sources dévoilées par le balisage de la communication mobile.
Dans 1984 (1948) George Orwell brosse une société totalitaire basée sur le panoptisme ou contrôle optique permanent de chaque personne pour repérer les rétifs au régime politique et au bonheur obligatoire dans le mensonge d’Etat. À l’aube du XXIe siècle, le téléphone portable concrétise et accélère le contrôle auditif des individus. Que dire et comment le dire dans le réseau surveillé de la téléphonie mobile ?
Le portable dans la démocratie
Le téléphone portable : objet de progrès ou arme de destruction massive des libertés individuelles ? Un petit livre provocateur mais très lucide nous met la puce à l’oreille. En montrant les mutations économiques et sociales massives qu’engendre la technologie de la téléphonie mobile et portable, il souligne la potentialité infinie du contrôle social que cette technologie instaure dans les sociétés contemporaines. Au temps des drones, l’utopie de la communication permanente mène peut-être à la dystopie du contrôle social infaillible.
Le portable contre ou avec la démocratie ? Question d’avenir qu’amplifient tous les objets connectés qui captent le réel dans d’innombrables circonstances. Pour le meilleur et peut-être le pour pire.
À méditer entre sourire et lucidité : Le téléphone portable, gadget de destruction massive. Pièces et main d’œuvre, Éditions l’Échappée, Montrueil, mai 2008, 94 p. (Collection Négatif).


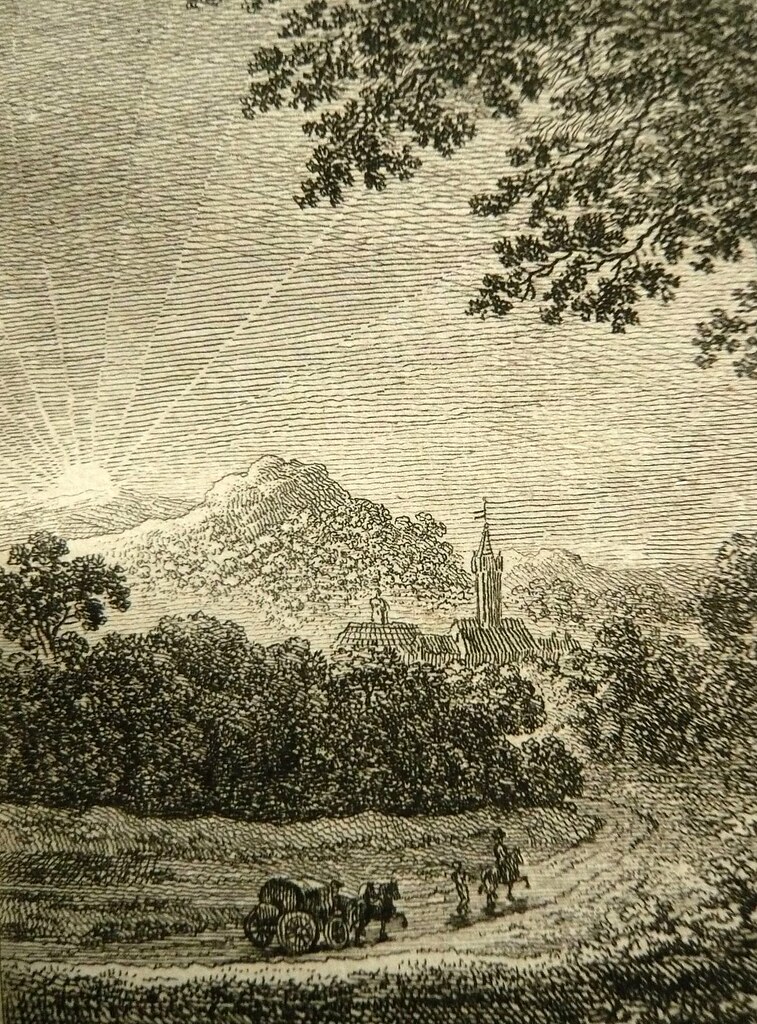




 es bombes » selon Bana al-Abed, fillette syrienne âgée de sept ans. Avec Twitter, cette minuscule et extraordinaire héroïne au regard inquiet informe le monde sur l’escalade militaire et la catastrophe humanitaire en cours. Pourquoi le « monde ne nous entend pas » demande apeurée la fillette ? Comment la regarder dans les yeux avec notre impuissance morale ? À la veille de Noël, en ce début du XXIe siècle, sous un tapis de bombes meurtrières, Alep devient lentement mais sûrement le tombeau de la conscience humaine.
es bombes » selon Bana al-Abed, fillette syrienne âgée de sept ans. Avec Twitter, cette minuscule et extraordinaire héroïne au regard inquiet informe le monde sur l’escalade militaire et la catastrophe humanitaire en cours. Pourquoi le « monde ne nous entend pas » demande apeurée la fillette ? Comment la regarder dans les yeux avec notre impuissance morale ? À la veille de Noël, en ce début du XXIe siècle, sous un tapis de bombes meurtrières, Alep devient lentement mais sûrement le tombeau de la conscience humaine.


