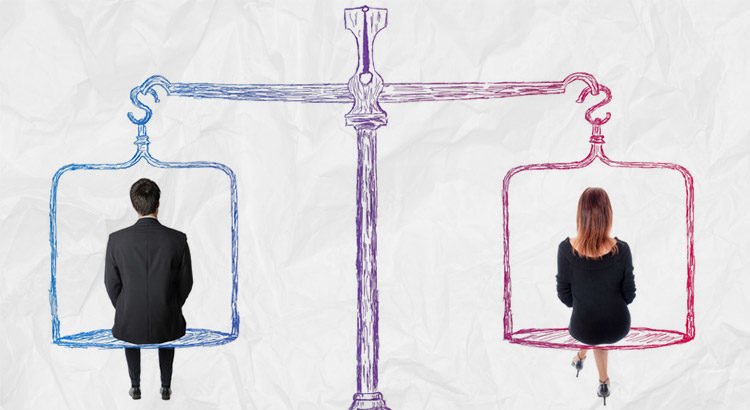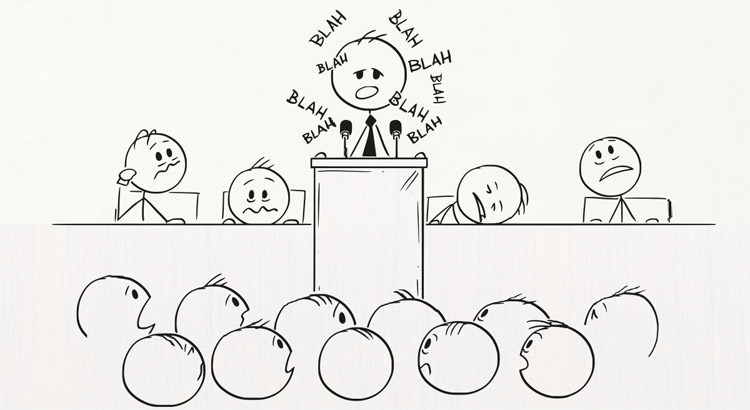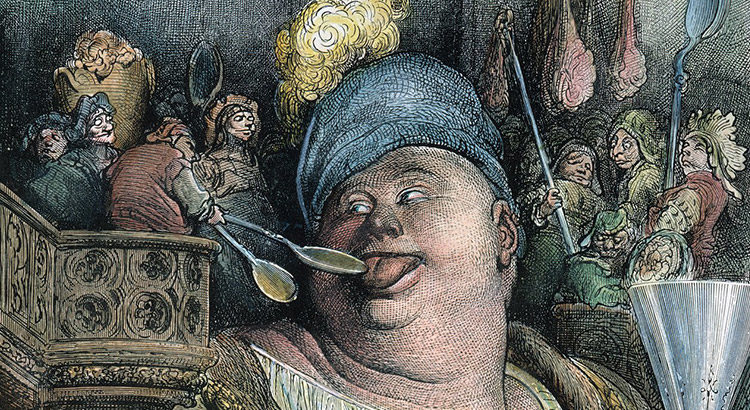Le blog de la FER Genève déménage, retrouvez-le sur le site web de la FER Genève
A l’aune des récentes grèves dans la fonction publique et aux Transports publics à Genève, certains tenteraient de nous faire croire que ces derniers ont des conditions de travail qui se dégradent. Alors que le salaire médian du secteur public est de près de deux mille francs par mois supérieur à celui du privé, soutenir de telles thèses relève de l’indécence.
Loi de moi l’idée de faire du fonctionnaire-bashing. La fonction publique remplit une mission essentielle et Genève notamment a la chance de pouvoir compter sur de grands serviteurs de l’Etat parmi ses collaborateurs. Mais ce constat ne justifie par que les prestations offertes soient largement plus chères que partout ailleurs en Suisse, tous biais corrigés. Comme il se justifie encore moins que l’on augmente les impôts pour continuer à nourrir la machine publique.
C’est pourtant ce que veulent certains. A Genève, dont le budget cantonal a explosé la barre des 10 milliards de francs, la gauche et les syndicats estiment que le contribuable – et plus particulièrement le contribuable aisé – peut encore donner un peu plus de ses revenus et de sa fortune. Une première initiative, qui sera soumise au peuple en mars prochain, veut imposer en totalité les dividendes, parts de bénéfice et autres avantages appréciables en argent de certaines entreprises, oubliant au passage que pour les entreprises concernées, cela signifie une double imposition pleine que la Suisse a atténuée il y a quelques années. Dans quelques mois, une initiative issue des mêmes milieux proposera une contribution temporaire de solidarité des plus aisés, pourtant déjà largement plus taxés à Genève qu’ailleurs. En cas de oui, des départs pourraient créer de gros trous dans le budget cantonal, et in fine pénaliser les prestations à la population. Dans le registre des charges cette fois-ci, les Genevois devront également dire en mars prochain s’ils souhaitent créer chaque année automatiquement des centaines d’emplois, en fonction du taux de chômage.
Ce que nous proposent ces initiatives, c’est en fait de taxer plus, pour engager plus. La question à laquelle les citoyens devront répondre sera donc celle de savoir s’ils veulent d’un Etat pléthorique et omnipotent, au prix d’une taxation encore plus forte, ou s’ils préfèrent un Etat plus fit, qui remplit les tâches régaliennes qui sont les siennes, dans un canton à la fiscalité raisonnable. La réponse tombe sous le sens.
Stéphanie Ruegsegger, directrice politique générale