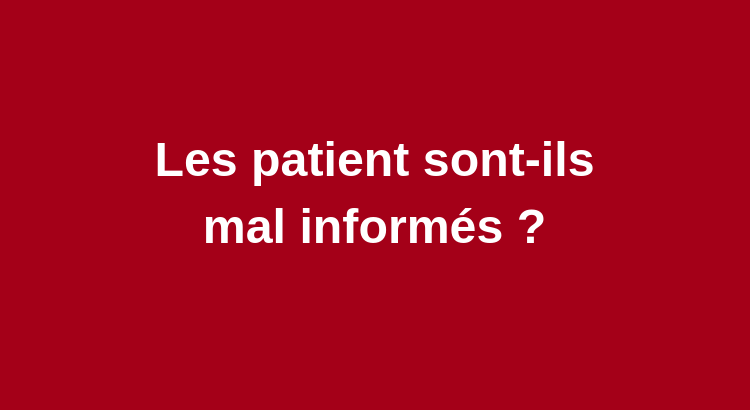Les patients qui font des recherches sur Internet pour en savoir plus sur leurs médicaments ont-ils plus d’effets secondaires ? C’est la question à laquelle ont voulu répondre des chercheurs canadiens dont les travaux ont été publiés dans l’International Journal of Cardiology.
Les auteurs de cette étude « Does Googling lead to statin intolerance ? » se sont demandé si les effets secondaires augmentaient chez les patients qui prennent des médicaments contre le cholestérol et qui font des recherches sur le web.
La fréquence des effets indésirables de ces médicaments, les statines, a été établi dans 13 pays grâce à une enquête effectuée auprès des médecins généralistes et spécialistes de chacun de ces pays. En parallèle, en utilisant le moteur de recherche Google pour chaque pays, le nombre de sites web sur les effets secondaires des statines a été déterminé.
Les résultats de cette recherche montrent que les pays anglophones (Australie, Canada, Royaume-Uni, États-Unis) qui ont la plus forte prévalence d’intolérance aux statines sont aussi ceux qui ont le plus de sites sur les effets secondaires de ces médicaments.
Pour les auteurs de cette étude, la recherche d’information sur Internet sur un médicament pourrait donc renforcer les effets secondaires des internautes.
S’il existe un lien entre les effets négatifs ressentis par les patients et le nombre de sites web consacrés aux effets secondaires, une question reste à mon avis sans réponse : la consultation de ces sites web a-t-elle provoqué chez ces patients des effets secondaires qu’ils n’avaient pas ou au contraire leur a-t-elle permis d’attribuer au médicament un effet négatif déjà ressenti ?
Où trouver des informations de qualité sur les médicaments ?
Pouvoir trouver une information de qualité sur un médicament devrait pour chaque patient être un droit. Mais quel site utiliser ?
La réponse du Dr Jérôme Berger, pharmacien-chef adjoint à la Policlinique médicale universitaire de Lausanne.
« Je recommande d’utiliser le site Swissmedicinfo, un site géré par Swissmedic, l’autorité d’autorisation et de contrôle des produits thérapeutiques en Suisse. En introduisant le nom d’un médicament dans le moteur de recherche présent sur le site, on y trouve la monographie du médicament mais aussi un document intitulé « Informations destinées aux patients » (dont le texte correspond à la notice papier distribuée avec le médicament). Les patients devraient plutôt consulter cette notice, plus lisible ».
Jérôme Berger précise encore un point important :
« Il faut bien insister sur un élément : les monographies sont rédigées par les firmes, puis validées par les autorités, c’est ainsi dans tous les pays. La lecture critique d’une monographie (qui est à la fois un texte scientifique, mais aussi juridique car il précise le cadre dans lequel la firme accepte d’assumer le risque lié au bon usage de son médicament) me semble difficilement possible pour un patient. Un exemple typique concerne l’usage des médicaments durant la grossesse : alors qu’un grand nombre de médicaments peuvent être utilisés durant cette période, la plupart des monographies de médicaments en déconseillent leur usage. Les patients ne doivent donc pas hésiter à discuter des informations trouvées avec un professionnel de la santé, avec leur pharmacien par exemple ».
Ce dernier point me parait essentiel. Consulter la liste des effets secondaires d’un médicament, y compris dans la notice patient, est le meilleur moyen de se faire peur. Les médicaments peuvent bien sûr avoir des effets secondaires mais la liste sans fin d’effets négatifs que l’on trouve pour chaque médicament fait penser que ces notices sont plutôt rédigées par les pharmas pour se protéger d’éventuelles poursuites judiciaires que pour informer les patients.
Même si cela devrait être pour chaque patient un droit fondamental, s’informer sur un médicament reste donc difficile. Les trois conseils à retenir sont : utiliser le site Swissmedicinfo, ne pas prendre à la lettre tout ce que vous pourrez y lire et, en cas de doute, ne pas hésiter à en parler à votre médecin ou à votre pharmacien.
A lire aussi sur ce blog: Une App pour ne plus oublier de prendre vos médicaments?