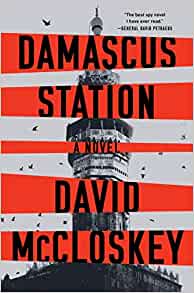Dohany Street constitue troisième volume de la trilogie, Danube Blues, due à la plume de Adam LeBor (www.adamlebor.com), un auteur et journaliste d’investigation anglais.
Ce polar met en scène Balthazar Kovacs, un policier hongrois en qui personne n’a confiance parce qu’il est tzigane, pas même les Tziganes parce que c’est un flic. LeBor tisse une intrigue complexe dont le point de départ est la disparition à Budapest d’un jeune historien israélien qui poursuivait des recherches au sujet des spoliations infligées à la communauté juive en 1944 et 1945.
A la différence de la Suisse mettons, la Hongrie fait partie de ces pays qui produisent plus d’Histoire qu’ils ne peuvent en consommer. Trianon, Horthy, le génocide en quelques mois d’une communauté juive florissante, un régime communistes brutal, une insurrection avortée en 1956 et finalement la chute du communisme et l’avènement de la Troisième République de Hongrie, tout cela en moins d’un siècle, tout cela est plus que la Hongrie n’est capable de digérer. Aussi, en guise d’aspirine, elle préfère se draper dans le rôle de l’éternelle victime, aux mains des vainqueurs de 1918 d’abord, de l’Union Soviétique ensuite et, de nos jours, de l’Union Européenne. LeBor, qui vit à Budapest qu’il connaît en profondeur, saisit bien cet esprit où la mélancolie se mêle au ressentiment, et qu’il traduit par la grisaille qui, dans son roman, enveloppe Budapest en janvier 2016.
Dohany Street est certes une œuvre de fiction, d’où surgissent les cadavres enfouis de l’histoire hongroise, mais c’est aussi une peinture romancée de sa vie politique contemporaine, où le copinage et des intérêts économiques mystérieux et occultes s’entremêlent et fournissent le ressort de ce polar.
Cependant, en fin de compte, le soufflé retombe à plat. L’intrigue, une affaire de spoliation de bien juifs en 1944, est certes plausible mais elle peine à tenir le lecteur en haleine, comme le feraient Tom Clancy ou John Grisham. Surtout, l’auteur vend la mèche 50 pages avant la fin si bien que le lecteur se voit contraint de lire 49 pages de tout est bien qui finit bien.
De plus, conscient de la nécessité de fournir des points de repère à ses lecteurs de langue anglaise, l’auteur leur offre volontiers des précisions quant à la géographie de Budapest, la langue hongroise et la signification de certaines expressions. En définitive, ce livre s’adresse au cercle, sans doute restreint, des lecteurs de langue anglaise au fait de la Hongrie. Les autres choisiront un autre polar pour meubler la sortie du confinement.
Adam LeBor, Dohany Street, Head of Zeus, 400 pages, 2021