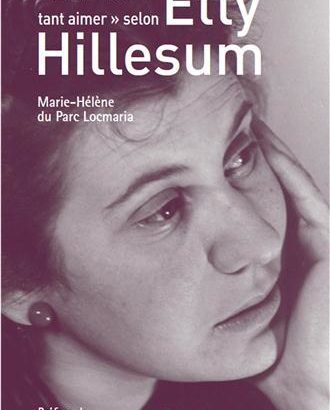Titulaire en 2014 du Prix Ratzinger, membre de l’Académie Pontificale pour la Vie, enseignante au Collège des Bernardins, docteur en sciences des religions, en un mot théologienne de premier plan, Anne-Marie Pelletier examine dans son dernier livre, l’Église et le féminin, la place des femmes au sein de l’Église à la lumière de la Tradition.
Point de départ essentiel de sa réflexion, Pelletier s’appuie sur la Tradition, qu’elle distingue des traditions et qu’elle conçoit comme un mouvement de la foi, plutôt qu’un message immobile. Très attachée à la Bible aussi, elle la lit comme le récit où Dieu se déploie dans la réalité très concrète, charnelle et parfois crue de notre humanité.
Pelletier s’attache d’abord à effectuer un travail d’archéologie ou, si l’on préfère, de mémoire critique, qui vise à identifier la distribution des rôles et du pouvoir parmi les sexes dans l’histoire du peuple de Dieu. L’auteur estime cette phase d’archéologie un préalable indispensable à toute réflexion au sujet de l’Église en tant qu’institution. Car le judaïsme puis le christianisme ne naissent pas dans le vide mais dans le monde concret des civilisations méditerranéennes.
Comme la plupart des espèces animales, l’homme est un être sexué. A la différence des animaux, l’homme en a conscience et voit dans la rencontre des sexes un mystère où l’identique (« la chair de ma chair ») rencontre le différent. Pelletier montre que la recherche anthropologique fait apparaître dans toutes les cultures une prépondérance du masculin sur le féminin qui repose entre autres sur une peur de la femme et sa supposée impureté (voir par exemple le chapitre 12 du Lévitique).
En dépit du caractère rigoureusement novateur du christianisme qui se fonde en définitive sur la foi en la résurrection de la chair, un concept impensable pour les Grecs, le monde chrétien s’alignera rapidement sur les représentations des sexes héritées de l’Antiquité. Là où Paul écrit au chapitre 3 de l’épître aux Galates qu’il n’y a plus homme ni femme car tous ne font qu’un dans le Christ, les structures sociales de l’Antiquité demeurent en place et déboucheront sur la chrétienté du Moyen-Âge où les femmes seront reléguées à l’espace domestique ou, si elles sont religieuses, à la clôture. Pelletier relève cependant que, dès lors que l’Église considère le mariage comme un sacrement, elle met fin à l’arbitraire masculin de la répudiation ; de même la vie en qualité de vierge consacrée au Christ permet aux femmes de s’affranchir de la tutelle du père puis de celle du mari.
Dans une deuxième partie, Anne-Marie Pelletier traite de deux questions importantes pour apprécier le rôle de la femme dans l’Église, la métaphore conjugale et l’existence d’un spécifique féminin. Si l’auteur souligne l’usage abondant dont font la Bible et Église de la métaphore conjugale pour exprimer l’union du Christ et de l’Église, elle ne manque pas de relever que Dieu, alors qu’il est asexué, se voit assigner le rôle masculin de l’époux dans cette relation tandis que Sion puis l’Église sont campées dans le rôle de l’épouse, parfois d’ailleurs comme au chapitre 16 d’Ézéchiel sous des images très violentes. Quant à la question du spécifique féminin, le Magistère depuis Paul VI répond oui avec enthousiasme mais au risque, selon Pelletier, de sacraliser en quelque sorte l’image de la Femme au détriment des femmes concrètes qui ne se reconnaissent pas toujours dans le portrait d’elles-mêmes que leur tend l’Église.
En dépit de cette appréciation critique qu’Anne-Marie Pelletier porte du regard que l’Église porte elle-même sur les femmes et les rôles qu’elle leur réserve, elle demeure convaincue, en raison précisément de l’Incarnation comme une réalité charnelle, de la nécessité d’une anthropologie qui se fonde sur la distinction des sexes. C’est la raison pour laquelle elle estime les théories du gender comme un péril anthropologique, auxquelles elle oppose la différence, et la différence des sexes en particulier, comme une nécessité d’ordre positif.
On cherchera en vain des points médians ou d’autres marques d’écriture inclusive dans ce petit livre à la plume si élégante et ferme et qui, pour cette raison, porte. De son propre aveu, pas optimiste mais portée par l’espérance, Anne-Marie Pelletier propose dans son livre une nouvelle ecclésiologie qui tienne compte non seulement des spécificités de chaque sexe mais qui s’affranchisse de la distinction rigide entre clercs et laïcs alors que les uns et les autres sont des baptisés. Elle rappelle avec force que les charismes de l’Esprit évoqués par saint Paul ne sont pas attribués à un sexe ou à l’autre.
Anne-Marie Pelletier, L’Église et le féminin – Revisiter l’histoire pour servir l’Évangile, Éditions Salvator, 2021, 171 pages.