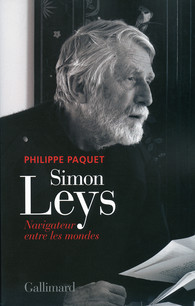De Ryckmans à Leys
On trouve chez Pierre Ryckmans quelque chose de Tintin, le goût du large, la passion de la mer, l’intérêt pour d’autres cultures, du Congo à l’Extrême-Orient, la recherche de la droiture. Ryckmans est de ces hommes discrets, peu connus du grand public, une sommité dans son domaine, celui de la sinologie, et qui aura marqué la vie intellectuelle de son temps, la deuxième moitié du XXe siècle. En 2010, il avait préfacé la biographie que Philippe Paquet avait consacrée à Madame Chiang Kai-shek et c’est par un juste retour des choses que Paquet, lui-même un éminent sinologue, rédige aujourd’hui la biographie de Ryckmans, alias Simon Leys. Car de même que Pierre Assouline avait composé une biographie d’Hergé, plutôt que celle de Georges Rémi, Paquet consacre son ouvrage à Simon Leys, l’homme qu’était devenu Ryckmans. Contraint pour des raisons diplomatiques d’utiliser un pseudonyme pour signer en 1971 Les Habits neufs du président Mao, le livre où il démonte les mécanismes de la révolution culturelle et qui lui valut l’hostilité des milieux maoïstes français, Ryckmans allait se fondre en Simon Leys. Plus qu’un pseudonyme, Simon Leys allait devenir un nom de plume et même parfois un nom de guerre mais surtout le nom qu’il s’était donné à l’occasion d’une nouvelle naissance, celle de l’écrivain; c’est du reste en tant que Simon Leys qu’il serait reçu en 1990 à l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique.
La jeunesse
Ryckmans naît dans une famille où certains lecteurs belges se reconnaîtront : famille nombreuse, catholique, une éducation au Cardinal Mercier à Braine-l’Alleud suivie d’études à Louvain qui n’était pas encore Leuven (en français), l’abonnement au Ligueur, un oncle curé, professeur à l’université, un autre oncle au Congo, en somme la Belgique que Gaston Eyskens appellerait plus tard la Belgique de Papa. Ryckmans ne reniera jamais cette Belgique-là – on sait avec quel acharnement il s’est battu pour que ses deux fils cadets puissent conserver la nationalité belge – mais, « pour vivre pleinement il devait vivre ailleurs ». En 1955, il effectuera ce qui deviendrait un voyage initiatique en Chine et qui le destinera à être plus tard « un écrivain belge établi en Australie».
Le sinologue et l’écrivain
Leys assoira sa réputation de sinologue de premier plan en traduisant et commentant le traité de peinture rédigé par Shitao, un peintre chinois du XVIIe siècle ; cet ouvrage, publié sous le titre de Propos sur la peinture du moine Citrouille-amère Shitao – Contribution à l’étude terminologique des théories chinoises de la peinture lui vaudra d’obtenir le grade de Docteur en Histoire de l’Art et sera suivi en 1971 de La vie et l’œuvre de Su Renshan, rebelle, peintre fou. Leys poursuivra sa carrière en Australie où il enseignera la littérature chinoise aux universités de Canberra et de Sydney. Mais surtout, Leys saura brillamment dépasser le cadre de son expertise professionnelle et se révéler tout à la fois un romancier, un essayiste, un critique littéraire, un historien d’art et un pamphlétaire. Sa langue se distinguera par l’élégance du style, la beauté de l’écriture, la précision, l’absence de jargon jugé vulgaire et portera la marque d’un homme libre, en quête de vérité, une conscience intègre armée d’une plume d’acier. Or, il existe en Chine un lieu où se marient les deux domaines où excelle Leys, la peinture et la littérature : la calligraphie. Il sera un excellent calligraphe, forçant l’admiration des Chinois. On se souviendra qu’Hergé s’était intéressé à la calligraphie chinoise et y trouva une source d’inspiration qui devait aboutir à la formation de son style, la ligne claire ; Leys ne manquera pas du reste de souligner que Le Lotus Bleu constituait une bonne introduction à la Chine. Par ailleurs, Belge du bout du monde, Leys écrira en mandarin et en anglais aussi bien qu’en français et rejoindra le petit cercle des auteurs qui rédigent aussi dans une langue autre que leur langue maternelle – on peut songer à Joseph Conrad ou à Milan Kundera.
Le lecteur profane de langue française pourra se sentir dérouté face à une culture chinoise pour laquelle il peut manquer de repères. A quelle époque vit Confucius ? Quand règne la dynastie des Ming ? De plus, en Chine l’art réside davantage dans l’acte de la création que dans la chose créée, ce qui explique que l’art chinois puisse paraître invariable et donc privé de repères historiques aux yeux d’un occidental. Du reste Leys dira que « la Chine qui m’occupe est une région de l’esprit plutôt qu’un espace géographique », ce sera pour Leys la Chine intérieure, « l’autre pôle de l’existence humaine ».
Philippe Paquet, lui-même journaliste, écrivain et sinologue, marié comme Leys à une Chinoise, volera au secours de ses lecteurs car il sait tout de Leys et de son sujet. S’appuyant sur une masse de documents et de nombreux entretiens avec Leys et d’autres, il ouvrira autant de tiroirs à chaque fois qu’il s’agira de présenter un peintre chinois, un intellectuel maoïste français, les écrivains, Orwell ou Segalen que Leys admirait, les diplomates belges qui ouvrent l’ambassade à Pékin dans les années 1970, les hommes politiques chinois, Mao Tsé-toung bien sûr mais aussi Zhou Enlai, Lin Bao ou Chiang Kai-shek, et enfin les personnes que Leys aura étrillées du verbe ou de la plume. Cela confère au livre de Paquet non seulement un grand charme mais témoigne de la vaste culture de son auteur. Si le livre de Paquet apporte bien entendu sa pierre à l’édification de la sinologie belge, il porte aussi un regard sur tous ceux que Leys, navigateur entre les mondes, aura croisés au cours de la deuxième moitié du XXe siècle.
La mer
Leys aimait la mer. A dix-huit ans à peine il s’embarqua sur un chalutier, le Marconi, pour une pêche à la morue sur les grands bancs d’Islande, dans ces régions du globe où se fracassent des aérolithes. Plus tard de bons vieux cargos le transporteraient en Orient où, passé le canal de Suez il regarderait monter en un ciel ignoré du fond de l’Océan des étoiles nouvelles. Au couchant de sa vie, embarqué à bord d’un bâtiment il s’en irait sillonner les océans de Kerguelen aux Marquises, là où chevalier de Haddoque aurait enfoui un trésor ou encore à l’archipel des Abrolhos, lieu expérimental d’un totalitarisme maoïste au XVIIe siècle. Et puis le 11 août 2014, Leys leva l’ancre pour de bon en la baie de Sydney.
En définitive la biographie de Leys par Paquet révèle de façon magistrale un homme extraordinaire. On y découvre deux écrivains belges pour le prix d’un seul.
Philippe Paquet, Simon Leys, Navigateur entre les mondes, Gallimard, 669 p.
WordPress:
J’aime chargement…