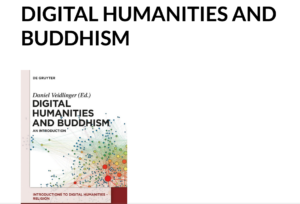Qui ne rêve pas d’une société sereine, où les genres, dans leur diversité, puissent œuvrer ensemble au bien de tous ! Pour que cet objectif idéal ne reste pas un vœu complètement pie, il faut plonger profond les mains dans le cambouis de notre civilisation. Laisser remonter des entrailles des siècles et millénaires tout ce que nous y avons soigneusement oublié. Une société des genres sereine demande, exige, appelle une mémoire historique des genres.
C’est du moins la réflexion que je me suis faite à lire le titre d’un article du Tempspeut avant l’élection complémentaire au Conseil d’Etat vaudois : « Bientôt cinq mères au gouverment vaudois ? », une « majorité qui relève de l’exotisme pour celles qui, leur vie durant, ont exercé leurs mandats politiques minoritairement », commente la journaliste Aïna Skjellaug. Cet exotisme l’est au point que des voix d’autorité, telles Suzette Sandoz ou Anita Messere, se sont hâtées d’en ranger la poussière sous le tapis du « nous aimons être considérées comme des personnes normales », dans un article de LausanneCité.
Hors la normalisation forcée n’a jamais amené la sérénité, on le sait d’expérience. Certes, il fait mal ce terme « d’exotisme », car il ne devrait pas avoir cours, et pourtant Aïna Skjellaug ne fait que donner la voix au sentiment latent de plusieurs citoyens, en l’utilisant. Elle nous met ainsi face à une réalité de transition, qui est « bel et bien historique », comme l’affirme Doris Cohen-Dumani. Contempler 5 femmes sur sept personnes aux plus hautes responsabilités politiques vaudoises indique pour moi une revanche définitive sur une affirmation que j’avais entendue de la part d’un professeur, alors que je faisais mon doctorat : « l’arrivée des femmes dans un lieu professionnel est un signe de perte de pouvoir et d’importance ». Voilà ce qu’on pouvait encore entendre au début des années 2000.

Cette ère patriarcale a péri le 17 mars dernier. Le lieu par excellence du pouvoir politique cantonal, le Conseil d’Etat, sera entre les mains d’une large majorité de femmes dès le mois de mai. Pour prendre la mesure de l’ampleur de l’événement, mais aussi pour lui donner son assise, et nous permettre de relever la tête, femmes de ce canton, femmes dans ce canton, un long travail de mémoire historique nous attend. Il a commencé pour moi en 2003 avec la lecture d’un ouvrage fascinant sur les femmes philosophes juives à Alexandrie au 1ersiècle de notre ère, écrit par Joan Taylor, actuellement professeur de Nouveau Testament au King’s College à Londres. A la lecture de cet ouvrage, des femmes enseignantes, philosophes, de pouvoir, prêtres et mêmes évêques, se sont mises à sortir des limbes de la mémoire historique. Je n’en revenais pas : elles avaient donc existé !
Depuis cette lecture, je n’ai plus jamais scruté un texte de l’Antiquité sans être extrêmement attentive à la présence des femmes, parfois masquée par les traducteurs et éditeurs modernes. L’un des exemples les plus nets de cet effacement se trouve sous la plume du traducteur français d’Irénée de Lyon, auteur chrétien du 2èmesiècle de notre ère. Irénée mentionne qu’un mouvement minoritaire s’est basé sur l’enseignement de « mères et de pères », en latin « a matribus et patribus ». Or le traducteur français a purement et simplement remplacé le terme latin des « mères » par « ancêtres » [1], dans son édition publiée en 1979. Il gratifie ses lecteurs d’une note sur cet échange, qui se passe de commentaire quarante ans plus tard : « nous avons délibérément fait abstraction du mot “matribus”. Ce mot ne soulève, certes, aucune difficulté au plan grammatical, mais, au plan de la pensée, il se révèle difficilement justifiable » [2]. C’est bien cet effacement qui, désormais, n’est plus justifiable.
En modeste hommage aux cinq femmes et deux hommes qui guideront le canton de Vaud dans quelques semaines, voici donc exhumé du passé, sous la traduction moderne, le souvenir de l’enseignement et de l’autorité de « mères et de pères », au 2èmesiècle de notre ère. Bon vent à tous !
[1] A. Rousseau (éd.), Irénée de Lyon. Contre les hérésies, Livre I, tome 2, Sources chrétiennes 264, Cerf, 1979, p. 386-387.
[2] A. Rousseau (éd.), Irénée de Lyon. Contre les hérésies, Livre I, tome 1, Sources chrétiennes 263, Cerf, 1979, p. 314.