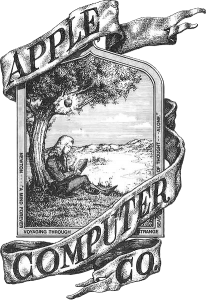Alors que se referment les portes du Salon genevois du Livre, on explore des possibles surprenants sur l’autre rive, celles des recherches de pointe en génomique. Comme stocker ses données, ses écrits, son livre, ses audios ou ses images dans du code génétique, de l’ADN.
Un article de vulgarisation paru en février 2018 s’enthousiasme à dire que « quelques grammes d’ADN pourraient stocker un exabyte de données et le garder intact pendant 2000 ans ». On tiendrait là, semble-t-il, une solution efficace pour le stockage des données à long terme. Mais de quoi s’agit-il exactement? Si les prémices de cette idée remontent aux années 60, ce n’est qu’en 2012 qu’a été publiée l’annonce du premier stockage dans de l’ADN d’un «brouillon HTML d’un livre de 53’400 mots, onze images JPG et un programme JavaScript», par une équipe de Harvard. En 2013, une équipe de l’Institut européen de bioinformatique publiait un article dans Nature faisant état du stockage dans de l’ADN de 154 sonnets de Shakespeare, un clip audio de 26 secondes du discours de Martin Luther King «I Have a Dream», et d’autres matériaux, avec un taux d’erreur de 10 bits sur 5,27 megabits, soit 0,01%. Il vaut la peine d’aller regarder dans le matériel supplémentaire de l’article le schéma du processus : il est saisissant de passer de données écrites aux chiffres de la programmation, puis aux lettres du code génétique, et enfin à ce code synthétisé… et vice-versa.
Avant que les avancées scientifiques ne concrétisent de telles expériences, l’artiste Edouardo Kac en avait fait en 1999 la préfiguration via une performance «biopoétique», s’appuyant sur le code morse pour passer d’un verset biblique de la Genèse – celui qui proclame Adam maître des animaux (Genèse 1,26) – à du code génétique. Comme le relate le site internet de la performance, «le gène avait ensuite été exprimé dans la bactérie E. Coli», puis la bactérie exposée au musée. «Par le truchement d’Internet, les participants pouvaient allumer une boîte d’éclairage ultraviolet dans la galerie et faire muter la bactérie». A la fin de la performance, Kac avait fait l’opération retour: le verset biblique, encodé puis promené en bactérie, s’était légèrement modifié.
Inutile de dire que nous voilà provoqués à penser l’écrit encore autrement, ainsi réuni au code génétique, puis aux gènes eux-mêmes. Alors que nous sommes déjà tiraillés entre l’apaisant livre de papier et le texte connecté aux infinis possibles, nous voilà encore conviés à penser des liens qu’on peine à juste se représenter : nos données, nos écritures, nos images, nos mots, encodés en ADN! Les représentations sont en mutation pour tous dans cette affaire, car avec des «nouveaux concepts, tout se complique», comme le titrait récemment Bertrand Kiefer dans son édito de la Revue Médicale Suisse. Il s’y fait l’écho d’une remise en question grandissante, celle d’avoir précisément voulu rendre compte de l’ADN par des combinaisons de quatre lettres. Or la réalité de l’ADN déborde désormais cette modélisation: «Les humains ont aimé considérer l’ADN comme un texte, qui devait se lire de la même façon que tout écrit. Or non : les brins d’ADN ne cessent de se référer à leur propre structure, ils sont organisés en métatextes, boucles étranges et enchevêtrements superposés».
Les choses débordent les mots, la réalité de l’ADN se rebelle contre le modèle des quatre lettres. J’ajouterai qu’il en advient de même pour l’écriture, lorsqu’elle se risque en ligne: elle devient alors organisée «en métatextes», en «boucles étranges et enchevêtrements» d’hyperliens et d’hypertextes. Ecriture et gênes ont entamé leurs nouveaux pas de deux, et gageons que nous irons avec ce ballet de surprises en découvertes. Pour l’heure, méditons déjà cette nouvelle bibliothèque possible pour les livres: l’ADN.