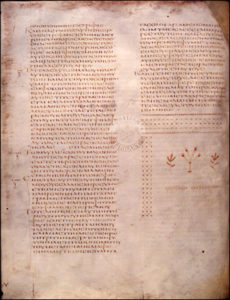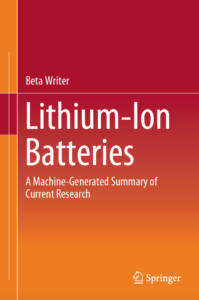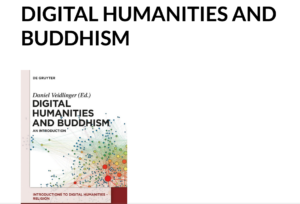Dans mon blog du 24 avril, je cherchais un nom pour cette application de traçage du virus, préparée par l’EPFL et l’EPFZ. Ces derniers jours, dans la presse et les médias, on a commencé à voir son nom technique «DP-3T», et cette anonymisation nous a permis à tous de réaliser que nos Ecoles fédérales avait réussi l’impensable : développer leur propre produit, prenant de cours Google et Apple. Dans l’émission de CQFD du 30 avril dernier, Alfredo Sanchez, chef de projet, explique : «Le modèle décentralisé est la garantie de cette anonymisation des contacts. Le système mis en place ne travaille que par identifiants complètement aléatoires. Et aucune donnée, mais vraiment aucune donnée, n’est échangée ou stockée sur un serveur centralisé avec des informations personnelles. […] Google et Apple se sont joints, c’est un fait historique, pour reproduire ce qu’on est en train de faire, et on est largement en avance sur le terrain là-dessus» (min. 8.00-8.16).
Je ne suis pas surprise que ce soit en Suisse qu’on lie modèle décentralisé et recherche de technologie de pointe. C’est notre manière d’être et nos usages qui ont permis à cette innovation d’aboutir: nous avons la décentralisation naturelle. Il fallait aussi imaginer l’introduction d’identifiants aléatoires et faire confiance à l’intelligence artificielle, lui donner le droit d’exploiter son potentiel propre, sans lui demander simplement d’agir à la mode des êtres humains. Ce partenariat, cette alliance des personnes et des technologies, dûment discuté sur la place publique et au parlement, me donne confiance, comme citoyenne et comme scientifique. Nous évitons ainsi le risque du fichage des données, redouté dans la version française et européenne de cette application, et qui nous rappelle des souvenirs difficiles, qu’on regarde dans l’histoire plus lointaine ou plus proche.
L’heure de la décision s’approche. Pour ma part, je n’hésite pas : ce week-end, c’est 2000 personnes qui faisaient la queue pour recevoir un sac de 20frs de nourriture à Genève, comme nous l’avons appris hier soir au téléjournal de la RTS. La situation ne nous laisse que le choix d’adopter un comportement citoyen, en associant divers moyens de protection, à commencer par les recommandations de l’OFSP, que nous suivons avec une belle rigueur d’ensemble. «Corona» ne sera qu’un moyen parmi d’autres, mais permet d’espérer que nous puissions mener au mieux nos existences dans les semaines et les mois à venir. Elle restera au choix de chacun, mais selon Alfredo Sanchez, même un « pourcentage plus faible [d’utilisateurs] aurait de toutes façons un impact positif » (CFFD, min.10.10-10.14).
Ce débat, Manon Schick, directrice d’Amnesty International Suisse, l’observe avec attention : « Nous suivons avec beaucoup d’intérêt ce travail, car je pense qu’il pourrait être un exemple pour d’autres pays. Avec nos autres partenaires, nous analysons ce que l’EPFL propose. Nous espérons que les chercheurs seront attentifs à nos recommandations. De toute façon, si une application doit avoir le soutien de la population, des garanties doivent être données, sinon cela sera un échec ». Le débat populaire, public, large est indispensable à notre identité collective, et il est en route.
A point nommé, le communiqué de presse du parlement nous a appris, le premier mai dernier, le nom de cette application, lui donnant ainsi son acte de naissance : Corona Proximity Tracing. Le Conseil des Etats en discutera sous le numéro 20.3168 la semaine prochaine, un débat lancé par une commission du Conseil National dès le 22 avril dernier. Il est révélateur de lire dans son article d’opinion publié ce 3 mai, que Solange Ghernaouti ignore le nom de cette application qu’elle désigne encore de son acronyme anonyme DP-3T, renvoyant dos à dos toutes les applications en préparation. Que le débat parlementaire nous permette un discernement judicieux et serein, par-delà les experts en concurrence.
Quel que soit le devenir de cette application, grâce au meilleur de l’intelligence de nos chercheurs, démonstration a été faite qu’il est encore possible, dans la recherche subventionnée par les fonds publics, d’aller plus vite et plus adéquatement que les géants Google et Apple. C’est le trait ultime de la démocratie que de pouvoir mettre le code d’une telle innovation en libre accès. Voici la res publica, la cause publique, sauve, prenant soin au mieux des citoyens, en pariant sur leur responsabilité libre et individuelle.