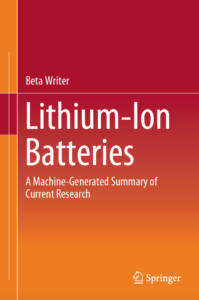Ce 27 septembre aura été une véritable célébration de la démocratie en Suisse : il nous « tardait » de pouvoir à nouveau voter sur le plan fédéral, selon le terme usuel du parler vaudois. Dans tous les objets mis au vote, le soutien au congé paternité est une victoire sociale de très large ampleur, qui marque un véritable tournant dans l’égalité des genres et la perception des valeurs familiales.
Les femmes de ma génération ont en mémoire les débats ubuesques qui précédaient chacune des votations sur l’application de la loi sur le congé maternité, dont le principe avait pourtant été ancré le 25 novembre 1945 dans la Constitution Suisse, et qui entrera en vigueur finalement le 1er juillet 2005. Soixante ans pour une « naissance aux forceps », comme le qualifiait alors un article de Swissinfo. Que nos concitoyens aient pu, quinze ans plus tard, soutenir clairement le congé paternité démontre à quel point l’ambiance culturelle a évolué, bien que là aussi, notre pays ait pris son temps : les médias l’ont rappelé dès le lancement de l’initiative en 2016, la Suisse était le dernier pays européen à ne pas avoir ni congé paternité, ni possibilité de partager un congé parental. Le tournant sociologique est clair, et il est réjouissant de lire Valérie Piller Carrard annonçant la suite : « Début novembre, nous réunirons la gauche, les Vert’libéraux et les partis bourgeois s’ils le souhaitent pour aller de l’avant sur la proposition d’un congé parental ».
Mais c’est encore un autre regard que je porte en ce matin du 28 septembre 2020 sur cette votation : elle représente le seul vrai pas en avant du week-end sur notre positionnement européen. Il semble en effet difficile de porter une appréciation équivalente sur le vote politique qui a heureusement vu le rejet attendu de l’initiative dite de limitation. Ce qu’exprime lucidement Michel Guillaume, correspondant au Palais Fédéral : « Le scénario le plus probable est désormais celui du clash. La Suisse demande une renégociation que l’Europe refuse, à la suite de quoi le Conseil fédéral ou le parlement mettent un terme à l’exercice en cours. En aparté, plusieurs élus, dont certains très influents, évoquent cette piste ».

Ce week-end, nous avons donc apparemment évité la mise en isolement économique, sociale et politique, mais nous n’avons certes pas encore fait de pas en avant sur notre relation à l’Europe. Philippe Nantermod avait absolument raison, hier après-midi, dans l’émission spéciale de la RTS qui avait lieu dès midi, de résumer les dix, voire les vingt ans, perdus dans la construction de notre lien à l’Europe à force de devoir mobiliser nos énergies pour contrer des objets proposés à votation. Il serait judicieux de prendre le temps de l’analyse détaillée de cette période, de reconnaître le potentiel « clash » à venir, et d’entrer en dialogue décidé avec les quelques 38% de nos concitoyens qui auraient adopté l’initiative dite de limitation.
Il en va au fond du besoin d’un congé paternité et maternité au lendemain du « non » helvète à l’abolition de la libre circulation. Car nous n’avons dans les mains ni plus ni moins qu’un nouveau-né démuni, une petite fille Europe, qui attend qu’on prenne soin d’elle et la nourrisse avec attention, et que nous fassions des choix éducatifs cohérents pour son bon développement. Tout (re)commence, et j’espère voir fleurir des initiatives à tous niveaux pour nous inviter au dialogue national sur le développement d’une relation harmonieuse à l’Europe, qui soit convaincante pour davantage que 61% d’entre nous.