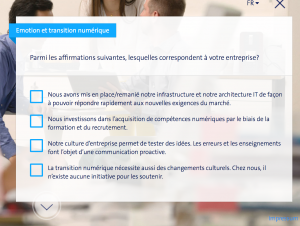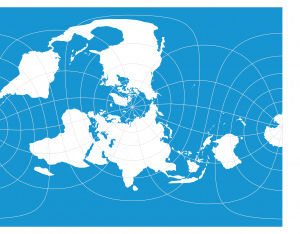La toute fin juillet a vu l’annonce de nouvelles importantes sur le front de l’accès ouvert des publications scientifiques en Suisse, dit open access ou OA.

C’est d’abord Le Courrier qui, du bout du lac, annonçait le 27 juillet que l’Université de Lausanne souhaitait « arriver à l’objectif de 100% [des publications en accès ouvert] d’ici à 2024 ». L’institution académique avait auparavant signalé son intérêt pour la Déclaration de Berlinet Dora, deux démarches visant à promovoir activement l’OA et « à supprimer la corrélation automatique entre le facteur d’impact d’une revue scientifique et la qualité intrinsèque de la contribution d’un scientifique ».
Cet article s’est trouvé d’autant plus souligné que quatre jours plus tard, le Fonds National Suisse (FNS) faisait part des résultats d’une enquête européenne sur les publications scientifiques en accès ouvert, avec la bonne nouvelle de voir la Suisse au premier rang de cet effort : « Avec 39 % de publications en Open Access (OA), la Suisse occupe la première place en comparaison internationale. A l’échelle mondiale, ce sont tout juste 30 % des résultats de la recherchequi sont accessibles librement ». Et le FNS de redire clairement l’échelle temporelle de sa politique OA : « La recherche financée par le FNS contribue à ce bon résultat de la Suisse : environ 50 % des publications qui en sont issues entre 2011 et 2017 sont librement accessibles, et le FNS entend atteindre un taux de libre accès de 100 % d’ici 2020 grâce à sa politique OA. Il soutient ainsi l’utilisation rapide de nouvelles connaissances par la science, l’économie et la société ».
Cette news synthétique du FNS ne mentionne toutefois pas les éditeurs ; l’article du Courrier le fait, mais essentiellement au titre d’acteurs récalcitrants d’une évolution en cours qu’ils ne feraient que freîner : c’est ainsi que « les universités font pression sur les éditeurs », car la « mainmise des éditeurs privés sur les publications académiques agace de plus en plus le monde académique », dit l’article. C’est exactement ici que la Suisse a le plus de pain sur la planche de l’OA des publications scientifiques. Et ce sont les chercheurs qui doivent le dire, urgemment.
L’éditeur scientifique est un acteur crucial de la mécanique académique. Il certifie et atteste de la qualité d’une recherche, par un réseau bien établi de collections et d’examen des travaux (peer-review). Il fait connaître les publications par ses réseaux de publicité, par le réseau des bibliothèques, par sa présence dans les colloques et auprès des chercheurs. Il est un partenaire pour toutes les questions de copyright, qui ne font que devenir chaque jour plus délicates dans la culture digitale. Il est enfin un garant de régulation entre les partenaires académiques.
Mais à l’heure de l’OA, tous les éditeurs ne sont pas sur pied d’égalité : si le FNS dispose de moyens importants pour permettre aux chercheurs de garder les précieux partenaires que sont les éditeurs scientifiques, tel n’est pas le cas dans la plupart des autres pays européens. Par ailleurs, tous les éditeurs n’ont pas la même sensibilités aux défis numériques : il faut, à l’évidence, des nouveaux modèles de publications pour accompagner les recherches se déroulant de plus en plus souvent dans des « environnements virtuels de recherche », virtual research environments.
Heureux sommes-nous d’être en tête de liste des pays européens pour l’OA : faisons de cette marge encourageante l’occasion de prendre le temps de repenser et redéployer nos partenariats avec les éditeurs scientifiques.