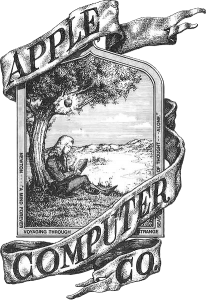Nous sommes faits de contradictions : les avancées scientifiques et technologiques nous sidèrent et nous emmènent dans une tornade où nous craignons de perdre le souffle. En même temps, la culture générale, et plus encore l’enseignement de cette culture en milieu scolaire, fait peu de place à l’histoire des sciences. Au «langage des autres», ai-je envie de dire.
C’est par le hasard d’une excellente conférence qu’on trouve sur Youtube que j’ai réalisé l’homophonie existant en français entre le refrain que nous avons tous chantonné au moment du décès de France Gall, Ella, elle l’a, et le nom d’une autre femme résumé par l’accronyme HeLa.
La figure de l’artiste jazz américaine, Ella Fitzgerald, est on ne peut plus mise en valeur par le refrain simple mais persistant d’Ella, elle l’a, un phénomène qu’on peut pister jusqu’au cheesecake «Ella» à déguster dans un Montreux Jazz Café. Tout au plus aurons-nous eu une pensée pour Ella Maillard et ses incroyables périples aventureux, en fredonnant la rengaine de la chanteuse française juste décédée. Mais combien d’entre nous aurons pensé à HeLa, soit l’abbréviation d’Henrietta Lacks ?

Et pourtant, lorsque le professeur Amos Bairoch, co-directeur du groupe CALIPHO à l’Institut Suisse de Bioinformatique, commence à parler d’HeLa dans la conférence adressée à son groupe, il s’exclame : «Bien sûr, vous connaissez tous HeLa !» (26min50 de la vidéo). Puis il rappelle dans les minutes qui suivent la figure d’Henrietta Lacks qui aura donné à la science la première lignée cellulaire cancéreuse, dite lignée cellulaire (cell line) «immortalisée», selon la page Wikipedia anglophone : ces cellules «ont permis en particulier la mise au point du vaccin contre la poliomyélite et une meilleure connaissance des tumeurs et des virus, ainsi que des avancées comme le clonage ou la thérapie génique», nous précise la page Wikipedia francophone consacrée à Henrietta Lacks.
Jusque-là, rien à signaler, semble-t-il, sauf que le consentement d’Henrietta Lacks – notion non existante pour ce type de recherche en 1951 – n’a pas été demandé à l’époque, au grand dam de sa famille qui n’en prendra conscience que bien plus tard. Il en est resté un malaise et un méli-mélo juridique. Quant à la notion de consentement, elle mettra encore du temps à se mettre en place, comme le raconte Amos Bairoch. De fait, pour ce qui concerne la famille d’Henrietta Lacks et la cell line HeLa, l’affaire n’est toujours pas terminée (29min39-44). Un film a contribué en 2017 à faire connaître son histoire, The Immortal Life of Henrietta Lacks. Les réflexions de la famille se poursuivent.
L’histoire (des sciences) de HeLa se révèle donc une riche matière à réflexion, et vaut comme parabole de notre impression d’entrer dans les avancées scientifiques sans toujours savoir où elles pourraient nous mener. Il est bien sûr douloureux pour une famille de constater qu’on ne lui a pas demandé son avis avant d’utiliser les données médicales d’un proche… Mais on peut aussi considérer l’histoire d’HeLa comme une invitation à penser ce que nous voulons faire des quelques dizaines de kilos de chair qui nous sont impartis pour la brève durée de notre vie d’humain. On sait combien on manque encore en Suisse de dons d’organes aux moments critiques : et si l’histoire d’HeLa nous motivait à prendre notre part, d’une manière ou d’une autre, à l’amélioration de la santé d’autrui ? Et avec notre consentement ?
La chanson Ella, elle l’a prend, à cette aulne-là, une toute autre résonnance : HeLa est là, et nous devons toute notre reconnaissance à Henrietta Lacks pour les progrès faits avec le souvenir de son corps, dans les cell lines. Ella, HeLa : de l’avantage d’apprendre à parler le language des autres, pour réaliser que l’histoire des sciences de la vie, c’est la nôtre, celle de notre être humain.