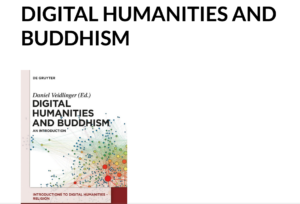Maryanne Wolf est une chercheuse américaine qui, en 2008, a délimité d’un ouvrage clé, Proust and the Squid, l’étude du «cerveau lisant» et l’évolution des manières de lire. Elle dirige le centre pour la «dyslexie, les apprentissages diversifiés et la justice sociale» à l’université UCLA, à Los Angeles. Elle vient de publier ce mois d’août un nouvel ouvrage consacré à la manière dont le cerveau lit dans la culture digitale. A voir l’article coup de poing du 25 août dernier dans The Guardian, l’ouvrage va faire parler de lui.
En effet, selon Wolf, nous sommes désormais à l’heure de la «lecture écumoir», cet ustensile de cuisine ancien, mais dont apparemment nous nous servons à notre sauce aujourd’hui. Le constat de Wolf est sans appel : «Parce que le cerveau lit en écumant les textes, nous n’avons plus le temps de saisir la complexité, de comprendre les sentiments des autres ou de percevoir la beauté. Nous avons besoins d’une nouvelle littératie pour l’age numérique». La lecture en profondeur est menacée, et notre cerveau serait en passe de subir un reformatage dont aucun équivalent n’aurait eu lieu depuis 6000 ans, précise-t-elle. L’analyse critique, et même notre capacité d’empathie, partiraient à vau-l’eau.
Elle cite en appui une important étude norvégienne, et la vision quotidienne de nos contemporains inclinés sur l’écran de leur smartphone ne nous laisse guère de doutes quant à la validité des études signalées. La «lecture écumoire» serait donc la nouvelle norme : «beaucoup de lecteurs utilisent maintenant un schéma en F ou en Z en lisant, avec lequel ils attrapent la première ligne, puis quelques mots dans le reste du texte», indique Wolf. Elle conclut sur un appel au développement d’une «bi-littératie», soit rendre nos cerveaux capables d’utiliser les médias traditionnels et numériques.
A n’en pas douter, ce nouvel ouvrage détonnant de Maryanne Wolf, et son rôle institutionnel de leader dans l’éducation, vont avoir un impact sur l’apprentissage outre-atlantique et au-delà. Reste tout ce dont cet article du Guardian ne parle pas, soit les autres manières de lire, les nouvelles manières de lire que permet le média numérique. Je reste toujours surprise qu’un discours sur les nouvelles technologies soit unilatéral, alors que nous faisons l’expérience jour après jour de la difficulté à saisir en temps réel ce qui se passe vraiment.
Dans le domaine qui est le mien, la recherche académique de pointe, je peux dire que je constate, en effet, une profonde évolution de la lecture. Parfois le temps nous est encore donné pour la lecture approfondie d’une monographie ou d’un texte d’une certaine ampleur. D’autres fois, nous «écumons» sans doute, mais surtout, nous sommes en train de développer de nouvelles manières de lire. J’en citerai deux en particulier.
Premièrement, la monographie disponible sur support numérique : elle se lit, à l’évidence, différemment. La table des matières est la porte d’entrée et de référence et, associée à la recherche des mots clés, elle nous fait quitter un mode de lecture linéaire : la monographie numérique peut se parcourir de diverses manières, telle un terrain à la géographie changeante. L’aura-t-on moins bien lue au final ? Pas forcément, à mon sens; nous sommes en train d’expérimenter une nouvelle sorte de lecture cursive de la monographie.
Deuxième exemple, ce que je nommerai la «lecture à tiroirs». La référence sous forme d’un hyperlien nous donne la possibilité d’aller vérifier ce que l’auteur avance, ou le manuscrit dont il est question. Le lecteur va dès lors faire des aller-retour entre le texte qu’il/elle lit et les autres documents. Apparemment, une telle lecture peut donner le sentiment d’une perte de temps ou de concentration. En fait, elle est une prise de pouvoir du lecteur sur l’auteur, car la vérification immédiate des sources révèle très souvent de sacrées surprises. La culture numérique nous rend beaucoup plus critiques face aux notes de bas de page et aux références, car elle nous donne les moyens d’aller vérifier ce qui est affirmé. La culture imprimée nous vouait au contrat de confiance avec l’auteur, maître de la note de bas de page. La culture numérique met dans nos mains les clés du savoir, pour qui est tenace et apprend à lire en profondeur ce que lui apporte la «lecture écumoire». La vérification critique n’a jamais eu d’aussi beaux jours devant elle: maintenant, nous pouvons la plupart du temps vérifier l’information qu’on nous donne, aisément et rapidement.