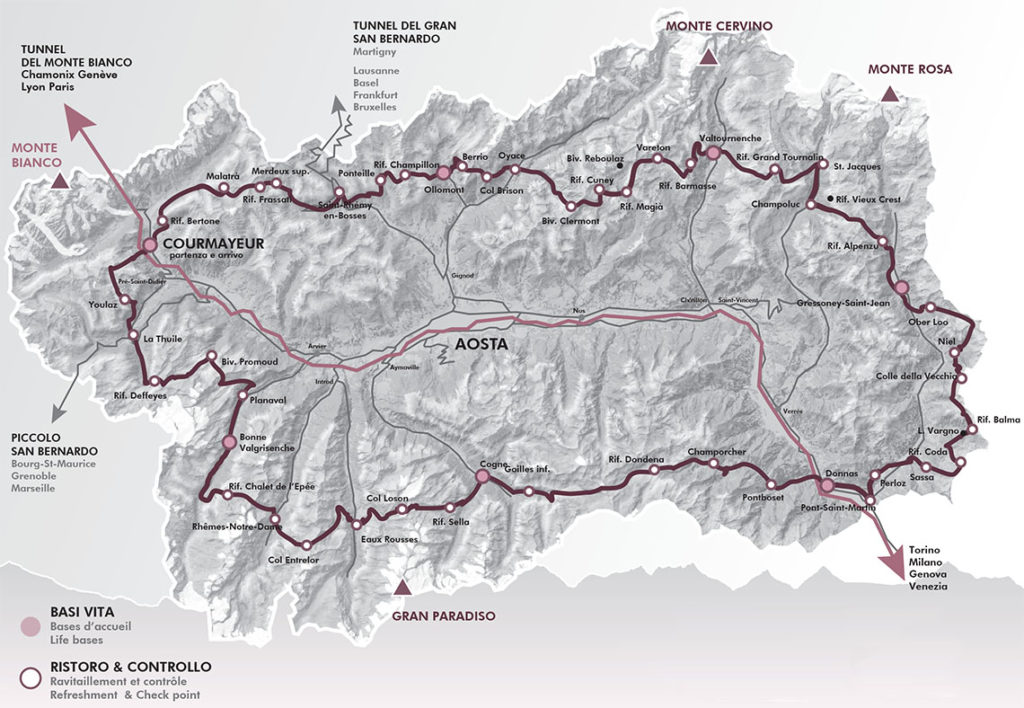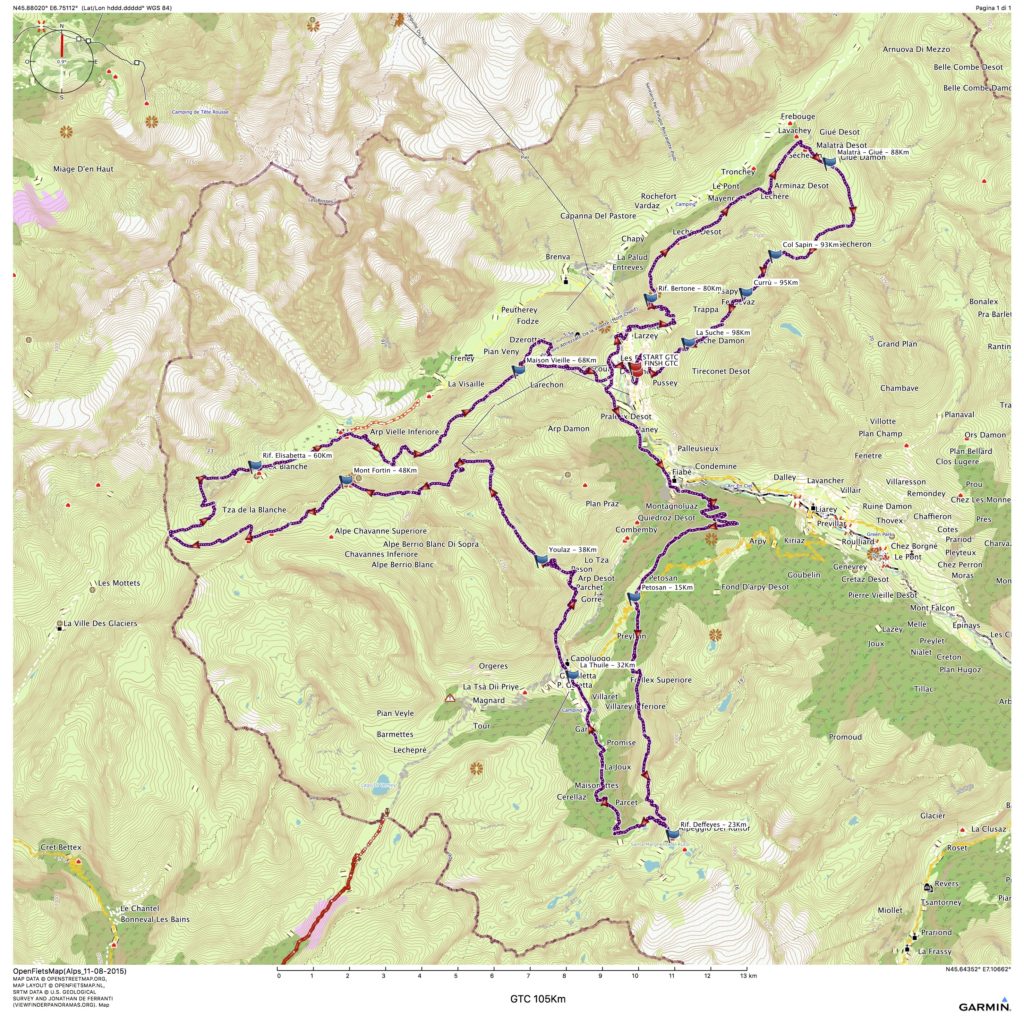Me voilà de retour sur terre, quatre jours après avoir terminé le Tenerife Bluetrail, un ultra de 102 km pour 6400 mètres de dénivelé positif. C’est drôle comme la mémoire fonctionne. J’ai presque l’impression aujourd’hui que ces 19 heures et trois minutes de montées, de descentes, d’exaltation, de fatigue, de chaleur et de visions n’ont jamais existé.
Sur la ligne de départ, donné vendredi 8 juin à 23 h 30 sur la plage de Fanabe, on était près de 400. Il y avait surtout des Espagnols, pour la plupart membres de clubs locaux. Pas de star internationale, mais des coureurs capables de couvrir cette distance à un train d’enfer. Réputé autant pour sa difficulté que pour sa beauté, cet ultra n’attire paradoxalement pas encore les foules. Le parcours traverse l’île du sud au nord, en passant par le sommet du Teide, un volcan qui a donné son nom à un site naturel exceptionnel inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco.
Parti dans le groupe des cent premiers, je suis vite rentré dans le rythme de la course. On a laissé derrière nous cette partie très touristique de l’île pour gagner les contreforts des montagnes. 102 kilomètres, c’est une distance impressionnante mais qui fond comme un morceau de sucre dans une tasse de café. Après 7 ou 8 km au pas de charge, il n’en restait déjà plus que 90 et des poussières.
Venga, chicos, animo!
Passé le premier ravitaillement, je me suis accroché à un groupe d’Espagnols que j’ai suivi durant près de deux heures dans un silence seulement troublé par les “Venga, chicos, animo!” échangés par les coureurs se croisant ou se dépassant dans l’obscurité. Il y a des moments, surtout la nuit, où l’on est littéralement hypnotisé par de petits détails, comme la couleur des chaussettes de celui qui vous précède, la façon dont il pose les pieds ou encore la manière avec laquelle il s’appuie sur ses bâtons pour progresser. Sans presque m’en rendre compte, j’ai passé le cap du 20è puis du 30è kilomètre.
J’étais trop pris par l’envie d’avancer pour chercher à contempler le paysage nocturne, mais pour être passé dans cette zone de jour, la veille, je pouvais parfaitement visualiser le décor lunaire façonné par les éruptions volcaniques successives. Trottinant au milieu des pins des Canaries, j’ai poursuivi mon chemin, surpris par la quantité de sueur que mon corps pouvait produire. J’étais littéralement trempé. On se serait cru dans la jungle tellement l’air était humide. Un épais brouillard s’est levé, ajoutant encore à l’irréalité du moment.
Sachant que la nuit ne durerait pas, j’ai profité des rares sections plates pour éteindre de temps à autre ma frontale et admirer les étoiles. Le temps a continué à filer. A 4 heures du matin, j’ai écouté un peu de musique pour penser à autre chose qu’à mon envie de dormir. Parvenu à un plateau, vers 2000 mètres d’altitude, la lueur du jour, d’abord très faible mais tout de même visible, a percé les ténèbres. Les silhouettes des arbres ont commencé à se détacher progressivement sur un ciel de plus en plus bleu. En contrebas, une mer de nuages cotonneux flottait au-dessus de la forêt.
A un détour du sentier, le soleil s’est levé pour de bon et au même moment, j’ai aperçu pour la première fois la pyramide massive du Teide, le plus haut sommet des Canaries, mais aussi d’Espagne. Un colosse de 3718 mètres! Encore quelques heures et je serais moi aussi en haut. Depuis le temps que j’attendais ce moment…
Au ravitaillement du 48è, j’ai trouvé des pâtes, des fruits frais, du café bien chaud, une vraie oasis. C’est le seul moment de la course où je me suis octroyé une pause assise de dix minutes. Mais étant bien parti, je voulais vite me remettre en chemin. Je peux l’avouer maintenant, le gros morceau à venir me préoccupait un peu. Car en termes d’acclimatation à l’altitude, j’aurais pu mieux faire que de passer trois jours au bord de l’océan à boire des cervezas et à manger du poisson.
Un cosmonaute en baskets
Je me suis remis en route dans une lumière orange éblouissante. Les 500 premiers mètres de la montée ont été vite avalés, mais dès 2500 mètres d’altitude, j’ai dû ralentir. Plusieurs coureurs m’ont dépassé. Je continuais d’avancer du mieux que je pouvais en composant avec une sensation de vertige persistante, qui me faisait vaciller à chaque fois que je regardais de côté ou derrière moi. Mais un pas après l’autre, tout finir par passer, y compris les moments les plus pénibles.
Peu après 3300 mètres d’altitude, après une dernière épaule rocheuse, j’ai entrevu enfin les pylônes de la gare d’arrivée du téléphérique du Teide, où se trouvait le ravitaillement du 58è kilomètre. Le chaos de blocs rocheux que j’escaladais péniblement a cédé la place à un sentier pierreux bien aménagé. J’ai pu reprendre une cadence plus rapide et je suis enfin arrivé à la cabane où d’autres coureurs reprenaient des forces.
Sans traîner, j’ai rempli mes gourdes, avalé une demi assiette de pâtes debout et je suis reparti, en me réjouissant de reprendre un peu mes esprits une fois redescendu de quelques centaines de mètres. Le vent qui soufflait avec force est tombé comme par enchantement de l’autre côté de la montagne. Un nouveau panorama s’est ouvert devant moi, époustouflant. Mille mètres plus bas, je pouvais voir s’étendre à perte de vue un autre haut plateau, seulement zébré par le trait blanc d’une route en gravier pour les jeeps. J’ai pensé à l’émoji de l’astronaute sur mon smartphone. Parfait pour résumer mon sentiment en une image.
Il faisait de plus en plus chaud. J’ai jeté un coup d’oeil à ma montre: Midi et demi. Presque l’heure de la sieste, mais malheureusement pas pour moi. J’ai enchaîné les lacets jusqu’au bas de la pente. Personne derrière, personne devant, j’étais seul au monde. J’ai rejoint bientôt une piste que j’ai suivie durant quelques kilomètres. J’ai pu recommencer à courir librement sans regarder chaque caillou susceptible de me faire trébucher. Une option peu recommandée sur les roches volcaniques aussi abrasives que du papier de verre.
La piste est devenue sentier et je l’ai suivi en serpentant à travers des buissons épineux. Plus aucun souffle de vent ne traversait l’air. Le soleil était toujours plus inamical. L’eau des gourdes était entre tiède et chaude. Ma montre s’est éteinte. Je me suis lancé dans un petit calcul mental pour savoir où j’en étais dans cette longue descente de 25 kilomètres. Une opération a priori toute simple qui m’a néanmoins occupé durant plusieurs minutes.
La tentation de la pastèque
J’ai continué ma progression à un bon rythme. Un coureur rencontré en chemin a pointé du doigt une forêt de pins au loin. J’avais de la peine à croire que c’est là que nous devions aller et pourtant, une heure plus tard, les arbres sont devenus autre chose que de vagues formes dans un paysage. Après ce qui m’a semblé une éternité dans la fournaise, j’ai enfin trouvé l’ombre bienfaisante sous leur couvert.
Je n’ai presque pas regardé une seule fois derrière moi pour voir le chemin parcouru mais je l’ai fait avant que le Teide ne disparaisse tout à fait de ma vue. Je me trouvais alors à une quinzaine de kilomètres de la mer, et donc de l’arrivée. Au ravitaillement du 85è, il y avait de la pastèque, coupée en morceaux et plongée dans des bacs de glace. A la troisième tranche, j’ai pensé à Ulysse cédant au chant des sirènes et je me suis forcé à repartir.
Pendant plusieurs kilomètres, j’ai suivi une piste forestière, avançant à près de 10 km/heure, ce qui m’a semblé assez incroyable après une bonne quinzaine d’heures de course. J’ai continué à descendre dans la forêt et dans les nuages, définitivement à l’abri des rayons impitoyables du soleil. Mais si la distance à parcourir n’était plus très grande, je n’en avais pas fini pour autant avec les surprises. Il me restait encore une dernière montée de 600 mètres à gravir. Un escalier vers le ciel, avec des marches qui semblaient davantage taillées pour des géants que pour les hommes.
Mais comme pour le Teide, je me suis hissé pas à pas vers le haut jusqu’à ce que j’aperçoive la jeep d’une équipe médicale présente pour contrôler l’état de santé des coureurs avant la descente. J’étais tellement fatigué que je prêtais à peine attention à la pluie qui s’était transformée en déluge. En voyant patiner les coureurs dans la boue, j’ai compris que ce n’était pas encore gagné. Certains étaient tellement désespérés par l’état du terrain qu’ils préféraient se laisser glisser sur les fesses que de retomber une énième fois par terre.
Heureusement, aidé par mes bâtons et par une certaine habitude à composer avec la boue, je m’en suis mieux sorti, glanant une dizaine de places au passage. Je voyais la mer à présent. L’arrivée était toute proche. Sur la fin, le tracé n’était pas des plus élégants, mais j’ai essayé d’en faire abstraction. Dans ces moments, de telles pensées peuvent devenir un fardeau. Il ne faut pas leur laisser trop de place. J’ai remis mes écouteurs et continué de me laisser porter par la musique.
A mesure que j’approchais du centre-ville de Puerto de la Cruz, ma foulée est devenue plus souple. J’ai accéléré. Je voulais donner tout ce que j’avais. Je regardais devant moi, savourant la dernière ligne droite. 100 kilomètres derrière, plus qu’un à parcourir. Le meilleur moment de la course. Des passants et des spectateurs ont commencé à applaudir, de plus en plus nombreux à mesure que je me frayais un chemin vers l’arrivée. A 18 h 33, je sautais de joie en passant la ligne symbolique tant attendue, à la 70è place.
Je suis resté quelques instants debout au milieu du vacarme, de la musique, des gens, avant de m’asseoir. C’était un sentiment fantastique. Parce que cette fois, je savais que je pouvais rester là aussi longtemps que je le voudrais. Le temps s’était arrêté de courir en même temps que moi.
Photo: Jordi de la Fuente