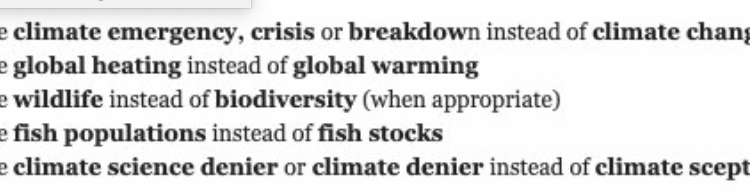—
Je publie ci-dessous, dans sa version française, le discours que j’ai tenu en italien le 16 octobre 2019, à l’après-midi d’étude de l’IUFFP de Lugano, consacré à l’économie circulaire.
Etaient également présents à cet événement des représentants de l’économie et d’entreprises pionnières, avec lesquels j’ai eu le plaisir de dialoguer, en particulier, Yves Chardonnens Cook et Laurence Fabry Lorenzini, d’EspaceEntreprise. Maurizio Crippa, de Gr3n SAGLet Moïse Tschannen, d’Aurum Gavia SA.
—
Aujourd’hui, l’économie circulaire est presque devenue une expression à la mode. Mais elle n’est pas toujours bien comprise. On l’associe encore trop souvent à une simple promotion du recyclage, alors qu’elle représente un véritable potentiel disruptif, dans le sens le plus positif du terme, à la fois pour notre économie et pour une gestion durable des ressources naturelles et des matières premières.
Sortir du fonctionnement linéaire de notre économie
J’aimerais ouvrir cette après-midi d’étude en faisant avec vous un état des lieux de l’économie circulaire en Suisse, sur la base de mon expérience personnelle. Je me suis toujours intéressée à l’économie et à la manière dont on pourrait la concilier avec la préservation de l’environnement. L’économie est l’interface par laquelle nous exploitons les ressources naturelles. Elle fonctionne aujourd’hui de manière linéaire. Elle extrait des ressources et matières premières de notre planète, elle les transforme en produits de consommation de masse, souvent homogènes et de mauvaise qualité, conçus pour être vendus à bas prix. Ces produits sont ensuite jetés après une utilisation de courte durée. Un tel fonctionnement suscite d’importantes pollutions tout au long de la chaine de production et de consommation, ainsi qu’un gigantesque gaspillage.
Développer de nouveaux modèles d’affaire
L’économie circulaire veut répondre à ce problème. Elle vise à réduire drastiquement la consommation de ressources, en fermant les cycles de vie des matériaux. Cela ne signifie pas seulement plus de recyclage. L’économie circulaire commence bien avant. Il s’agit de réduire en amont l’utilisation de matières premières et de repenser fondamentalement la conception des produits dans ce sens. Pour économiser les ressources, les biens de consommation doivent être pensés de manière à durer plus longtemps, à être réparables facilement et à ce que leurs différents composants puissent être aisément séparés, revalorisés, réutilisés et recyclés. De nouveaux modèles d’affaires sont appelés à se développer dans ce contexte. Il s’agit de sortir d’un modèle où, pour être rentable, une entreprise a intérêt à vendre un maximum de marchandises à bon marché et de piètre qualité, que les consommateurs devront ensuite remplacer au rythme le plus rapide possible. Dans ce contexte, l’économie de fonctionnalité est une des pistes à suivre. En vendant non pas la propriété de l’objet, mais son usage, elle permet de produire moins de marchandises et de privilégier leur qualité. En effet, ces marchandises seront offertes en partage et l’entreprise a dès lors intérêt à ce qu’elles durent plus longtemps. Ce modèle va aussi optimiser leur usage, permettant à un grand nombre de personnes de bénéficier de leurs services, souvent à un prix très abordable, tout en économisant les ressources.
De l’écologie industrielle à l’économie circulaire
J’ai découvert l’économie circulaire par le biais de l’écologie industrielle, qui consiste à encourager les entreprises à collaborer entre elles pour économiser les ressources, les déchets des unes devenant les ressources des autres. Le professeur Suren Erkman, de l’Université de Lausanne, travaillait sur le sujet depuis plusieurs années. Mon collègue Robert Cramer, alors conseiller d’Etat à Genève, s’est basé sur ses travaux pour faire réaliser une analyse des flux de matière de son canton. Cette analyse a donné lieu à deux mesures pionnières. Tout d’abord, le canton a décidé d’encourager la création d’éco-sites, au sein desquels des processus d’écologie industrielle pouvaient avoir lieu. Ensuite il a développé un projet de revalorisation et de recyclage des déchets de chantier, qui composaient les flux de matière les plus importants et le plus facilement réductible dans la région.
Un premier débat démocratique avec l’économie verte
C’est sur la base de ces premières expériences que les Verts ont lancé, en 2010, l’initiative pour une économie verte, qui visait à inscrire dans la Constitution les principes de l’économie circulaire, en particulier l’encouragement de la fermeture des cycles de vie des matériaux. Ce texte a donné lieu à un vaste débat qui a contribué à la popularisation du concept d’économie circulaire dans tout le pays. Ce débat a tout d’abord eu lieu au sein de l’administration fédérale et du parlement, puisque le Conseil fédéral a décidé de proposer au parlement un contre-projet à l’initiative. Celui-ci consistait en une révision de la Loi sur la protection de l’environnement qui, dans son état actuel, est encore orientée sur le traitement des pollutions et des atteintes à l’environnement. Il s’agissait d’en faire une véritable loi de gestion durable des ressources.
De nombreuses innovations ont ainsi été proposées par l’administration, en particulier l’ancrage dans la loi du principe de la gestion durable des ressources et la nécessité de faire primer la valorisation matière, c’est-à-dire la réutilisation, la réparation ou le recyclage, sur la valorisation énergétique, à savoir l’incinération. L’administration fédérale a également proposé de tenir compte, lors des efforts de gestion durable des ressources, de l’ensemble de la chaîne de valeur, y compris des ressources que nous importons de l’étranger. Enfin, de nouveau instruments ont été proposés, comme la création d’une plateforme de soutien et d’échange de bonnes pratiques pour les entreprises disposées à réaliser une transition vers l’économie circulaire, ou la mise en place de contrats d’objectifs entre l’administration fédérale et les différentes branches économiques, en vue de réduire leur impact sur les ressources.
Malheureusement, un tel projet était encore en avance sur son temps. Le premier geste du parlement conservateur nouvellement élu en 2015 a été d’enterrer le contre-projet à l’issue des débats. L’initiative a donc été soumise au peuple en 2016. Elle a été nettement refusée par la population, avec toutefois des résultats plus positifs en Suisse romande et même une acceptation dans le canton de Genève, toujours pionnier.
Des milieux économiques engagés
La campagne de votation a montré l’émergence d’une pluralité au sein de l’économie. En effet, l’initiative, comme le contre-projet lors des débats parlementaires, a été violemment attaquée par économiesuisse. Cependant, de nombreuses entreprises se sont engagées favorablement dans les discussions. Durant les débats parlementaires, le contre-projet été soutenus par le secteur du recyclage, qui a fort bien compris les enjeux de l’économie circulaire, mais aussi par le commerce de détail, séduit par les propositions de l’administration en matière de conventions d’objectifs. Par la suite, une large coalition s’est créée pour mener la campagne en faveur de l’initiative. Une organisation économique l’a rejointe et s’est montrée très active, alors qu’elle était à l’époque encore peu connue. Il s’agit de Swisscleantech, qui réunit des entreprises responsables et engagées en faveur de l’environnement. La campagne a ainsi généré une grande dynamique dans les milieux économiques progressistes, suscitant des prises de positions courageuses de la part d’entreprises très diversifiées, de la start-up durable à des géants traditionnels comme Ikea.
Circular Economy Switzerland : un mouvement est né
A l’issue du vote, il était important de ne pas en rester là, malgré le refus populaire. L’économie circulaire devait continuer à se faire connaître par d’autres biais, en dehors du débat politique. Le mouvement Circular Economy Switzerland, dont le but est de mobiliser les acteurs suisses engagés pour l’économie circulaire, est alors né et a permis de mobiliser de nouveaux acteurs. Il a notamment été lancé par sanu durabilitas, un think tank de la durabilité dans le conseil de fondation duquel je siège. Circular Economy Switzerland a été inauguré en 2019 à Bâle puis à Lausanne. Soutenu par la Fondation MAVA et le Fonds d’engagement Migros, il veut jouer un rôle de catalyseur de l’économie circulaire, via le développement de divers projets et événements. Aujourd’hui, l’équipe de base se compose d’ecos, YODEL, le Forum économique suisse, PUSCH, Impact Hub, Circular Hub et sanu durabilitas. Circular Economy Switzerland se considère comme une plate-forme de coordination et d’échange ouverte à toutes les initiatives et à tous les acteurs dans le domaine de l’économie circulaire.
Créer des liens entre science, économie et politique
Le rôle de sanu durabilitas dans le projet est entre autres de rendre disponibles les résultats du Programme de recherche sur l’économie durable (PNR 73), lancé par le Conseil fédéral au moment des débats sur l’initiative pour une économie verte, aux décideurs politiques et aux entreprises. Le Laboratory for Applied Circular Economy (LACE) implique ainsi les Universités de Lausanne et de St-Gall, ainsi que l’Empa pour le côté scientifique, mais aussi sept entreprises partenaires, dont Nespresso, Logitech ou encore Losinger Marazzi, qui testent les solutions durables développées par les scientifiques. L’objectif est de communiquer les résultats du projet au grand public et aux décideurs, dans le but de les sensibiliser à l’économie circulaire.
Soutenir l’émergence de startups
Sanu durabilitas collabore en outre avec Impact Hub, un réseau d’espaces de coworking orienté sur la durabilité, dans le cadre du projet Circular Economy Transition (CET), qui soutient des PME et des startups dans le développement de nouveaux produits, services et modèles d’affaire circulaires. Ce projet vise également à constituer une communauté parmi les entrepreneurs intéressés par l’économie circulaire, via des événements mensuels donnés dans les Impact Hub à Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich, autour des différents aspects de l’économie circulaire. Actuellement, un appel à candidature est lancé jusqu’au 15 décembre par Circular Economy Transition, pour que de nouvelles startups actives dans le domaine de l’économie circulaire s’associent au projet.
Valoriser l’engagement des PME
Afin de mettre en valeur le travail des entreprises dans le cadre de la transition vers l’économie circulaire, deux instruments ont en outre été mis en places. Shift Switzerland, tout d’abord, est un événement sur l’économie circulaire qui aura lieu pour la première fois les 21 et 22 janvier 2020 à Lucerne et qui proposera des espaces d’exposition pour des entreprises et projets pionniers. Par ailleurs, la plateforme CE2 – Circular Economy Entrepreneurs a été lancée en juin dernier à Langenthal. Elle organise une conférence annuelle, des ateliers régionaux et assure un espace de dialogue interprofessionnel en ligne. Certains secteurs économiques spécifiques sont par ailleurs traités dans le cadre de projets ciblés. C’est le cas du marché du meuble, avec le projet Make Furniture Circular, piloté par la Fondation PUSCH, ou du domaine de la construction, avec la plateforme Madaster, qui vise à économiser les matériaux.
Mettre en réseau les villes pionnières
Circular Economy Switzerland ne s’intéresse pas qu’aux milieux économiques. Le mouvement inclutégalement le projet Circular Cities Switzerland, qui analyse le potentiel circulaire des villes et les accompagne dans la mise en place de projets pilotes. Des échanges de bonnes pratiques et une mise en réseau des villes pionnières en matière d’économie circulaire sont également prévus. Pour le moment, les villes de Berne et de Bâle sont impliquées. Le projet est accompagné par Ecos et par Circle Economy.
Des développements récents au niveau fédéral
Au niveau fédéral, les choses bougent également à nouveau depuis un an. Il a certes été difficile d’avancer politiquement dans les mois qui ont suivi le vote sur l’initiative pour une économie verte, mais la signature de l’Accord de Paris et le mouvement des grèves pour le climat ont changé la donne. Plusieurs succès ont ainsi pu être obtenus dans les domaines de l’économie circulaire et de la gestion durable des matières premières. J’ai pu en particulier réunir une majorité au Conseil fédéral et au parlement pour une stratégie de gestion durable des plastiques, à l’image de ce que développe actuellement l’Union européenne. Le plastique est le matériau emblématique de l’économie du tout-jetable, il est urgent de lui appliquer les principes de l’économie circulaire. Par ailleurs, un des points les moins contestés du contre-projet à l’initiative pour une économie verte a été accepté récemment au parlement. Il s’agissait d’interdire en Suisse, comme le fait déjà l’Union européenne, l’importation de bois issu de coupes illégales. De plus, nous sommes parvenus à ajouter dans la loi la possibilité, pour le Conseil fédéral, d’imposer des limitations ou des critères à l’importation pour d’autres matières premières pour lesquelles des standards écologiques internationaux existent, à l’image de l’huile de palme, du soja ou du coton.
Une nouvelle alliance politique interpartis
Enfin, nous avons créé une nouvelle alliance politique pour l’économie circulaire, qui réunit des représentants des Verts, du PS, du PDC, du PBD et des Vert’libéraux. Nous avons déposé plusieurs interventions parlementaires communes reprenant des points qui figuraient dans le contre-projet à l’initiative pour une économie verte. Elles visent notamment à inscrire dans la loi la préservation des ressources, la prise en compte de l’impact des ressources que nous importons de l’étranger, la priorité de la revalorisation des matériaux par rapport à l’incinération, mais aussi des mesures plus concrètes comme la limitation des emballages ou la réalisation de conventions d’objectifs avec les branches économiques pour réduire le gaspillage de ressources. Ces interventions seront soumises au prochain parlement, dont nous espérons qu’il sera plus progressiste que l’actuel. Des signaux encourageants sont d’ores et déjà perceptibles. Même le PLR, qui avait à l’époque lutté avec véhémence à la fois contre l’initiative pour une économie verte et contre son contre-projet, s’intéresse maintenant à l’économie circulaire et l’a inscrite dans son nouveau programme environnemental.
Un après-midi pour échanger
Je souhaite dès lors que cette nouvelle configuration ait de l’impact et que les avancées dans les domaines scientifiques, économiques et politiques nous permettent rapidement de réaliser la transition de l’économie actuelle, destructrice tant pour climat que pour nos ressources, vers une économie durable et circulaire. Une journée comme celle-ci y contribue. Je vous remercie chaleureusement de m’y avoir conviée et me réjouis de participer aux échanges cet après-midi.